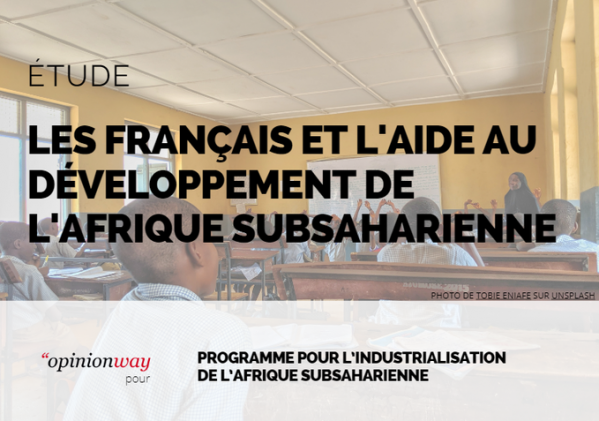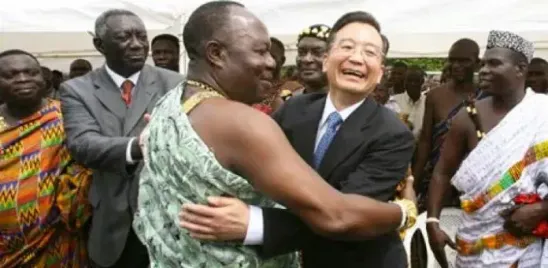L'Afrique subsaharienne a besoin de s'industrialiser en 15 à 20 ans pour éviter le risque de chaos humanitaire
Selon la Banque Mondiale "pour 2030, les prévisions indiquent que 9 personnes vivant dans l'extrême pauvreté sur 10 vivront en Afrique subsaharienne." Sa population passera d'1 milliard d'habitants à 2 en 2050 puis 4 en 2100. Les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin ». Un développement panafricain replié sur le continent tel que démagogiquement parfois prôné par l’UA, ne permettrait de tabler que sur 20 ou 30 millions d’emplois en 2 décennies, le plus souvent informels. Mais en l'absence de développement industriel, on peut craindre une famine qui tuerait des centaines de millions d’africains.
 On cherche en vain l’existence en 60 ans, d’un vrai projet qui aurait été susceptible d’industrialiser l’Afrique subsaharienne. Malgré près de 2 000 milliards de dollars d’Aide publique au développement (APD) confiés par les contribuables occidentaux aux agences de développement et États africains, il n'y a pas eu d'industrialisation. Le Plan de Lagos écrit sous la houlette des Nations Unies en avril 1980 et signé par l'Organisation de l'unité africaine (OUA), indigent et bâclé, a été rapidement abandonné. 33 ans plus tard, l'Agenda pour 2063 de l’Union africaine (UA) était créé mais reste au point mort. Celui-ci est devenu depuis 2015, un fac-similé des Objectifs durables de développement (ODD) pensés par l'ONU et le GIEC. Ils régentent et empêchent souvent l'émergence d'une industrie manufacturiére des biens de consommation. Dogmatisme, malthusianisme vert ? Que répondront dans quelques années, ces institutions dont UA, BAD, UE, AFD, ONU, GIEC etc. aux 2 ou 3 milliards d’africains qui les accuseront d'avoir mené une politique en partie responsable d'un chaos humanitaire jamais vu ?
On cherche en vain l’existence en 60 ans, d’un vrai projet qui aurait été susceptible d’industrialiser l’Afrique subsaharienne. Malgré près de 2 000 milliards de dollars d’Aide publique au développement (APD) confiés par les contribuables occidentaux aux agences de développement et États africains, il n'y a pas eu d'industrialisation. Le Plan de Lagos écrit sous la houlette des Nations Unies en avril 1980 et signé par l'Organisation de l'unité africaine (OUA), indigent et bâclé, a été rapidement abandonné. 33 ans plus tard, l'Agenda pour 2063 de l’Union africaine (UA) était créé mais reste au point mort. Celui-ci est devenu depuis 2015, un fac-similé des Objectifs durables de développement (ODD) pensés par l'ONU et le GIEC. Ils régentent et empêchent souvent l'émergence d'une industrie manufacturiére des biens de consommation. Dogmatisme, malthusianisme vert ? Que répondront dans quelques années, ces institutions dont UA, BAD, UE, AFD, ONU, GIEC etc. aux 2 ou 3 milliards d’africains qui les accuseront d'avoir mené une politique en partie responsable d'un chaos humanitaire jamais vu ?
Seule l’industrialisation est de nature à générer le niveau de croissance annuel entre 7 à 12 % indispensable pendant 2 décennies pour créer des centaines de millions d’emplois non informels. L’évolution sociétale induirait une baisse de la démographie et un chaos humanitaire pourrait être évité. Structuré et pragmatique mais aussi d'envergure et de nature à favoriser le developpement d'entreprises locales et le recul de la pauvreté dans les populations, le "Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans" est très certainement en 6 décennies, le 1er projet crédible d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne. Francis Journot, le 12/02/2023
Il est crucial que les entreprises subsahariennes plébiscitent le seul programme volontaire et sérieux d'industrialisation

Il est maintenant indispensable que nous démontrions aux investisseurs, institutions financières publiques ou privées mais aussi groupes industriels internationaux, que de nombreuses entreprises d'Afrique subsaharienne sont volontaires et attendent impatiemment la mise en œuvre du "Programme pour l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne en moins de 20 ans".
Le scénario en 2040 d’une Afrique subsaharienne qui s’industrialise, profite de 30 glorieuses et devient un nouvel Eldorado
 AFP - Le Sommet industriel africain (SIA) s'est tenu à Dakar les lundi 6 et mardi 7 décembre 2040 - L'Union Africaine (UA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) comptent parmi les principaux partenaires du programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans depuis sa mise en oeuvre en mai 2024 et se sont félicitées de cette réussite. Selon leur communiqué, les nouveaux échanges, l’activité intérieure avec la multiplication des entreprises, une économie moins informelle et la consommation, ont généré une forte croissance dès 2030. Depuis, la région enregistre un recul constant de l’extrême pauvreté et de la malnutrition. L’instauration d’un salaire minimum régional de production a réduit des conditions de travail proches de l’esclavage. L’implication massive des femmes dont le rôle s'est donc avére déterminant pour l'’économie subsaharienne, a fait chuter le nombre de naissances. Aussi, le choc démographique et humanitaire que la Banque Mondiale avait prédit, ne se produit pas. Les procédés de dessalement de l’eau de mer permettent plus d’accès à l’eau potable. Ces institutions estiment que les prévisions climatiques apocalyptiques ne se sont pas realisées et réaffirment leur volonté de voir des centrales nucléaires remplacer des énergies fossiles. La croissance subsaharienne atteint 12 % en 2040 et augmente le PIB/ habitant dans une Afrique prospère.
AFP - Le Sommet industriel africain (SIA) s'est tenu à Dakar les lundi 6 et mardi 7 décembre 2040 - L'Union Africaine (UA) et la Banque Africaine de Développement (BAD) comptent parmi les principaux partenaires du programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans depuis sa mise en oeuvre en mai 2024 et se sont félicitées de cette réussite. Selon leur communiqué, les nouveaux échanges, l’activité intérieure avec la multiplication des entreprises, une économie moins informelle et la consommation, ont généré une forte croissance dès 2030. Depuis, la région enregistre un recul constant de l’extrême pauvreté et de la malnutrition. L’instauration d’un salaire minimum régional de production a réduit des conditions de travail proches de l’esclavage. L’implication massive des femmes dont le rôle s'est donc avére déterminant pour l'’économie subsaharienne, a fait chuter le nombre de naissances. Aussi, le choc démographique et humanitaire que la Banque Mondiale avait prédit, ne se produit pas. Les procédés de dessalement de l’eau de mer permettent plus d’accès à l’eau potable. Ces institutions estiment que les prévisions climatiques apocalyptiques ne se sont pas realisées et réaffirment leur volonté de voir des centrales nucléaires remplacer des énergies fossiles. La croissance subsaharienne atteint 12 % en 2040 et augmente le PIB/ habitant dans une Afrique prospère.

États-Unis d’Afrique Subsaharienne (EUAS) - United States of Sub-Saharan Africa (USSA)

La création d’une communauté économique homogène d’Etats d’Afrique subsaharienne confrontés à de mêmes problématiques démographiques et de malnutrition, pourrait s'avérer pertinente. Plus économiquement opérationnelle et exécutive que politique et administrative, celle-ci doit aussi avoir l'ambition de s’exonérer d’idéologies pour mieux concilier les impératifs que sont la préservation de l’environnement et l'indispensable industrialisation qui modernisera la région et fera reculer l'extrême pauvreté. Publié le mercredi 26 mars 2025
Etats-Unis d'Afrique Subsaharienne (EUAS) & Programme pour l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne

Suppression d’aide publique au développement :
il faudra que le financement soit surtout privé pour l’économie et public pour l’humanitaire
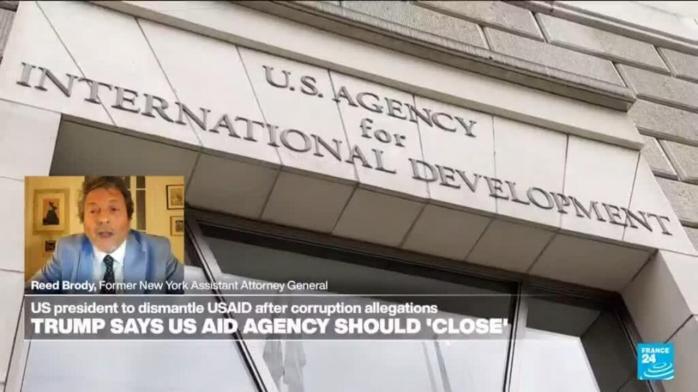
Compte tenu de la suspension de l’aide américaine (USAID) et de la baisse de subventions de l’UE, l’aide publique au développement (APD) devra recentrer son action sur les missions de santé et d’éducation pour céder au privé, la charge plus complexe du développement économique de pays en demande.
Plus de 50 milliards d’euros de baisse de subventions en Afrique au cours des années à venir
Le président Donald Trump a annoncé le démantèlement de l’USAID peu après son investiture. L’absence des ministres américains Marco Rubio et Scott Bessent, respectivement ministre des Affaires étrangères et secrétaire au Trésor, au G20 en février en Afrique du Sud et au somment qui réunissait 530 banques de développement, semble confirmer le désengagement. Mais le premier contributeur mondial qui a dépensé 63.6 milliards de dollars en 2023 n’est pas le seul pays à vouloir réduire son aide publique au développement. La France, l’Allemagne, la Suède, les Pays bas et la Finlande ont diminué leurs budgets d’ADP et pourraient être rejoints par d’autres pays. L’APD collective de l'UE qui atteignait 95,9 milliards d'euros en 2023, pourrait être amputée de 30 à 40 % au cours de années à venir. En Afrique, la suppression de l’USAID représenterait une perte de 20 milliards de dollars de subventions à laquelle s’ajouterait donc plus de 30 milliards d’euros de baisse d’aide européenne.
Vers la fin d’une époque et d’un modèle qui s’appuyait sur la prospérité occidentale
L’UE déplore une croissance atone de 0.8 % sur l’année 2024. Les 30 glorieuses ont pris fin il y a un ½ siècle et la prospérité occidentale de pays réputés riches n’est plus qu’un souvenir. Les populations d’Europe sont maintenant confrontées à des difficultés croissantes : inflation, coûts de l’énergie et du travail qui impactent l’industrie, chômage, recul des services publics et crise du logement avec des centaines de milliers d’enfants, femmes et hommes sans-abri qui dorment chaque nuit dans les froides rues de capitales européennes. Les gouvernements de pays endettés et surveillés de près par le FMI et les agences de notation mais continuant à vivre au-dessus de leurs moyens, devront faire des choix. Aussi est-il peu probable, face au taux de pauvreté qui augmente et au pouvoir d’achat qui recule, que les pays de l’UE (Union européenne) puissent revenir prochainement au niveau antérieur d’APD.
Il faut du privé pour l’économie et du public pour la solidarité
ONG et agences d’aide publique au développement (APD) souhaitent maintenir le modèle actuel et avancent souvent l’argument selon lequel le secteur privé ne peut remplacer le secteur public. Mais par définition, l’aide publique au développement aurait dû être transitoire. S’ils avaient été bien utilisés, les 1 500 milliards de dollars de subventions versés en 60 ans en Afrique subsaharienne auraient permis d’industrialiser et de moderniser les économies de pays capables ensuite d’organiser eux-mêmes et souverainement leurs sociétés et leurs services publics de santé et d’éducation.
Au regard d’un statut public inapproprié et d’une conception idéologique de l’économie, des agences publiques comme l’agence française de développement (AFD), ne peuvent penser et appliquer des schémas d’industrialisation de nature à générer un important développement de pays pauvres. Leur travail devrait maintenant surtout se limiter à des partenariats dans le domaine agricole pour lutter contre la malnutrition, à l’éducation d’enfants et autres actions sanitaires mais sous la tutelle de Bercy.
Après des dizaines d’années perdues et des sommes colossales gaspillées, il faut séparer les deux missions. Aujourd’hui mal nommée, l’aide publique au développement (APD) deviendrait l’aide publique internationale (API) et l’activité du privé revêtirait progressivement la forme de programmes d’industrialisation régionaux structurés et rigoureux quant à la gestion des capitaux. Le programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne et son fonds initieront ce nouveau paradigme.
La réforme doit être une priorité car l’explosion démographique en cours favorise la malnutrition et des conflits au milieu d’une population subsaharienne qui comptera 90 % de l’extrême-pauvreté mondiale en 2030 et 2 milliards d’habitants en 2050. Sans développement significatif au cours des 20 prochaines années, on pourrait craindre un chaos humanitaire qui bouleverserait le monde.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Il faut remplacer une aide publique au développement dispendieuse par un modèle privé efficient
La contribution française à l’aide publique au développement (APD) avoisinait 12 à 15 Mrds d’euros lors des dernières années avec une part de dons dans l’aide bilatérale et multilatérale proche de 80 % à laquelle il convient d’ajouter les remises de dettes de prêts. Mais quand la dette française explose, que des services publics sont à l’agonie et que la pauvreté augmente considérablement, la politique d’APD confiée à Agence française de développement (AFD) peut choquer. Aussi faut-il penser un modèle privé capable de mettra fin progressivement à une gabegie d’argent public.

Nouveau siège de l’Agence Française de Développement (AFD) de 50 000 m2 près de la gare d’Austerlitz pour un prix de revient de 18 500 € le m2 de bureau

Pour comparaison, l'emblématique siège de l’ONU à New York qui regroupe l’essentiel des institutions et représente 193 pays, compte 72 000 m2
Une politique d’aide publique au développement (APD) très critiquée depuis 60 ans
Sans toutefois proposer d’alternative autre que sa suppression, des personnalités de tous bords politiques ont dénoncé pendant 6 décennies, l’inefficacité de l’APD. Avant notre sondage réalisé par Opinionway en 2024 qui révélait que 60 % de français contre 38 % pensaient qu’il fallait changer de modèle et notre article dans la Tribune Afrique en 2020 qui préconisait « Le capitalisme pourrait réussir là où l’aide au développement échoue depuis 60 ans », l’agronome René Dumont en 1962 puis les économistes Jean-François Gabas en 1988, Jeffrey Sachs en 1990, William Easterly en 2001 et Dambisa Moyo en 2009 qui blâmaient la méthode. En 2000, le journal Libération publiait l’économiste Stephen Smith « La France saupoudre son aide au développement. Un rapport de l'OCDE critique la dispersion des fonds » et dans le Monde, l’ancien diplomate Laurent Bigot écrivait en 2015 : « L’aide publique au développement n’aide pas l’Afrique ». « L’APD est un business qui fait vivre des dizaines de milliers de fonctionnaires internationaux et nationaux mais aussi une myriade de consultants. Ils ont tous en commun un objectif : ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis et sur laquelle ils vivent grassement. ». L’éditorialiste Jacques Hubert-Rodier prévenait aussi en 2017 dans Les Echos : « L’Afrique doit sortir de l’aide publique au développement ». Par ailleurs, beaucoup d’africains jugent la politique actuelle d’aide publique au développement, néo-colonialiste et humiliante.
Les budgets de l’aide publique au développement votés ces dernières années
Voté par le parlement, le budget de l’aide publique au développement était de 10.3 milliards d’euros en 2018 (0,43% du revenu national brut) puis atteignait 15.1 milliards d’euros en 2022 (0,56 % du RNB) et visait un objectif de 0,7 % du RNB en 2025 inscrit dans la loi de programmation d’août 2021 soit plus de 20 milliards d’euros. L'APD française reculait ensuite à 13,9 milliards d'euros (0.48 % du RNB) en 2023 puis diminuait encore dans les budgets de 2024 et 2025 (0.45 % du RNB). Mais l’objectif de 0.7 % du RNB en 2030 demeure. La part de dons dans l’aide publique au développement bilatérale avoisinait 80 % au cours des dernières années et dépassait 85 % en 2024 hors remises de dettes de prêts.
Les baisses de budgets américains et européens d’APD obligent à penser un autre modèle
Le président Donald Trump a annoncé la fin de l’USAID dès son investiture. L’absence des ministres américains Marco Rubio et Scott Bessent, respectivement ministre des Affaires étrangères et secrétaire au Trésor, au G20 en février en Afrique du Sud et au somment qui réunissait 530 banques de développement, semble confirmer le désengagement. Mais le premier contributeur mondial qui a dépensé 63.6 milliards de dollars en 2023 n’est pas le seul pays à vouloir réduire son aide publique au développement. La France, l’Allemagne, la Suède, les Pays bas et la Finlande ont diminué leurs budgets d’ADP et pourraient être rejoints par d’autres pays. L’APD collective de l'UE qui atteignait 95,9 milliards d'euros en 2023, pourrait être amputée de 30 à 40 % au cours de années à venir. En Afrique, la suppression de l’USAID représenterait une perte de 20 milliards de dollars de subventions à laquelle s’ajouterait plus de 30 milliards d’euros de baisse d’aide européenne.
L’APD échoue depuis 60 ans dans sa mission qui aurait dû procurer une amélioration des conditions de vie et d’autres perspectives que l’immigration. Aussi faut-il la remplacer rapidement par un paradigme plus efficace car l’explosion démographique en cours favorise la malnutrition et des conflits au milieu d’une population subsaharienne qui comptera 90 % de l’extrême-pauvreté mondiale en 2030 et passera de 2 milliards d’habitants en 2050 à 4 en 2100. Sans développement significatif au cours des 20 prochaines années, on pourrait craindre un chaos humanitaire inédit qui bouleverserait le monde.
Un fonds associé à un programme précis et structuré pour éviter la déperdition d’argent public
Peut-être est-il temps de mettre en œuvre un nouveau modèle. La dotation annuelle d’APD bilatérale et multilatérale fournie par les 32 pays du Comité d'aide au développement (CAD) de l’OCDE s’élevait à 224 milliards de dollars en 2023 et le montant des prêts ou dons promis au pays en développement dans le cadre de la COP 29 atteignait 300 milliards de dollars annuels. Il est certain que les pays donateurs qui distribuent, généralement à fonds perdus, l’argent public de leurs contribuables, préfèreraient que leurs capitaux soient préservés et rémunérés par un fonds dédié à un objectif déterminé et structuré comme notre programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne. Les montants placés seraient déductibles de la contribution annuelle d’APD proportionnelle au revenu national brut (RNB) recommandée par l’ONU. Le plan qui favoriserait l’émergence d’entreprises locales et un recul de l’extrême pauvreté, offrirait de surcroit, d’innombrables opportunités aux entreprises françaises et européennes.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale
 L’industrialisation et les fonds privés, facteurs privilégiés de l’aide au développement en Afrique ?
L’industrialisation et les fonds privés, facteurs privilégiés de l’aide au développement en Afrique ?
C’est l’idée que défend Francis Journot, fondateur de Africa Atlantic Axis et du programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans et que confirme un sondage mené par Opinion Way selon lequel 60% des Français partagent cette vision. Une façon d’envisager les liens entre les deux continents qui est surtout un changement de paradigme. Avec les opportunités et les limites que cela sous-tend. Par Laurence Bottero
L'industrialisation est-elle une réponse mieux adaptée aux besoins de l'Afrique pour accélérer son développement ? Oui répondent 60% des Français interrogés par Opinion Way sur la question d'une aide publique au développement qui céderait la main à des capitaux privés tournés vers l'industrialisation. Un sujet qui est loin d'être neutre pour un continent considéré comme le levier de croissance mondiale des prochaines années. L'Afrique riche de son potentiel en énergie, en innovation, en capital humain aussi, est très regardée par les investisseurs. Les besoins de Lnancement des infrastructures, propres au développement du continent sont conséquents, à la hauteur des enjeux. Ainsi, la Banque africaine de développement (BAD) a-t-elle injecté 44 milliards de dollars en 7 ans, dédiés aux routes, aéroports, ponts et autres projets ferroviaires. La Banque mondiale, elle, chiffre à 2.400 milliards de dollars par an les besoins des pays africains pour faire face, entre autres, aux défis climatiques
![]()
Selon vous, faut-il remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation davantage financé par des capitaux privés ?
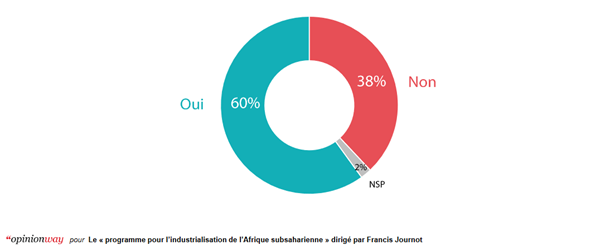
Ne pas omettre d'étapes
De son côté, la France a consacré en 2022 un budget à l'aide publique au développement pour le monde de l'ordre de 15,9 milliards d'euros. Le 22 février dernier, le gouvernement français a oXcialisé par décret une coupe de 742 millions d'euros dans cette aide publique. Ce qui est de nature à contrarier certains acteurs dont les ONG. Mais l'aide publique n'est pas la seule voie estime Francis Journot. Fondateur de Africa Atlantic Axis, il a développé un programme qui vise l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne en moins de 20 ans. Une approche qui vient donc en résonnance avec une aide publique qui, selon lui, n'est pas la bonne réponse aux besoins de cette partie du continent. « Tout est à faire », assure Francis Journot qui voit, par ailleurs, d'un œil assez critique, les tentatives de réindustrualisation en France, estimant que lorsque la désindustrialisation est opérée, il est quasi-impossible de faire machine arrière. Un phénomène qu'il convient de ne pas reproduire donc, justement en ne refaisant pas les erreurs qui ont conduit l'Europe à se battre désormais pour reconstruire son tissu industriel. Francis Journot qui se place du côté de ceux qui plaident pour un développement de l'industrie qui se fait en respectant chaque étape et en n'omettant aucunes d'elles. Les différentes phases d'industrialisation qui sont, dit-il, nécessaire à la montée en puissance des compétences comme du tissu industriel. Passer directement à la case industrie 4.0 ? Surtout pas
« Il est indispensable de passer par les différentes étapes. Cela n'est pas équitable sinon et amènerait à produire des inégalités. Si on supprime une étape, les seules bénéLciaires seraient les startups, ceux qui disposent déjà d'une compétence numérique ». Francis Journot qui, de la même façon, pointe les objectifs de développement durable de l'ONU, les ODD précieusement regardés par de nombreux acteurs africains qui tendent à y correspondre et à y répondre. « Ces objectifs amènent l'Afrique à se priver d'une partie de ses réserves », afirme-t-il
Du besoin de créer des écosystèmes
Ce qui « importe alors c'est d'avoir un programme cadre, suffisamment large », pour n'oublier personne. « Le programme d'industrialisation doit fédérer toute l'Afrique », plaide encore Francis Journot, « pour construire une industrie, il faut créer des écosystèmes », ce qui signifie aussi répondre aux besoins en ressources humaines et donc, entre autres, en formation. Une formation qui doit prendre la forme de cycles courts pour embarquer autour des projets et répondre, vite, à ces derniers.
Mais quels segments industriels choisir ? Existe-t-il des secteurs dont il faudrait privilégier le développement et le déploiement ? DiXcile aujourd'hui d'en distinguer certains plutôt que d'autres, « le projet cadre compte avant tout et il est prématuré de rentrer trop dans le détail. Cependant, pour être exact, la nature des industries qui s'implanteront, dépendra surtout des grands donneurs d'ordres internationaux que nous parviendrons à convaincre car ce sont eux qui détiennent technologies, brevets, savoir-faire et marques de commercialisation », note le dirigeant de Africa Atlantic Axis. L'agenda 2063 de l'Union Africaine ne favorise-t-elle pas cette industrialisation souhaitée ? Non, répond Francis Journot, estimant qu'il s'agit davantage de bonnes intentions plutôt qu'une « réelle volonté industrielle ». Quant à l'investissement, c'est là où une partie des fonds privés doit venir suppléer voire supplanter les aides publiques. Des fonds à la vision long termiste autant que possible et géographiquement étendus aussi pour venir nourrir les immenses besoins et l'appétit de croissance. Si changer de paradigme n'est jamais chose aisée, l'Afrique dispose d'un potentiel qui lui donne les moyens d'être ambitieuse. Et l'Afrique est plus que jamais un partenaire de l'Europe qu'il faut privilégier;
Laurence Bottero
 Sondage : Comme beaucoup d’africains, 60 % des français estiment qu’il faut changer de politique d’aide au développement
Sondage : Comme beaucoup d’africains, 60 % des français estiment qu’il faut changer de politique d’aide au développement
L’Afrique subsaharienne juge souvent que la politique d’aide publique au développement (APD) dite post-coloniale, menée depuis 60 ans, est inefficace et condescendante. Compte tenu d’un risque de choc démographique et humanitaire qui pourrait affecter la région subsaharienne au cours des années ou décennies à venir, peut-être est-il urgent de penser un modèle plus efficient.
Un programme concret d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne réalisé avec de grands acteurs industriels mondiaux et financé par des fonds privés pourrait permettre d’amorcer une industrialisation significative et de construire les infrastructures indispensables. Ce modèle de croissance inclusive générerait à terme la création de nombreuses entreprises locales et les centaines de millions d’emplois dont la Banque mondiale à récemment souligné la carence.
Puisque la France compte parmi les plus gros donateurs d’aide publique au développement et partage depuis longtemps une relation particulière avec l’Afrique, le «Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » a chargé l’institut d’études OpinionWay d’interroger les français.
![]()
Selon vous, faut-il remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation davantage financé par des capitaux privés ?
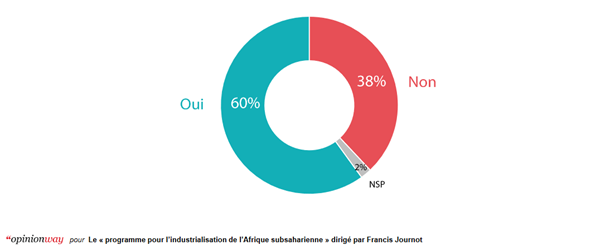
Ainsi le sondage révèle que 60% des Français estiment qu’il faut remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation concret et davantage financé par des capitaux privés.
Ce modèle de capitalisme inclusif pourrait permettre d’éviter un chaos humanitaire annoncé
La politique d’APD n’a pas permis d’industrialiser ni de développer suffisamment la région ni de juguler l’immigration économique vers l’UE. Celle fuyant l’Afrique de l’ouest a augmenté de 541 % au cours de 2 premiers mois de 2024. Selon la Banque mondiale, « les prévisions pour 2030, indiquent que 9 personnes vivant dans l'extrême pauvreté sur 10 vivront en Afrique subsaharienne. » et les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin ». Avec 2.1 milliards d’habitants en 2050 en Afrique subsaharienne puis 4 en 2100, des centaines de millions d’habitants pourraient succomber à la faim ou devraient s’exiler.
Selon nos simulations, l’Afrique subsaharienne a besoin d’une croissance annuelle de 8 et 12 % pendant 2 décennies
Populaire auprès de populations et entrepreneurs africains mais aussi de la diaspora et d’une majorité de français, le « Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » pourrait convaincre des leaders industriels mondiaux de transférer une part de leur production vers l’Afrique subsaharienne. Beaucoup d’entreprises locales verraient le jour et constitueraient de nouveaux écosystèmes. Une gestion scrupuleuse du fonds dédié permettrait de rémunérer les capitaux. L’industrialisation pourrait procurer le niveau de croissance annuel entre 8 et 12 % pendant 2 décennies et les centaines de millions d’emplois non informels dont l’Afrique subsaharienne a besoin. L’évolution sociétale induirait une baisse de la démographie et une catastrophe humanitaire pourrait être évitée. Ce changement de paradigme profiterait aussi aux entreprises et pays européens.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

L’Afrique subsaharienne peut s’affranchir d’une politique d’aide publique au développement (APD) qui n’a pas réussi à l’industrialiser
La politique d’aide publique au développement (APD) est inefficace en Afrique subsaharienne. Mais un programme d’industrialisation cohérent et doté d’un fonds d’investissement privé, pourrait la remplacer progressivement et ainsi favoriser enfin un développement rapide de la région.
Absence de volonté de développement de l’Afrique subsaharienne ?
L’inefficience de l’aide publique au développement est dénoncée depuis 6 décennies et l’OCDE a aussi pointé du doigt, son saupoudrage et sa dispersion. Déjà, l’agronome René Dumont dans les années 60, les économistes Jean-François Gabas en 1988, Jeffrey Sachs en 1990, William Easterly en 2001 ou Dambisa Moyo en 2009, s’interrogeaient à propos de la méthode de l’APD. En 2015, dans l’article « L’aide publique au développement n’aide pas l’Afrique » publié dans Le Monde Afrique, l’ancien diplomate Laurent Bigot écrivait : « L’APD est un business qui fait vivre des dizaines de milliers de fonctionnaires internationaux et nationaux mais aussi une myriade de consultants. Ils ont tous en commun un objectif : ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis et sur laquelle ils vivent grassement. ». « C’est l’argent de personne. Les bailleurs sortent pourtant ces sommes de la poche de leurs contribuables mais n’ont aucune exigence sur l’utilisation. ».
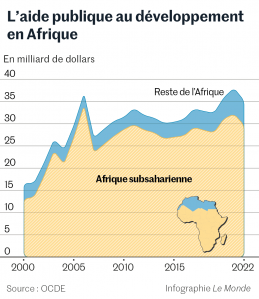
Mais ce modèle perdure et les Objectifs de développement durable (ODD) imposés par l’ONU depuis 2015, continuent d’aller à l’encontre de l’industrialisation et du développement de l’Afrique subsaharienne. En édictant une politique dogmatique suivie par des États et organismes africains, les institutions internationales jouent avec le feu. L’extrême pauvreté et la malnutrition associées à l’explosion démographique en cours, favorisent une montée du terrorisme et de l’instabilité politique. Elles génèrent aujourd’hui immigration massive vers l’UE et drames humains dans la méditerranée.
Il est maintenant urgent de changer de paradigme
Selon la Banque mondiale, les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin ». Aussi les prévisions démographiques et indices de pauvreté de l’Afrique subsaharienne font craindre avant 20 ou 30 ans, un chaos humanitaire d’une telle ampleur qu’il serait ingérable. Aussi l’Afrique Subsaharienne doit se développer très rapidement. Mais lorsqu’on sait que l’industrialisation européenne a nécessité plusieurs siècles de savoir-faire et que la Chine a bénéficié de l’aide occidentale sans laquelle elle figurerait encore parmi les pays les plus pauvres, il apparait alors évident que l’Afrique subsaharienne ne pourra pas s’industrialiser de façon autonome en quelques années.
Les annonces d’investissement de milliards d’euros dans de multiples projets sans cohérence d’ensemble, se succèdent au cours d’innombrables forums africains ou internationaux mais sans une méthodologie efficiente, les capitaux ne viendront pas ou seront le plus souvent gaspillés. Pour exemple, l’Agenda Africain pour 2063 de l’Union Africaine (UA) n’a jamais décollé depuis 10 ans à l’instar du Plan de Lagos de 1980 de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) qui s’était aussi enlisé. Même en l’hypothèse très improbable où le plan de l’UA produirait des résultats à l’approche de 2063, combien de centaines de millions d’africains, d’ici cet horizon, subiront l’extrême pauvreté ou succomberont à la faim ? Les jeunes entrepreneurs qui ont aujourd’hui 35 ou 40 ans, auront vieilli de 40 années et seront alors âgés de 75 ou 80 ans ! Les objectifs sont lointains alors que le temps presse.
Un fonds privé qui abonderait le programme au lieu d’une APD financée par des contribuables
Le fonds d’investissement dédié au « programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » servirait, à moyen et long terme, une rémunération des capitaux qui certes, ne rivaliserait pas avec celle des produits financiers les plus performants mais séduirait néanmoins des pays, investisseurs institutionnels et privés soucieux d’afficher des valeurs de RSE et d’inclusivité tout en préservant leurs investissements dans un fonds à la gestion sérieuse et prudente. Ainsi que mon dernier article dans la Tribune Afrique l’expliquait, « Pour amorcer la réussite de l'Afrique subsaharienne, il faut un programme d’industrialisation de 1 000 milliards d'euros en 20 ans ». Le montant qui peut sembler considérable, doit être à la hauteur du défi en termes d’emplois mais aussi en matière de fourniture de biens de consommation nécessaires pour une population subsaharienne dont le nombre devrait atteindre 2 milliards d’habitants en 2050 et 4 en 2100.
Il sera pour cela indispensable que la création des nouveaux outils de production industrielle ou agricole financés, ne soit guère anarchique et s’inscrive dans un processus encadré. Ainsi, les productions qui constitueront des écosystèmes locaux complets ou s’inséreront dans des chaines de valeur mondiales, permettront de multiplier les effets positifs de chaque euro investi. Pour dégager les marges bénéficiaires suffisantes qui participeront de la viabilité du fonds, Il faudra, de la production à la commercialisation, souvent user d’un modèle économique d’intégration verticale. Compte tenu de l’ampleur de la tâche et afin de renforcer le fonds en attendant que le programme produise ses effets, Il nous faudra néanmoins aussi intégrer des placements externes.
D’États africains dépendants et pauvres à partenaires économiques prospères
Aujourd’hui, bon nombre d’africains jugent que le recours à l’Aide au développement, renvoie au monde, une image de pays assistés qui décrédibilise ses forces vives. Mais à l’inverse, car la différence est fondamentale, la relation entretenue avec les Etats africains dans le cadre de la mission coordonnée du cabinet de gestion, du programme et de son fonds, s’apparentera à un rapport entre partenaires ou, bien que le financement provienne souvent d’investisseurs extérieurs, de prestataire avec des clients.
L’Afrique subsaharienne est plurielle et il faut un paradigme qui fédère ses populations. Il permettrait de rompre progressivement avec un modèle d’APD, qui, bien qu’ayant bénéficié de 2000 milliards de dollars en 60 ans, est dépassé et ne profite qu’a quelques-uns tandis que de nombreux autres restent dans l’extrême pauvreté et continuent de lutter contre la faim. Aussi s’avère-il certain, après les projets idéologiques écrits par des institutions internationales, que notre programme qui s’adresse davantage aux entrepreneurs africains volontaires et aux populations, constitue le premier vrai projet d’envergure et crédible. Il faut maintenant que l’Afrique subsaharienne le fasse sien en le plébiscitant.
Francis Journot est consultant et entrepreneur. Il dirige le Programme industrialisation Afrique subsaharienne ainsi que le Plan de régionalisation de production Europe Afrique et Africa Atlantic Axis. Il fait de la recherche dans le cadre d’International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale
60% des Français estiment qu’il faut remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation concret et davantage financé par des capitaux privés.
![]()
Selon vous, faut-il remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation davantage financé par des capitaux privés ?
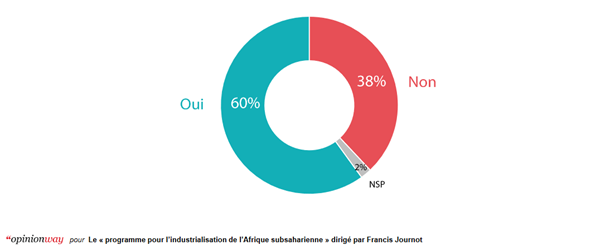
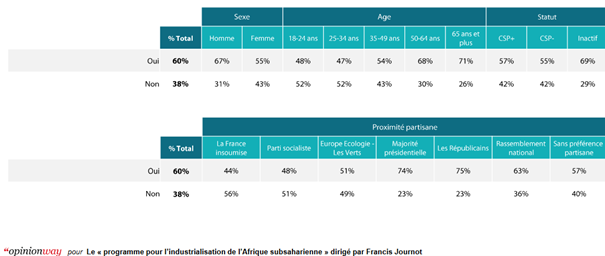
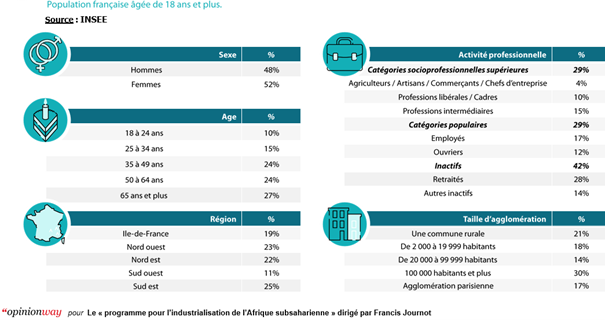

L’analyse de l’institut de sondage opinionwway
Avec une contribution de 15,9 milliards de dollars en 2022, la France compte parmi les premiers donateurs d’aide publique au développement dans le monde et le montant annuel total versé par la communauté mondiale à des pays d’Afrique subsaharienne, est proche de 30 milliards de dollars (Source OCDE). Interrogés sur l’hypothèse d’un remplacement des aides publiques par un programme d’industrialisation plus ouvert aux capitaux privés, une majorité des interviewés exprime son soutien.
60 % des français sont favorables à ce changement de paradigme, contre 38% ne souhaitant pas voir l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne être remplacée par des programmes davantage financés par des fonds privés. Le soutien à cette proposition est minoritaire chez les jeunes générations (47% des moins de 35 ans contre 52% qui s’y opposent). Mais il s’accroit chez les générations plus âgées : 54% chez les personnes âgées de 35 à 49 ans, 68% chez les 50-64 ans et 71% pour les séniors âgés de 65 ans et plus.
Quel que soit le niveau de revenus, une majorité des français se prononce en faveur d’un remplacement des aides publiques au développement par un programme donnant une plus grande place au secteur privé. Le soutien est tout de même plus fort dans les foyers les plus aisés financièrement. Il s’établit à 56% parmi les français dont le foyer gagne moins de 1 000 € par mois et grimpe à 69% au sein des foyers gagnant 3 500€ net par mois ou plus. Les préférences politiques constituent le critère produisant les différences les plus importantes sur la question posée.
Le soutien à la mesure proposée est particulièrement fort auprès des sympathisants de la majorité présidentielle (74%) et des républicains (75%). Il reste également nettement majoritaire chez ceux du Rassemblement national (63%) et parmi les français n’exprimant aucune préférence partisane (57%). L’opinion sur la mesure est moins positive chez les sympathisants de gauche, souvent plus attachés aux programmes publics. Mais une proportion importante d’entre eux sont favorables à la mesure : c’est le cas de 44% des sympathisants insoumis, 48% des socialistes et même 51% des écologistes.
 Il faut un programme d’industrialisation de 1 000 milliards d’euros sur 20 ans pour éviter un chaos humain en Afrique subsaharienne
Il faut un programme d’industrialisation de 1 000 milliards d’euros sur 20 ans pour éviter un chaos humain en Afrique subsaharienne
Selon la Banque mondiale, les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin » alors que la population subsaharienne pourrait compter 2 milliards d’habitants en 2050 et doubler en 2100. Aussi faut-il un programme doté d’un fonds privé à la hauteur du défi afin d’éviter le pire.
Comment un programme d’industrialisation de 1 000 Mrds d’euros sur 20 ans pourrait être mis en œuvre
Après plusieurs années de recherche économique et financière ainsi qu’une vingtaine d’articles publiés dans la presse, le programme pour l’industrialisation de l’Afrique Subsaharienne en moine de 20 ans semble, en matière de développement de l’Afrique subsaharienne, s’imposer en tant que principale proposition crédible face à la politique d’’Aide publique au développement (APD) qui a échoué ou à l’Agenda 2063 de l’UA qui n’a guère progressé. Le programme se déclinerait ainsi :
300 milliards d’euros pour créer 100 zones d’activités industrielles et commerciales modernes de diverses tailles, évolutives et sécurisées, reparties dans une quarantaine de pays dont les occupants, entreprises étrangères ou locales s’acquitteront ensuite des loyers et services auprès du fonds de gestion. Afin de construire des lieux de vie, autonomes et moins énergivores, des activités agricoles dans des périmètres de seulement quelques dizaines de kilomètres, complèteront ces écosystèmes.
400 milliards d’euros pour des prêts aux entreprises locales et étrangères et participations dans des projets à haut potentiel. Il nous faudra néanmoins, adosser le fonds à des investissements extérieurs et mécanismes de compensation pour satisfaire à des impératifs de rentabilité et de stabilité.
300 milliards d’euros pour ériger 100 villes nouvelles écologiques, peu distantes des 100 zones d’activités industrielles et commerciales. Elles accueilleront à terme, 150/200 millions d’habitants dont familles de travailleurs qui bénéficieront d’infrastructures d’énergies, transport, éducation, santé etc.
Un fonds d’investissement dédié et répondant à des règles de gestion sérieuse et prudente
Pays donateurs d’aide publique au développement (APD) ainsi qu’investisseurs institutionnels et privés pourraient considérer la potentielle efficience d’un capitalisme intelligent et abonder le fonds dédié au Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans.
Ce nouveau mode de contribution au développement servirait une rémunération des fonds investis chaque an et son mécanisme financier favoriserait un essor rapide de la région subsaharienne. Certes, la rémunération des capitaux ne rivaliserait pas avec celle des produits financiers les plus performants mais séduirait néanmoins des investisseurs soucieux d’afficher des valeurs de RSE et d’inclusivité tout en préservant leurs investissements dans un fonds à la gestion sérieuse et prudente.
La création des nouveaux outils de production industrielle ou agricole financés, ne serait guère anarchique et s’inscrirait dans un processus encadré. Ainsi, les productions qui constitueront des écosystèmes locaux complets ou s’inséreront dans des chaines de valeur mondiales, multiplieront les effets positifs de chaque euro investi. Pour dégager les marges bénéficiaires suffisantes qui participeront de la viabilité du fonds, nous userons souvent, de la production à la commercialisation, d’un modèle économique d’intégration verticale qui valorisera mieux des richesses locales. Nous devrons parfois intégrer des placements externes en attendant que le programme produise ses effets.
Il est crucial que l’Afrique subsaharienne soutienne ce projet d’intérêt général pour les populations
Aussi faut-il que l’Afrique subsaharienne se mobilise en faveur de ce projet d’intérêt général pour les populations Il pourrait s’avérer à la hauteur du challenge en termes d’emplois mais aussi en matière de fourniture de biens de consommation nécessaires. Nos propositions sont bienveillamment accueillies par un nombre croissant de subsahariens et membres de la diaspora. Un plébiscite du programme et une implication des entrepreneurs africains, seront de nature à convaincre davantage de pays, d’investisseurs institutionnels et privés ainsi que de grandes entreprises internationales, de s’associer à cet ambitieux et noble défi pour l’Afrique subsaharienne.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Immigration : La France et l’UE seront de plus en plus débordées si elles ne changent pas l’aide au développement de l’Afrique subsaharienne

L'explosion démographique africaine génère de la pauvreté et un exil croissant vers l’UE. Mais derrière le rêve européen, la France et d’autres pays de l’UE, déplorent une croissance atone ainsi qu’un manque d’emplois et de logements pour accueillir les migrants. Aussi est-il temps de remplacer un modèle d’aide au développement (APD) de l’Afrique subsaharienne qui échoue depuis 60 ans.
Une politique migratoire prétendument humaniste qui déracine, précarise et tue
De nombreuses ONG et institutions subventionnées ainsi que des personnalités politiques qui militent pour une immigration inconditionnelle, entretiennent le leurre d’une France riche et prospère, capable d’accueillir tous les migrants et de leur procurer logement, travail, aides sociales et vie confortable.
On peut penser qu’ils sont aussi coupables que les passeurs qui procurent ensuite des embarcations mortelles ou que ceux qui précipitent les plus fragiles vers des réseaux criminels, la prostitution, la drogue et la mort. Il est permis de douter que les familles qui envoient leurs jeunes vers l’UE, sachent que ceux-ci seront souvent instrumentalisés par des ONG et erreront entre tentes des froids trottoirs parisiens et hébergements d’urgence submergés avant de sombrer dans le crack et la délinquance.
La diaspora et de nombreux entrepreneurs veulent développer l’Afrique
Prôner l’immigration en tant que seul avenir possible pour les jeunes africains en excluant ainsi des perspectives et une capacité africaine à développer le continent, relève de la condescendance voire d’une forme de racisme. Le dessein de priver l’Afrique de forces vives et de créer du sous-prolétariat dans l’UE, apparait tout aussi cynique. La diaspora et de nombreux entrepreneurs ambitieux veulent développer l’Afrique. Il faut agir en amont de l’exil de populations en leur fournissant outils et moyens adéquats.
Selon l’étude « Les français et l’aide au développement en Afrique subsaharienne » réalisée par l’institut OpinionWay pour le Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne, « 60 % des français pensent qu’il faut remplacer l’aide publique au développement de l’Afrique subsaharienne par un programme d’industrialisation davantage financé par des capitaux privés »
L’UE mène une politique hasardeuse
La politique européenne en faveur d’une immigration de travail n’a pas ensuite capacité à réguler le volume des flux d’immigration légale ou clandestine. Ainsi, plusieurs dizaines de milliers de malheureux ont déjà péri dans la méditerranée ou dans le désert du Sahara mais ceux qui franchissent ces obstacles ne bénéficient pas pour autant de l’accueil à bras ouverts que l’UE leur avaient fait espérer. L’entretien d’un rêve européen encourage une immigration exponentielle. Le nombre de migrants illégaux en provenance d’Afrique de l’ouest a augmenté de 541 % au cours de 2 premiers mois de 2024. Avec 90 % de l’extrême pauvreté mondiale concentrée en Afrique subsaharienne prévue en 2030 parmi une population qui comptera 2 milliards d’habitants en 2050, chacun comprendra que plusieurs dizaines de millions d’africains voudront chaque année s’exiler dans les pays les plus socialement protecteurs.
Mais la France que les migrants découvrent à leur arrivée, compte déjà 400 000 sans-abris, 4 millions de mal logés, 2.5 millions de demandeurs de logements sociaux, d’innombrables squats et campements sauvages etc. Au rythme des nouveaux arrivants et de la pénurie, les loyers flambent et un simple accident de la vie peut maintenant obliger des femmes, enfants et hommes parfois malades, âgés ou handicapés à dormir dans la rue et souvent succomber au froid et à la maladie. 300/500 000 migrants arrivent en France chaque année mais les systèmes de protection sociale s’affaiblissent. Les fragiles économies européennes surendettées ne peuvent intégrer qu’une faible part des exilés.
La France n’est plus le géant économique des 30 glorieuses, créateur de millions d’emplois industriels
Dans la France désindustrialisée, le déficit commercial augmente constamment. La croissance est atone et la dette atteint maintenant 3100 Mrds d’euros. Le chiffre du chômage et de son halo, des radiés et non-inscrits ou non indemnisés, NEET, allocataires du RSA etc., dépasse 10 millions. Le montant de prestations sociales en hausse constante, avoisine 800 milliards d’euros. Avec environ 1/3 du PIB et 50 % de la dépense publique, la France est le pays européen qui consacre le plus aux dépenses sociales mais des services publics sont sous l’eau. Aujourd’hui, les services sociaux accueillent souvent la 3eme génération d’allocataires au sein de familles d’origine française ou étrangère qui ont d’abord bénéficié du RMI entré en vigueur en 1988. Au lieu de reconsidérer des règles de libre-échange qui accéléraient les délocalisations, Mitterrand et son gouvernement avaient fait le choix de la désindustrialisation et de l’assistanat. La création des Restos du cœurs en 1985 symbolise une résignation à la paupérisation.
Structure démographique, chômage et inactivité, le coût sera intenable pour la France
Nul ne peut nier le bénéfice de l’immigration pendant les 30 glorieuses. Chaque poste industriel engendrait ensuite plusieurs autres emplois indirects et induits. Mais l’économie maintenant basée sur la consommation et les services souvent payés avec des aides sociales, crée peu d’emplois pérennes et rémunérateurs. Avec des secteurs primaire et secondaire qui reculent en France depuis 40 ans et un emploi tertiaire grignoté par l’IA, le nombre d’inactifs ne pourra qu’augmenter fortement. Selon l’observatoire des inégalités, les migrants africains ont un « risque près de deux fois plus élevé d’être sans emploi que les personnes sans histoire migratoire ». Il est donc certain qu’une forte part de ceux-ci grossira les rangs des 10 millions de demandeurs d’emplois et plus largement, des individus de toutes origines qui travailleront peu ou jamais.
L’augmentation du nombre d’inactifs serait probablement supérieure à 100 000/an soit 1 million de plus par décennie ou 5 en un ½ siècle. On sait, en fonction du statut familial, âge, état de santé etc., qu’un inactif, français ou étranger, peut coûter à la collectivité en fourchette basse, 12/20 000 € par an et en fourchette haute 30/50 000 €. Lorsque l’inactivité est permanente tout au long d’une existence, le coût pour la collectivité peut excéder 1.5/2.5 millions d’euros. Consommateurs des services publics, les inactifs ne génèrent pas ou ne s’acquittent pas non plus ou peu, d’une part fiscale et de cotisations sociales que l’on peut situer à plus d’un million d’euros par travailleur à l’échelle d’une vie. Chaque nouveau million d’inactifs pourrait coûter ou aggraver les déficits publics de 2 500 à 3 000 milliards d’euros sur 7/8 décennies. Aucune économie structurée ne pourrait survivre à un tel déséquilibre. Les systèmes de protection sociale voleraient en éclats. La pauvreté croissante impacterait lourdement les populations dont de récentes générations issues de l’immigration qui seraient parmi les plus exposées.
Seule un important programme d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne peut réduire l’extrême pauvreté et l’exil massif
L’absence de développement industriel n’est pas due à un manque de capitaux. Il convient plutôt de pointer l’inefficience d’une méthode en silo et d’un manque de volonté. Avec un budget de 16.9 Mrds d’euros en 2023 qui devrait passer à 21.4 Mrds en 2025 (source Sénat) dont une part importante consacrée à l’Afrique, la France est le 4eme donateur mondial d’aide publique au développement. Le montant total d’APD mondiale versée à l’Afrique subsaharienne avoisine 30 Mrds de dollars par an.
Aussi un programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans, doté d’un fonds d’investissement de 1 000 Mrds sur 2 décennies, abondé par des capitaux surtout privés mais aussi publics internationaux, pourrait réussir là où la politique mondiale d’APD échoue depuis 60 ans. Par ailleurs, le fonds pourrait rémunérer des capitaux publics aujourd’hui versés sans retour par l’État français et l’Union européenne au titre de l’aide publique au développement.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

"Notre programme d’industrialisation de 1000 milliards d’euros en 20 ans, amorcera la réussite de l’Afrique subsaharienne"
La plupart des africains ne croient plus aux promesses des gouvernements et institutions internationales. L’Agenda africain 2063 ne décolle pas. L’Aide publique au développement (APD) jugée condescendante voire post colonialiste, échoue depuis 60 ans et une pensée idéologique sclérose le développement. Tant qu’il n’y aura pas de projet global sécurisé et non dogmatique, capitaux et industries ne viendront pas. Par Francis Journot.
Un modèle de capitalisme intelligent qui réduira l’extrême pauvreté et la malnutrition
J’écrivais en 2020 dans la Tribune Afrique : "Afrique subsaharienne : le capitalisme pourrait réussir là où l’aide publique au développement (APD) échoue depuis 60 ans". Aussi, la création d’un fonds d’investissements, outil de financement et de mise en œuvre du programme, doté de 1 000 Mrds d’euros en 20 ans, abondé par la France, l’UE et des institutions financières, permettra de mener à bien le premier projet volontaire et crédible pour l’industrialisation et le développement de l’Afrique subsaharienne.
La répartition, bien que variable, des besoins en financement sur 20 ans se présenterait ainsi :
- 300 milliards d’euros pour financer la création de 100 zones d’activités industrielles et commerciales modernes de différentes tailles, évolutives et sécurisées, réparties dans une quarantaine de pays dont les occupants, entreprises étrangères ou locales s’acquitteront ensuite des loyers et services auprès du fonds de gestion. Afin de créer des lieux de vie, autonomes et moins énergivores, des activités agricoles dans des périmètres de seulement quelques dizaines de kilomètres, complèteront ces écosystèmes.
- 400 milliards seront consacrés à des prêts aux entreprises locales et étrangères ainsi qu’a des participations dans des projets à haut potentiel. Il nous faudra néanmoins, adosser le fonds à des investissements extérieurs et mécanismes de compensation pour satisfaire à des impératifs de rentabilité et de stabilité.
- 300 milliards d’euros pour ériger 100 villes nouvelles écologiques, à distances raisonnables des 100 zones d’activités industrielles et commerciales. Elles accueilleront à terme, 150/200 millions d’habitants dont familles de travailleurs qui bénéficieront d’infrastructures énergétiques, transport, éducation, santé etc.
L’une des activités déterminantes de notre cabinet de stratégie et de conduite du "Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans", consistera à aller nous-mêmes démarcher et convaincre en France et à travers le monde, schémas de process de production à la main et projections financières à l’appui, les plus grandes entreprises qui produisent aujourd’hui surtout en Chine, d’inclure l’Afrique subsaharienne dans leurs étapes de chaînes de valeur mondiales (CVM).
Le développement d’activités industrielles et commerciales qui seront de moins en moins informelles, offrira de nouvelles ressources fiscales. La capacité d’un Etat à lever de l’impôt est l’un des critères sur lesquels s’appuient les institutions financières. Aussi, les Etats pourront emprunter aux banques, au fil du développement, pour racheter des infrastructures ou investir aux côtés de notre fonds.
Le programme pourrait faire économiser à la France, plus de 1 500 milliards d’euro en 20 ans
Il est peu certain que la France ait le choix. Son destin et celui de pays d’Afrique francophone sont liés. Sans industrialisation ni développement de la région et sous le poids de la démographie subsaharienne, une immigration exponentielle qui fuira l’extrême pauvreté et la faim, submergera l’hexagone et fera voler en éclats son modèle social. Ma tribune dans Le Figaro prévenait : "Si l'Europe n'aide pas l'Afrique subsaharienne à s'industrialiser, l'immigration explosera". L’APD française approche 16 Mrds d’euros pour le monde en 2022 et dépassera, avec l’objectif de 0.7 % du PIB, 20 Mrds en 2025. Elle doublera ou triplera si un chaos humanitaire touchant 1 milliard d’africains se produit lors de la prochaine décennie.
Aussi, notre programme pourrait faire économiser à la France, si l’on compte les éventuels coûts liés à aux phénomènes, connexes, directs ou indirects ainsi que l’économie générée par l’abandon progressif de la politique d’Aide publique au développement, plus de 1500 Mrds d’euros en 20 ans.
Pourquoi l’UE et des institutions financières accepteront aussi d’abonder notre fonds
Certes, le besoin total en financement de 1 000 Mrds d’euros en 20 ans peut sembler considérable. Il faut cependant considérer que le projet concerne une quarantaine de pays et profitera aussi à l’ensemble du continent africain. Lorsque l’on compare cet investissement mondial annuel de 50 Mrds d’euros au montant de 2 400 Mrds de dollars par an préconisé par la COP 27 pour aider les pays du Sud et « changer le climat » soit près de 50 fois plus élevé ou aux 27 000 Mrds d’euros d’ici 2030 réclamés par l’ONG Oxfam, il apparait évident que les investisseurs, pays développés et institutions multilatérales, visés pour mettre la main à la poche, préfèreront investir dans notre programme transparent et sérieux dont le fonds d’investissement servira en plus à terme, une rémunération des capitaux investis. L’UE dépense 80 milliards d’euros d’APD en 2023 mais la méthode semble désordonnée. En 2016, Bruxelles avait envisagé un financement de 1000 Mrds d’euros mais faute de plan structuré, avait dû renoncer.
Des marchés financiers qui peinent, dans un environnement instable, parfois à trouver des placements pour abriter les milliers de milliards d’euros qui leurs sont confiés, complèteront les apports. Au moment où chaque investissement doit se parer de RSE et d’inclusivité, un programme de développement et son fonds d’investissement, susceptibles de sauver à terme, de la malnutrition, du chaos humanitaire et de la mort, plusieurs centaines de millions d’africains mais dont la méthodologie d’investissement serait conforme aux exigences de sécurité et de rémunération des capitaux, séduiront la finance internationale.
L’enjeu géopolitique et géostratégique n’échappera pas non plus au gouvernement américain qui craint la montée en puissance de la Chine et sa mainmise sur les terres rares du numérique. Le volet Africa Atlantic Axis ouvrira une nouvelle voie. De même, on voit mal comment, à moins de vouloir maintenir l’Afrique subsaharienne dans sa situation pour des raisons idéologiques, l’ONU et la Banque mondiale, l’UA, la BAD et autres institutions, pourraient refuser d’adhérer à l’unique plan concret et d’envergure depuis 60 ans, de nature à réduire l’extrême pauvreté et la faim dans la région subsaharienne.
Mais sans protection des sites industriels et des personnels ainsi que de leurs familles, capitaux et entreprises n’afflueraient pas. Le volet sécurité occupe donc une place conséquente. Les pays africains signataires fourniront des effectifs. Leur formation et rémunération sont budgétées dans le programme.
La construction confiée à des entreprises expertes qui préserveront au mieux la faune et la flore
Des entreprises expertes en environnement apporteront leur excellence dans ce projet innovant qui placera la préservation de la faune et de la flore au premier rang de ses préoccupations. La pollution de l'air élevée dans les villes africaines, est la 2ème cause de décès prématuré après la malnutrition. Aussi nous demanderons à de grands groupes automobiles de construire, en partenariat avec de nouvelles entreprises locales qui créeront de nombreux emplois, des modèles de bus et de voitures, abordables, adaptés et peu consommateurs en carburants, hybrides et électriques. Ils remplaceraient progressivement une flotte aux émanations mortelles. L’industrialisation africaine et de nouveaux échanges pourraient permettre de redynamiser l’économie de la France et d’autres pays en panne de croissance.
Une jeunesse africaine entreprenante vivant en Afrique et une diaspora souvent diplômée et attachée à sa double culture, déçues par les politiques passées, manifestent un intérêt croissant à l’égard de notre "programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans". Un large plébiscite de celui-ci facilitera sa réalisation. Car il nous faut ensemble, tenter de faire mentir des prévisions de concentration en Afrique subsaharienne, de 90 % de l’extrême pauvreté mondiale en 2030 dans un contexte démographique de doublement de population et de possible chaos humanitaire sans précèdent. L’Afrique subsaharienne dispose de la possibilité et du pouvoir de s’offrir un nouveau destin.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Echange entre le président de l’Association de formation ELIT Mohamed Cissouma et Francis Journot

L'association ELIT
Mohamed Cissouma: Monsieur Journot, je viens de lire votre tribune "Pour amorcer la réussite de l'Afrique subsaharienne, il faut un programme d'industrialisation de 1 000 milliards d'euros en 20 ans". Je la trouve extrêmement pertinente et très pratique. Un article qui donne espoir sur la vision et la méthodologie qui peuvent amener notre Afrique vers une industrialisation durable et inclusive.
Les questions que je me pose à l’instant : 1. Comment vous incluez la partie éducation dans votre stratégie ? Les industries doivent être accompagnées par des compétences locales bien formées. 2. Comment vous incluez les organisations étatiques comme l’Union africaine et les gouvernements dans votre stratégie ? L’UA a par exemple un programme d’industrialisation de l’Afrique à l’horizon 2063. 3. Comment ensemble, on peut créer une synergie (ELIT, la diaspora) pour non seulement, vulgariser cette culture de l’industrialisation en Afrique, mais aussi être l’inertie qui apportera cette cinétique de l’industrialisation auprès de nos états ?
Comment vous incluez la partie éducation dans votre stratégie ? Les industries doivent être accompagnées par des compétences locales bien formées
Francis Journot : Le programme prévoit l’éducation dans le cadre des villes nouvelles mais soutiendra aussi des écoles locales et en créera d’autres. Pour le volet formation, chaque cas, en fonction de la nature du produit industriel sera évidemment diffèrent. Plus généralement, au fur et à mesure que des entreprises accepteront d’implanter des productions, nous parerons au plus pressé et élaborerons avec elles, en collaboration avec des écoles techniques ainsi que des contremaitres et ingénieurs d’entreprises, des formats courts et concrets de programmes adaptés au niveau des nouveaux employés tout en leur inculquant un enseignement plus théorique et des principes de base qui leur permettront de mieux évoluer ensuite. Nous ferons souvent venir des professionnels étrangers pour former sur sites industriels et créer des ateliers de formation qui deviendront, au fil de l’évolution, des écoles techniques enseignant des cycles complets. Néanmoins, certaines entreprises possèdent toutes les ressources nécessaires en interne et pourvoiront à la formation de leurs ouvriers. Nous pourrions avoir parfois recours à des écoles existantes, associations et organismes pour la formation de profils variés.
Comment vous incluez les organisations étatiques et les gouvernements dans votre stratégie ?
Francis Journot : C’est un point important que vous soulevez. Il convient effectivement avant tout de clarifier notre rôle et le type de relation que nous entretiendrons avec les Etats africains. L’action coordonnée du cabinet de gestion, du programme et du fonds, constitue une prestation de services. Il serait vain d’y chercher des velléités politiques. Nous proposons clairement d’appliquer un modèle de développement et de prospérité en implantant entreprises, infrastructures et villes nouvelles. Celui-ci sera financé par des investisseurs qui ne manqueront pas de juger de l’efficience de chaque euro dépensé et exigeront de nous, une gestion sans faille des capitaux confiés. Compte tenu de cela, les Etats devront aussi s’engager à collaborer au mieux pour favoriser le bon déroulement des opérations jusqu’à leur terme et signeront un contrat prévoyant des garanties de nature à assoir sa réalisation. Cette clarification dont le caractère rassurant et sérieux facilitera la recherche de capitaux auprès des investisseurs institutionnels ou privés, est indispensable. Les gouvernements adhéreront également à une charte transparente qui exclura par exemple, le versement de commissions pour obtenir des autorisations.
L’UA a par exemple un programme d’industrialisation de l’Afrique à l’horizon 2063
Francis Journot : Monsieur Cissouma, oseriez-vous dire à des habitants pauvres d’une région confrontée à une malnutrition mortelle, qu’il leur faut attendre 40 ou 50 ans tout en sachant que l’agenda échoue ? Sans doute pas car cela relèverait à la fois, du cynisme le plus achevé, du mensonge et de la cruauté. De plus, aucun politique ou industriel sérieux ne peut prétendre avoir une vision sur une durée aussi longue. On peut par ailleurs penser que l’association industriALL qui regroupe 50 millions de travailleurs dans le monde sait de quoi elle parle lorsqu’elle déclare « D’innombrables stratégies d’industrialisation de l’Afrique ont été adoptées depuis l’Agenda 2063 de l’Union africaine, pourtant, le décollage ne se produit pas ». La méthode qui échoue depuis 2013 ne fonctionnera pas davantage demain. A l’instar du plan de Lagos de 1980 de l’OUA, l’agenda 2063 de l’UA est voué à l’échec. Aussi l’UA qui est certainement consciente de cela, s’honorerait en passant le relais, en matière d’industrialisation, à une structure organisée spécifiquement qui bénéficiera du concours des personnels opérationnels les plus compétents chacun dans leurs domaines respectifs et les plus volontaires dont une jeunesse éduquée et diplômée de la diaspora qui veut relever le continent. Dotée d’un programme dont vous soulignez la pertinence de la méthodologie et armée d’atouts indispensables, elle pourra de façon plus certaine, œuvrer à l’émergence d’une industrie subsaharienne importante. Les projets industriels en cours seront les bienvenus et trouveront leur place au sein de notre programme.
Comment ensemble, on peut créer une synergie (ELIT, la diaspora) pour non seulement, vulgariser cette culture de l’industrialisation en Afrique, mais aussi être l’inertie qui apportera cette cinétique de l’industrialisation auprès de nos états ?
Francis Journot : Les populations et les Etats africains ont déjà compris que sans industrialisation, l’Afrique subsaharienne restera dans le dénuement et connaitra un chaos humanitaire au cours des prochaines décennies. Mais les jeux de pouvoirs, les innombrables influences ethniques ou étrangères, la prédation de nouveaux acteurs, l’idéologie et les intérêts des institutions nationales ou internationales, l’immobilisme et la corruption, empêchent la modernisation du continent. C’est pourquoi, notre programme de projets clés en mains qui inclut les financements et dont la rationalité de la méthode serait indiscutable, pourrait réconcilier et rassembler pour enfin réussir l’industrialisation subsaharienne.
Chaque année plus de 5 000 économistes œuvrant dans les institutions internationales (UE, FMI, ONU, OIT, Banque Mondiale, UA, BAD etc.), universitaires enseignant dans des universités réputées (Oxford, Yale, Berkeley, Stanford, Harvard etc.), cadres de grandes entreprises, associés de grands cabinets de conseil, gouvernements de nombreux pays ainsi que gestionnaires de fonds d’investissement, suivent avec attention l’avancée nos travaux économiques et s’en inspirent parfois. On peut donc maintenant considérer que le projet est connu des acteurs économiques importants. Mais comment faire franchir le pas à des investisseurs institutionnels et privés mais aussi faire envisager à de grandes entreprises le plus souvent occidentales, un transfert de productions aujourd’hui chinoises, vers l’Afrique subsaharienne ?
Même si des banques et fonds des pays du Golfe Persique dont les Émirats arabes unis, s’intéressent aussi au programme, la plupart des décideurs financiers et industriels des grands marchés de consommation qui suivent le projet, sont surtout occidentaux. Certes, ceux-ci n’ignorent guère que quelques centaines ou milliers d’africains manipulés qui manifestent contre des pays occidentaux dont la France, ne représentent pas l’opinion publique subsaharienne qui compte plus d’un milliard d’âmes mais veulent néanmoins être rassurés. Aussi avons-nous la tache de leur démontrer une volonté africaine de voir le continent se développer. Il nous faut mettre en exergue le fait qu’une multitude d’entrepreneurs installés en Afrique et de jeunes diplômés de la diaspora sont favorables à la mise en œuvre d’un plan qui ferait affluer des fonds financiers d’investisseurs institutionnels et privés mais attirerait aussi des entreprises occidentales qui partageraient leurs savoir-faire avec de nouvelles entreprises locales, créatrices ensuite de dizaines de millions d’emplois locaux.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale
![]()
"L’industrialisation et le développement de l’Afrique subsaharienne réduiraient démographie et immigration"
Pour éviter un chaos humanitaire, l’Afrique subsaharienne doit s’industrialiser rapidement, argumente Francis Journot, qui dirige le programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ainsi que le projet Africa Atlantic Axis.
L’explosion des flux d’immigration économique inquiète la France et d’autres pays de l’UE. Car l’Afrique subsaharienne concentrera, selon la Banque Mondiale, 90 % de l’extrême pauvreté mondiale en 2030 et sa population passera d’1 milliard d’habitants à 2 en 2050 puis 4 en 2100. Mais des solutions résident en amont et l’industrialisation pourrait éviter un gigantesque chaos humanitaire.
Quand le durable va à l’encontre du développement économique et de l’inclusif
Afin d’appliquer les résolutions de l’Accord de Paris de 2015 sur le climat, l’ONU a défini des Objectifs de Développement Durable (ODD). Les autres institutions, ont aussitôt souscrit au nouveau credo du développement « durable et inclusif ». Mais le durable va à l’encontre de l’inclusif quand les financements sont surtout fléchés vers des projets plus idéologiques et politiques qu’économiques, au détriment de la création d’une vraie industrie manufacturière des biens de consommation, génératrice d’emploi et de progrès pour les populations. Mais que répondront dans quelques années, les institutions internationales et ONG du climat, aux 2 ou 3 milliards d’africains qui les accuseront d'avoir mené une politique partiellement responsable d'un chaos humanitaire jamais vu ou aux européens qui leur reprocheront d’avoir favorisé une immigration massive impossible à absorber et ainsi déstabilisé les économies européennes.
Seules l’agriculture et l’industrie pourront offrir beaucoup d’emplois à la jeunesse africaine
L'UE et les USA ont promis au continent, 150 Mrds d’euro et 55 Mrds de dollars. L'aide publique au developpement (APD) avoisine maintenant 1500 Mrds en 60 ans . Aussi faut-il réorienter des capitaux inefficaces pour générer dès maintenant la création d’industries et agricultures tout en veillant cependant à préserver au mieux l’environnement et les écosystèmes locaux naturels de la faune et flore. La commercialisation des produits en Afrique mais aussi de nouveaux échanges, engendreront un essor économique. Des évolutions technologiques dans les domaines du numérique, des télécommunications ou du durable sont indispensables et feront progresser l’Afrique mais ne sont guère suffisantes.
On peut donc douter d’une politique par trop dogmatique qui ne procurera que peu de travail quand le défi consiste surtout à sortir de l’économie informelle et penser un schéma économique fournissant des emplois à une part importante des 20 millions de subsahariens qui arrivent sur le marché du travail chaque année. Quelques affirmations lénifiantes qui ne s’appuient guère sur des fondements ou mécanismes économiques, ne font pas une politique économique à part entière susceptible de résoudre les problèmes de l’Afrique subsaharienne. En dépit d’assertions hasardeuses, l’industrie et l’agriculture demeurent les principaux moyens de structuration des économies, de création d’emploi et de lutte contre la faim ou l’extrême pauvreté en Afrique subsaharienne.
Plan concret et réaliste d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne
En l’absence de projet d’ensemble, structuré et sécurisant, peu d’entreprises envisagent aujourd’hui d’installer des industries ou de transférer des étapes de leurs chaines de valeur mondiale (CVM) en Afrique subsaharienne. Aussi faudra-il aller convaincre suffisamment de grandes entreprises en France et dans le monde, de déplacer une part de leur production manufacturière chinoise, le plus souvent gourmande en main d’œuvre, afin de constituer de nouveaux écosystèmes, réseaux de fournisseurs et sous-traitants etc. L’échec de l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne n’est pas dû à un manque de capitaux mais à l’inefficience des stratégies.
Le "programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienneen moins de 20 ans " est le premier projet volontaire, clair, pragmatique et structurant. Les entreprises locales bénéficieront ainsi de savoir-faire et de technologies qui accéléreront la modernisation. Encouragés et facilités par le programme Africa Atlantic Axis (AAA), les échanges transcontinentaux vers l’UE et les USA, initieront le début d’une nouvelle ère africaine mais procureront aussi des opportunités à des entreprises françaises, européennes ou américaines qui rallieront ce programme.
La clé de la réussite de l’Afrique subsaharienne
Pour éviter un chaos humanitaire, l’Afrique subsaharienne doit s’industrialiser rapidement. La jeunesse africaine ne croit plus aux promesses illusoires des gouvernements et institutions. Interviewé par la BBC, un jeune Subsaharien déclarait « 90 % de mes amis veulent partir » d'Afrique. Ainsi, l’immigration clandestine a augmenté en un an de 64 % au sein de l’UE.
L’économie et le travail informels constituent une problématique africaine centrale mais la voie concrète que nous préconisons, facilitera la création de beaucoup d’emplois directs, indirects et induits mieux rémunérés. Le projet « International Convention for a Global Minimum Wage » qui prône de meilleurs salaires de production, permettrait d’accélérer le développement de l’Afrique subsaharienne.
L’intérêt suscité par nos articles publiés dans la presse africaine depuis plus de 2 ans, témoigne d’une forte volonté de la jeunesse africaine de s’investir dans la construction d’une économie moderne. La mutation vers une économie moins informelle enrichira les Etats qui pourront ensuite financer eux-mêmes leurs infrastructures. De nombreux africains ambitieux et diplômés qui sont aujourd’hui expatriés mais souhaitent la réussite du continent, se joindront au projet. Une hausse du niveau de vie qui encouragera l'émancipation féminine et l'éducation des enfants, permettra, au fil des années et des générations, un recul de la pauvreté. La forte implication des femmes dans de nouvelles activités puis la prospérité, induiront de nouveaux modes de vie et subséquemment, une forte réduction de la natalité.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

L’Afrique subsaharienne doit-elle accepter de sacrifier son industrialisation, ses 30 glorieuses et sa jeunesse au nom du climat ?
L’Afrique subsaharienne pourrait, à l’instar de pays développés qui ont profité de 30 glorieuses, connaitre à son tour une longue et forte période de croissance. Mais alors que des conditions sont réunies, une pensée autoritaire du réchauffement climatique pourrait l’en priver.
Quand le dogme climatique empêche l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne
Les ODD (Objectifs de développement durable) ont été définis par l’ONU en 2015. Leur influence sur les politiques d’investissement est déterminante. En effet, les industries, généralement génératrices d’émissions de CO₂, sont le plus souvent écartées au nom du climat. Concrètement, cela bloque l’industrialisation, empêchera la création de dizaines de millions d’emplois et le développement de l’Afrique subsaharienne mais aussi, compte tenu de la démographie, pousse un peu plus vite la région vers un chaos humanitaire sans précédent. Pourtant, si l’on considère que les pays de la région émettent ensemble moins de 2 % du CO₂ mondial, il apparait alors que les injonctions climatiques d’ONG et d’institutions sont peu légitimes. L’Afrique mérite mieux qu’une subordination aux ODD et doit se doter d’un projet réaliste qui tienne compte des besoins de ses populations et de ses spécificités économiques.
Vertu climatique de rigueur pour l’Afrique et centrales à énergies fossiles à volonté pour les autres
Peut-on croire, au moment où la Chine, l’Inde, les USA et l’Europe continuent d’ouvrir des centaines de centrales à charbon et gaz, que l’Afrique va s’industrialiser avec quelques barrages hydrauliques, panneaux solaires et éoliennes estampillées durables mais par ailleurs fortement meurtrières pour l’avifaune africaine. Le continent qui ne dispose pas actuellement d’énergie nucléaire, à l’exception de l’Afrique du Sud, ne pourra s’industrialiser, qu’en utilisant aussi des énergies fossiles, comme les autres régions du monde. Compte tenu de la probabilité d’une crise humanitaire qui pourrait tuer des centaines de millions d’africains si le continent ne se développe pas, il est indispensable de trouver un compromis.
A défaut de développement et d’éradication de la faim, les leurres du durable et du numérique
Le discours d’occidentaux ou d’africains biens nourris, souvent militants du climat ou représentants d’institutions internationales, parfois africaines, qui explique doctement à une population subsaharienne comptant parmi elle 350 millions de personnes souffrant de malnutrition et ne disposant guère d’accès à l’énergie, que la transition énergétique, une consommation durable ainsi qu’une transformation numérique sont les priorités au nom du climat, semble indécent et déconnecté des réalités africaines.
Le postulat selon lequel les TIC suffiraient à propulser l’Afrique vers la prospérité est fallacieux. Pour structurer son économie ainsi que tous les pays développés l’ont fait avant elle, la région ne pourra s’exonérer d’un passage par les cycles primaires et secondaires (agriculture et industrie). La digitalisation de services publics est certes indispensable. Il est néanmoins peu certain que les populations veuillent une société digitale et de services, tertiaire ou quaternaire, qui ne profiterait qu’à quelques-uns dont acteurs du durable et des TIC, startups ou entreprises robotisant les rares emplois de production mais s’accaparant la plus grande part des financements et subventions au milieu d’un océan de misère et de chaos. L’Afrique surtout besoin d’industrie manufacturière, d’agriculture et d’emplois.
Il faut respecter au mieux l’environnement mais produire suffisamment pour financer le progrès
Construction d’infrastructures, logements, équipement des ménages et création de services publics, emploi et diminution de l’économie informelle qui sclérose le développement, lutte contre la faim et l’extrême pauvreté, innombrables sont les colossaux chantiers et défis auxquels l’Afrique subsaharienne doit répondre. Il faut avant tout, respecter au mieux l’environnement dont la faune et la flore mais personne ne songe à faire de l’Afrique, la nouvelle usine du monde. Il est cependant nécessaire qu’elle produise au moins une forte part de ses biens de consommation et exporte de la valeur ajoutée pour s’offrir davantage de croissance, financer son progrès et satisfaire aux besoins de ses populations.
L’impasse d’un développement endogène de l’Afrique subsaharienne
Chacun souhaite profiter du progrès et la plupart des plus pauvres ne veulent pas vivre dans le dénuement quand le reste du monde évolue. Mais la construction d’une industrie capable de fournir les biens de consommation modernes à une population qui atteindra plusieurs milliards d’habitants dans quelques décennies, répartis dans près d’une cinquantaine de pays, nécessiterait des milliers de milliards d’euros impossibles à trouver et des dizaines d’années de recherches réalisées par des centaines de milliers d’ingénieurs et le dépôt ou achat de millions de brevets. Lorsque cela serait fait, les prix des produits, compte tenu des investissements et de l’endettement, ne seraient pas toujours concurrentiels.
Aussi le choix d’une forme d’isolement à l’heure de la mondialisation semble plus démagogique qu’efficient. Les institutions africaines pourraient faire le constat de l’échec de projets surtout endogènes dont le Plan d’action de Lagos (PAL) et l’Agenda 2063 à propos duquel IndustriALL Global Union qui regroupe 50 millions de travailleurs, déclare : "D’innombrables stratégies d’industrialisation de l’Afrique ont été adoptées, depuis l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et ce, du niveau continental jusqu’aux politiques industrielles nationales, mais le décollage ne se produit pas ". Seul le pragmatisme permettra de faire décoller l’économie. La Chine a pu s'industrialiser en 3 décennies parce qu’elle s’est ouverte à la mondialisation et que l'Occident dont la France, lui a procuré technologies et savoir-faire.
Après l’échec du modèle postcolonial d’aide au développement (APD), une voie plus pragmatique
La méthode du programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans est opérationnelle. Afin d’économiser des centaines de milliards d’euros et des dizaines d’années de recherches, nous voulons aller convaincre, schémas de process de production et projections financières à l’appui, des grandes entreprises occidentales qui produisent actuellement en Chine, d’inclure l’Afrique subsaharienne dans leurs étapes de chaînes de valeur mondiales (CVM). Ainsi, les entreprises locales bénéficieront de transferts technologiques et développeront des écosystèmes. Notre vision à 360° permettra d’engager simultanément toutes les actions nécessaires. Recherche d’investisseurs et constitution de fonds financiers, organisation d’infrastructures et de complexes industriels, formation mais surtout aussi une communication qui génèrera une dynamique mondiale. Les perspectives d’un immense marché en devenir, achèveront de persuader des potentiels partenaires également désireux de réduire leur dépendance à la Chine.
Certes, les organisations internationales et partenaires de l’Afrique dont la France, l’UE et les USA, englués dans leur dogme climatique mais bailleurs de fonds influents, ne seront pas toujours immédiatement séduits mais ne pourront que se résoudre à accepter finalement une politique industrielle plébiscitée par les populations afin de n’être guère exclus, au profit d’autres pays, de l’enjeu africain sur l’échiquier mondial géopolitique et géostratégique. Les institutions africaines doivent aussi comprendre que la jeunesse ne veut pas être sacrifiée sur l’autel du climat.
L’Afrique subsaharienne est à la croisée des chemins. Si les institutions africaines persistent à suivre une même politique dictée par un dogme climatique plutôt occidental, la région concentrera 90 % de l’extrême pauvreté mondiale en 2030 (source Banque mondiale). Avec 2 milliards d’habitants en 2050 et 4 en 2100, la plus grande catastrophe humanitaire sera inévitable. Mais ainsi que proposé, une autre voie est possible. Des institutions comme l’UA et la BAD ont le destin de l’Afrique entre leurs mains.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale
Commentaires d'experts à propos de l'article : L’Afrique subsaharienne doit-elle accepter de sacrifier son industrialisation, ses 30 glorieuses et sa jeunesse au nom du climat ?
Adrien W. N'KOGHE-MBA - Fondateur de l'initiative WANY et directeur général de l’Institut Léon MBA
Ce brillant article soulève une question cruciale concernant le dilemme entre le développement économique et la protection de l'environnement en Afrique subsaharienne. La problématique est bien énoncée et mérite une réflexion approfondie. Francis JOURNOT met en lumière les défis auxquels l'Afrique subsaharienne est confrontée, notamment la nécessité d'industrialisation pour réduire la pauvreté, améliorer la qualité de vie et créer des opportunités pour sa jeunesse. Il est indéniable que l'industrialisation est un moteur de croissance économique et a joué un rôle central dans le développement de nombreux pays. L'article souligne également l'urgence climatique et la pression exercée sur les pays en développement pour qu'ils réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre. Cependant, il est crucial de considérer le contexte spécifique de l'Afrique subsaharienne. Historiquement, cette région a contribué de manière minime aux émissions mondiales et n'a pas profité des avantages de l'industrialisation massive comme d'autres pays développés.
Dans ce contexte, il est essentiel de reconnaître que les pays d'Afrique subsaharienne ne devraient pas être contraints de sacrifier leur développement économique au nom de la lutte contre le changement climatique. Plutôt que d'imposer des restrictions rigides, il serait plus judicieux de soutenir ces pays dans leur transition vers des modèles de développement plus durables et respectueux de l'environnement. L'auteur propose également une approche pragmatique pour résoudre ce dilemme. Les pays développés, qui sont historiquement responsables de la majorité des émissions de gaz à effet de serre, doivent aider les pays africains à financer et à mettre en œuvre des technologies propres et renouvelables. Cela permettrait à l'Afrique subsaharienne de suivre une trajectoire de développement moins polluante sans compromettre sa croissance économique et le bien-être de sa jeunesse.
En somme, cet article présente une réflexion équilibrée et pertinente sur le dilemme entre le développement économique et la protection de l'environnement en Afrique subsaharienne. Il souligne la nécessité d'une approche solidaire et collaborative pour soutenir l'industrialisation de la région tout en protégeant le climat pour les générations futures.
Virginie MOUNANGA - CEO CRISTAL XP
Tu as tout à fait raison. Je trouve cette analyse très pertinente. En effet, doit-on sacrifier notre industrialisation et l’urbanisation de nos villes ?
Le Gabon est couvert à 88% par la forêt pourtant Libreville est de plus en plus peuplée. Il nous faut davantage développer notre ville mais comment si l’on doit préserver notre forêt devenue l’un des premiers poumons de la planète. Les efforts doivent aussi être faits dans les pays fortement industrialisés de manière à permettre aux autres nations du continent de mieux se développer et que ses mesures n’empêchent leur croissance.
J DIGONNET - Security Advisor
Voilà le "merveilleux " résultat de 60 ans de pseudo décolonisation. Pendant que les pays du nord dirigés par des "dirigeants éclairés" (LOL) se sont gavés et continuent de se gaver grâce aux marionnettes qu'elles ont installées (super les BMA), l'Afrique subsaharienne plutôt francophone se meurt doucement. Leurs positions dans les profondeurs du classement des IDH le prouvent. Quelques extraits de l'article : "1) L'Afrique subsaharienne a surtout besoin d'industrie manufacturière, d'agriculture et d'emplois. 2) Seul le pragmatisme permettra de faire décoller l'économie. La Chine a pu s'industrialiser en 3 décennies parce qu'elle s'est ouverte à la mondialisation et que l'Occident, dont la France, lui a procuré technologies et savoir-faire. 3) L'Afrique subsaharienne est à la croisée des chemins. Si les institutions africaines persistent à suivre une même politique dictée par un dogme climatique plutôt occidental, la région concentrera 90 % de l'extrême pauvreté mondiale en 2030 (source Banque mondiale). Avec 2 milliards d'habitants en 2050 et 4 en 2100, la plus grande catastrophe humanitaire sera inévitable". Les pillages des matières premières doivent s'arrêter au profit d'un développement inclusif des peuples africains.

Pour éviter un chaos humanitaire, l’Afrique subsaharienne doit s’industrialiser en moins de 20 ans
Selon la Banque Mondiale "pour 2030, les prévisions indiquent que 9 personnes vivant dans l'extrême pauvreté sur 10 vivront en Afrique subsaharienne." Sa population passera d'1 milliard d'habitants à 2 en 2050 puis 4 en 2100. Aussi le développement de l’agriculture et de l’industrie est plus que jamais urgent.
Critères idéologiques de financement
Les institutions internationales réservent le plus souvent les fonds de l’aide publique au développement (APD) à des projets d’investissement réalisés seulement dans quelques secteurs d’activité au détriment d’autres. Alors certes, les évolutions technologiques dans les domaines du numérique, des télécommunications ou du durable sont indispensables et permettront à l’Afrique d’avancer mais cela ne suffira pas. Aussi peut-on regretter des choix idéologiques qui s’opposent souvent à la création d’une industrie manufacturière de biens de consommation.
Une politique dogmatique qui ne procurera que peu de travail apparait inappropriée quand le défi consiste surtout à modifier l’économie informelle et à penser des solutions économiques procurant des emplois à une part importante des 20 millions de subsahariens qui arrivent sur le marché du travail chaque an.
Il est peu certain les africains touchés par l’extrême pauvreté qui ne voient pas d’amélioration de leurs conditions de vie, croient longtemps encore une communication et une politique prônant l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne tout en empêchant celle-ci. Même si cela va à l’encontre d’objectifs climatiques du GIEC ou d’une idéologie verte, l’Afrique a aussi le droit de se développer et les africains pauvres doivent pouvoir également accéder au progrès.
Les institutions internationales pourraient devoir répondre de leur aveuglement
Si nous n’agissons pas, il est à craindre, au cours des prochaines années ou décennies, que nous assistions alors impuissants à une famine tuant des centaines de millions d'africains mais impossible à juguler en raison de son étendue.
On se désolera alors de l'échec depuis les années 60 ou de l'inaction par idéologie climatique des institutions internationales en matière d’industrialisation de l'Afrique subsaharienne. Que pourront répondre les grandes institutions ou ONG du climat aux 2 ou 3 milliards d’africains qui les sommeront de s’expliquer dans quelques années quant à leur politique. Souhaitons que les dirigeants des institutions prennent maintenant toute la mesure de leur responsabilité et des conséquences de leur dangereuse stratégie idéologique dite durable mais contre-productive en termes d’inclusivité et d’humanité.
Un modèle postcolonial d’aide pour le développement (APD) inefficace et dépassé
Ainsi que nous l’expliquions dans l’article « Afrique subsaharienne : le capitalisme pourrait réussir là où l’aide au développement échoue depuis 60 ans », il faut rompre progressivement avec un modèle d’aide publique au développement (APD) inefficient mais aussi souvent jugé paternaliste et anachronique à l’heure de la mondialisation. Il convient de privilégier des collaborations et synergies entre entreprises locales et internationales qui généreront davantage de dynamiques et initieront des cercles économiques vertueux propices à l’emploi et au progrès humain.

Créer des industries et agricultures tout en préservant au mieux l’environnement
Nous avons perdu beaucoup de temps depuis l’annonce des prévisions de la Banque Mondiale en 2018 qui peut faire craindre le pire. Aussi peut-être pourrait-il s’avérer utile de mettre en œuvre notre Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans.
Afin d’éviter une catastrophe humanitaire d’une ampleur jamais vue, il nous faut favoriser, aux côtés d’Etats impliqués, la création d’industries et agricultures tout en veillant cependant à préserver au mieux l’environnement et les écosystèmes locaux naturels de la faune et flore. La commercialisation des produits en Afrique mais aussi de nouveaux échanges, engendreront un essor économique de la région (Africa Atlantic Axis (AAA).
L’économie et le travail informels constituent une problématique africaine centrale qui sclérose le développement du continent mais la voie concrète que nous préconisons, facilitera la création de nombreux emplois directs, indirects et induits mieux rémunérés.
Sans un projet industriel subsaharien structuré, les poids lourds de l’économie ne viendront pas
La Chine a pu s’industrialiser en 20 ans parce que l’occident lui a généreusement apporté ses technologies et savoir-faire. 1er plan d’industrialisation d’envergure depuis 60 ans, à la fois réaliste et volontaire, notre concept propose de convaincre de grandes entreprises internationales d'installer des étapes de chaines de leurs valeur mondiales (CVM) dans des pays subsahariens. Il nous faudra pour cela organiser et synchroniser l'installation de nouveaux écosystèmes, réseaux locaux de fournisseurs et sous-traitants. Car sans projet subsaharien tel que celui que nous portons, structuré et susceptible d’appuyer les transferts de production ou de faciliter les implantations, les poids lourds de l’économie française ou mondiale qui produisent actuellement la plupart de leurs articles en Chine, ne viendront pas spontanément en Afrique subsaharienne. Aussi faut-il relever ce chalenge ensemble.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale
 Si l’Afrique subsaharienne ne crée pas d’industries manufacturières, la plupart des partenariats public-privé ne seront pas rentables
Si l’Afrique subsaharienne ne crée pas d’industries manufacturières, la plupart des partenariats public-privé ne seront pas rentables
Afin d'attirer de nouveaux investisseurs, les institutions internationales prônent des partenariats public-privé « dérisqués ». Mais les Etats devraient compenser les pertes. Il faut donc un développement de l'industrie manufacturière des biens de consommation qui procurera des emplois et du pouvoir d'achat aux populations utilisatrices de services publics
L’Afrique subsaharienne est sous-équipée en services publics mais les projets infrastructurels impliquant des investissements privés accusent un recul depuis 2012. Afin d’attirer de nouveaux investisseurs, les institutions internationales prônent des partenariats public-privé « dérisqués ». Mais les Etats devraient compenser les pertes. Il faut donc un développement de l’industrie manufacturière des biens de consommation qui procurera des emplois et du pouvoir d’achat aux populations utilisatrices de services publics. Les budgets de certains États pourraient s’équilibrer et les industries consommatrices d’énergie ou d’autres infrastructures, participeraient considérablement à la rentabilité de ces nouveaux équipements.
Partenariats public-privé (PPP) pour financer des services publics et infrastructures
La Banque Mondiale est à l’initiative du projet "From Billions to Trillions" dévoilé en 2015 puis rebaptisé "Maximizing Finance for Development" en 2018. L’institution financière préconise des partenariats public-privé (PPP) afin de décupler la puissance des 150 milliards de dollars de prêts publics au développement que les banques multilatérales de développement (BMD) versent chaque année pour doper les investissements dans les services publics de pays sous-équipés.
Selon le FMI, le montant des opportunités d’investissements en matière de création de services publics en Afrique subsaharienne est estimé à « 20 % du PIB en moyenne d’ici la fin de la décennie » (PIB annuel de 2000 milliards de dollars environ). Lors du sommet France Afrique, le président français Emmanuel Macron a présenté un « new deal » déployé dans le cadre de l’Initiative France-Banque Mondiale et promu par l’Agence française de développement (AFD) pour intensifier le recours aux PPP en Afrique.
Les PPP dans des projets infrastructurels en Afrique subsaharienne sont en chute libre
Ainsi que le souligne la publication du FMI Comment attirer les fonds privés pour financer le développement de l’Afrique ? : « Le rôle restreint des investisseurs privés en Afrique est également manifeste sur le plan international : le continent n’attire que 2 % des flux mondiaux d’investissements directs étrangers ». Nombreux sont les pays africains qui veulent conclure des PPP pour installer des services publics mais Il est peu certain que les milliards escomptés affluent. Selon la base de données de la Banque mondiale, ces investissements sont en chute libre « En Afrique subsaharienne, les investissements dans les projets infrastructurels associant le secteur privé sont tombés de 15 milliards de dollars en 2012 à 5 milliards en 2019 ».
Plusieurs critiques à l’égard des partenariats public-privé dédiés aux services publics
L’article Intitulé « Le lourd tribut du « dérisquage » des financements infrastructurels » écrit sur Project Syndicate en 2018 par Howard Mann, conseiller principal en droit international à l'Institut international du développement durable, alertait déjà. Bien que ne doutant pas des bonnes intentions de la Banque mondiale, celui-ci écrivait à propos des financements par PPP : «de nombreux pays en voie de développement s’orientent aujourd’hui tout droit vers un scénario désastreux. Dans de nombreux cas, les risques pris en charge par les États s’étendent sur 20 à 30 ans. Pendant toute cette durée, les gouvernements seront confrontés à de sérieux défis dans la gestion des dépenses publiques, et subiront des coûts imprévus liés à des engagements hors comptabilité ainsi qu’à une dette excessive, ce qui soulève la possibilité d’un défaut sur tous les engagements de crédit ». En décembre 2020, dans l’article « La doctrine Macron en Afrique : une bombe à retardement budgétaire » publié par le Groupe d’Etudes Géopolitiques (GEG) de l’Ecole Nationale Supérieure (ENS), deux économistes, Daniela Gabor (auteure du livre The Wall Street Consensus, édité en 2020) et Ndongo Samba Sylla, dénonçaient les mêmes problématiques mais aussi l’influence des marchés financiers.
Le modèle économique importe au moins autant que le mode de financement des infrastructures
Alors certes ces risques sont réels et cela se vérifiera probablement lors de certains partenariats public-privé. Mais la plupart des Etats ne peuvent financer les travaux publics et souvent leurs économies respectives jugées peu « bankable », ne leur permettent guère d’émettre des obligations ou d’obtenir des prêts. Les PPP pourraient donc constituer des solutions si toutefois le développement économique est aussi au rendez-vous. Car le type de financement n’est pas l’unique paramètre. Le modèle de développement importe au moins autant. Si l’emploi informel qui concerne 85 % de la population subsaharienne demeure la règle, les revenus augmenteront peu. Mais dans le cas d’une forte industrialisation, la hausse de pouvoir d’achat, l’enrichissement des Etats et la consommation d’industries permettraient de rentabiliser les équipements et d’honorer les engagements signés.
Une efficience limitée des aides publiques et des investissements sans vision globale
La politique d’aide au développement de l’Afrique subsaharienne échoue depuis 60 ans. L’industrie de cette région s’articule surtout autour du secteur des matières premières et de la transformation des productions agricoles. Aujourd’hui, la plupart des biens de consommation sont importés de Chine. Aussi dans un environnement dépourvu d’écosystèmes industriels, les investissements désordonnés sont souvent vains. Le G7 promet 80 Mrds de dollars répartis sur cinq ans aux entreprises africaines mais quels que soient les montants, une stratégie est indispensable. Au lieu d’injecter ici et là, des capitaux sans cohérence d’ensemble, il conviendrait, afin d’éviter une déperdition d’efficacité et de rendement, de concentrer ceux-ci en amont de secteurs industriels porteurs d’emplois. Ainsi, en aval des millions d’autres d’emplois de services, indirects et induits se créeraient naturellement ensuite. En usant de tels mécanismes, les besoins en financements et subventions seraient moins colossaux.
L’industrialisation demeure la seule solution pour développer l’économie de l’Afrique subsaharienne
30 millions d’africains arrivent sur le marché du travail chaque année aussi faut-il accorder une priorité aux projets industriels. En effet, on observe habituellement dans les pays développés que chaque emploi industriel génère en moyenne 3 ou 4 autres emplois induits ou indirects mais dans des pays où tout est à construire, ce chiffre pourrait être encore multiplié par 2 ou 3. C’est pourquoi il serait pertinent de réunir d’abord les conditions de cette industrialisation en construisant les infrastructures nécessaires et en installant simultanément des parcs d’activités sectoriels pouvant accueillir des entreprises souvent occidentales qui partageraient des savoir-faire et constitueraient, aux côtes de nouvelles entreprises locales, des écosystèmes performants.
Associer des projets infrastructurels à un plan d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne
Lors du G20 de 2017 à Hambourg, la chancelière Angela Merkel annonçait le programme Compact With Africa (CWA) qui concernait les entreprises allemandes et 12 pays d’Afrique dont 8 en région subsaharienne. 4 ans plus tard, il a sans doute permis des rapprochements mais semble au point mort.
Plus ambitieux, le projet «Africa Atlantic Axis» (AAA) ou «Plan de régionalisation de production Europe Afrique» s’adresse à des entreprises de toutes nationalités et offrirait ainsi d’importantes possibilités de développement aux entreprises africaines et de nombreux emplois. Celui-ci propose une industrialisation de l’Afrique subsaharienne dans le respect de l’environnement à partir de bases productives qui s’intègreraient au sein de chaines de valeur mondiales (CVM). Elles seraient d’abord implantées dans des pays de la façade atlantique ou proches de celle-ci afin de fluidifier les échanges avec l’Europe et les USA avant de s’étendre progressivement à tout le continent. D’autre part, l’augmentation raisonnable des salaires de production que nos études recommandent dans le cadre du projet «International Convention for a Global Minimum Wage», ferait reculer la pauvreté et permettrait ainsi à un nombre croissant d’africains d’avoir accès aux nouveaux services publics. En avançant de concert, projets d’industries manufacturières et PPP créant des services publics, se renforceraient mutuellement et favoriseraient ainsi leur viabilité.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale
Tribune de Francis Journot : "Afrique subsaharienne : le capitalisme pourrait réussir là où l’aide au développement échoue depuis 60 ans"
Dans le contexte actuel, il serait hasardeux de diminuer le montant d'APD en Afrique subsaharienne au moment où la pandémie de Covid-19 aggrave l'extrême pauvreté. Une transition graduelle vers une autre politique de développement pourrait se révéler pertinente.
En 2019, le montant de l'aide publique au développement de L’Afrique (APD) atteignait 37 Mrds USD dont 31 affectés à la zone subsaharienne mais la misére pourrair demeurer. Selon une étude de la Banque Mondiale en 2018, cette part de l’Afrique concentrait le quart de l’extrême pauvreté mondiale en 1990, la moitié en 2015 et les projections indiquaient 90 % pour 2030. Si l’on en croit le dernier rapport « Africa’s Pulse » dévoilé le 7 Octobre 2020, la situation pourrait s’envenimer « La pandémie risque de faire basculer 40 millions d’Africains dans l’extrême pauvreté, effaçant au moins cinq années de progrès dans la lutte contre la pauvreté. ». Le président de la Banque Africaine de Développement (BAD) Adesina Akinwimi n’est pas plus optimiste « l’Afrique a perdu plus d’une décennie des gains réalisés en matière de croissance économique ». Diminution de budgets nationaux, fragilisation des régimes politiques et renforcement du terrorisme islamique, fuite vers l’UE d’une jeunesse africaine indispensable au développement du continent, pourraient compter parmi les conséquences.
Le débat autour du capitalisme et de l’aide au développement
Dès le début des années 60, l’agronome René Dumont a douté de l’efficacité de l’APD, puis des économistes dont Jean-François Gabas en 1988 ou William Easterly en 2001 se sont aussi interrogés. Professeur à Harvard au cours des années 80 et 90, Jeffrey Sachs aurait enseigné que « Le développement à long terme ne serait possible qu'avec la participation du secteur privé et des solutions d'économie de marché ». Son ancienne élève, l’économiste Dambisa Moyo, écrivait dans son bestseller couronné par le New York Times en 2009 « l’aide fatale : Les ravages d’une aide inutile et de nouvelles solutions pour l’Afrique» : « Nous avons maintenant plus de 300 ans de preuves de ce qui fonctionne pour augmenter la croissance, réduire la pauvreté et la souffrance. Par exemple, nous savons que les pays qui financent le développement et créent des emplois grâce au commerce et à l'encouragement des investissements étrangers, prospèrent. » Des Chefs d’Etats partagent une part de l’analyse dont l’ancien président du Sénégal Abdoulaye Wade qui déclarait en 2002 : « Les pays qui se sont développés ont tous embrassé le libre-marché». Néanmoins, dans son ouvrage publié en 2005 « La fin de la pauvreté », le professeur émérite Jeffrey Sachs maintenant conseiller du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, préconisait le doublement de l’APD dont son ex élève Dambisa Moyo dénonce précisément l’inefficience. Le sujet est complexe et personne n’a entièrement raison ou tort. Le débat qui promet de durer encore plusieurs décennies ne semble pouvoir remédier à la stagnation de l’Afrique. Il serait hasardeux de diminuer le montant d’APD en Afrique subsaharienne au moment où la pandémie de Covid-19 aggrave l’extrême pauvreté mais une transition graduelle vers une autre politique de développement pourrait se révéler pertinente.
L’économie informelle ne pourra jamais générer seule une croissance suffisante
La somme consacrée à l’APD en Afrique depuis 1960 dépasse, selon l’économiste Zambienne Dambisa Moyo, 1000 Mrds USD. Mais les actions locales des ONG montrent leurs limites et la nouvelle politique d’APD prônée depuis 2017 par le FMI en faveur de l’emploi informel pourrait se révéler insuffisante en termes de diminution des inégalités et de croissance. L’hétérogénéité d’une économie informelle en Afrique subsaharienne qui génère 20 à 65 % du PIB des États, est à prendre en considération mais il conviendrait de mettre également en œuvre une stratégie plus globale afin de gagner la course contre un appauvrissement et une catastrophe humanitaire qui menacent. Après une augmentation du PIB subsaharien de 2.4 % enregistrée en 2019, le FMI prévoit un repli qui avoisinera de 3.2 % dans cette région africaine dont la croissance par habitant est déjà la plus faible au monde. Une transformation de l’économie subsaharienne qui procurerait davantage de postes souvent mieux rémunérés que ceux du secteur informel totalisant actuellement plus de 80 % des emplois, s’avèrerait impérative pour offrir de réelles perspectives économiques. Pour absorber un chômage qui impacte 40 à 45 % des 15/24 ans dans un contexte de démographie subsaharienne galopante et réduire une extrême pauvreté (moins de 1.90 $/jour) qui touche plus de 150 millions de travailleurs subsahariens parmi 450, il serait indispensable que la croissance du très faible PIB subsaharien de 1755 Mrds USD (2019), augmente considérablement. Un taux de croissance nécessaire de 7 % pour faire reculer significativement la pauvreté, a souvent été évoqué au cours des années passées mais compte tenu des facteurs aggravants et de paramètres alarmants, le taux minimum à atteindre ne devra pas être inférieur à 8 ou 9 % pendant de nombreuses années.
Les emplois partis en Chine ne reviendront pas en Occident
Le développement de la Chine est un cas d’école. La délocalisation de la production depuis 30 ans des biens de consommation occidentaux est à l’origine du miracle économique chinois et de ses taux de croissance pendant vingt ans à partir du début des années 90, rarement inferieurs à 9 % et souvent supérieurs à 12, 13 ou 14 %. Ces emplois ne reviendront évidemment pas dans des pays occidentaux dont les salaires sont plus élevés mais Il ne faut pas non plus transformer l’Afrique en nouvel atelier du monde. Il convient plus simplement d’initier l’évolution industrielle et économique qui favorisera sa marche vers l’autonomie et le progrès.
Alors comment faire décoller l’économie subsaharienne ?
La volonté de nombreux Chefs d’Etats de moderniser et d’industrialiser leurs pays constitue certainement un préalable primordial mais le manque de financements et d’infrastructures, le temps long de l’industrialisation à partir de bases productives ou commerciales insuffisantes ou inexistantes, le besoin de réactivité au sein de chaines de valeur mondiales (CVM) constituent autant de difficultés à surmonter. De plus, les fonds empruntés, atteindraient des sommets et le surendettement des États accentuerait la pauvreté. Un Plan de régionalisation de la production en zone Europe Afrique qui prônerait une voie plus efficiente pourrait se révéler indispensable. Car à l’heure de la mondialisation, l’Afrique ne pourra réussir qu’en travaillant davantage avec les grands marchés de consommateurs dont les entreprises implanteraient sur son sol la fabrication de produits ou d’étapes de CVM d’une industrie manufacturière des biens de consommation pourvoyeuse d’emploi et de richesse mais aujourd’hui surtout installée en Chine. L’expansion de cette dictature arrogante qui menace de nombreux pays, est dangereuse. Il est urgent de restaurer certains équilibres mais aussi d’en créer de nouveaux afin de préserver la paix et la démocratie dans le monde ainsi que cela est suggéré dans la tribune "Réduire notre dépendance à la Chine, c'est possible" publiée sur le Figaro.
Le début d'une période de « Trente glorieuses » en Afrique ?
Il serait utopique de viser une industrialisation simultanée de plusieurs dizaines de pays d'Afrique dont les capitaux nécessaires seraient introuvables (pour exemple, le plan d'électrification de l'Afrique porté par l'ancien ministre français Jean Louis Borloo qui réclamait un financement de 250/300 milliards d'euros, a finalement été abandonné). Un premier plan d'une dizaine de milliards d'euros,étalé sur 3/5 ans, mais d'abord concentré sur un périmètre déterminé s'avérerait pragmatique. Ce programme de développement de l'industrie africaine pourrait s'initier à partir de pays situés sur la façade atlantique ou proches de celle-ci. Cette situation géographique permettrait en outre de faciliter les échanges avec les deux grands marchés de consommateurs que sont l'UE et les Etats-Unis. Les parcs d'activités modernes et sécurisés qui seraient financés par les institutions internationales et des pays souhaitant contribuer, accueilleraient les outils de production d'enseignes européennes, américaines ou non occidentales et souvent des PME locales. Pour exemple, plusieurs critères objectifs pourraient motiver l'implantation en République démocratique du Congo (RDC) d'un cluster industriel dédié à la fabrication d'éléments électroniques et à l'assemblage de produits numériques. Les processus d'intégration industrielle pourraient à terme, produire des écosystèmes complets et performants. L'industrialisation serait progressive, mais de nombreux entrepreneurs et chômeurs issus d'autres Etats bénéficieraient rapidement d'opportunités au sein d'un maillage dense d'entreprises. Au fil des ans, la prospérité s'étendrait et profiterait au plus grand nombre. Ce changement de paradigme pourrait ainsi marquer le début d'une période de « Trente glorieuses » en Afrique.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

L’industrialisation de l’Afrique subsaharienne devrait être un sujet prioritaire des sommets Afrique-France et Afrique-UE
Les sommets Afrique-France et Afrique-UE vont se tenir en 2021 mais les propositions généralement exposées s’avèrent peu adaptées aux enjeux. Le transfert en Afrique et en UE d’une part de la production des biens fabriqués en Chine, pourrait résoudre des problématiques.
Quand les travaux des sommets vont à l’encontre du développement de l’Afrique
Au moment où l’extrême pauvreté fait plus de ravages que jamais, une population qui compte parmi elle 250 millions d’habitants souffrant de malnutrition dans une Afrique quasiment dépourvue d’industrie et n’émettant que très peu de co2, pourrait majoritairement juger que des préconisations françaises, européennes ou internationales sont décalées et contre productives. La transformation numérique et la transition verte placées au premier rang des priorités, doivent certes être incluses mais ne constituent pas des solutions à part entière. On peut craindre que cette focalisation hors sol empêche un développement rapide de l’Afrique et ne permette pas un recul de la misère.
Croissance pour l’Afrique et ses partenaires
Il est maintenant temps de construire un paradigme efficient. L’installation d’infrastructures et d’outils industriels d’entreprises souvent occidentales puis la création de tissus d’entreprises locales, génèreraient en Afrique subsaharienne, des dizaines de millions d’emplois plus rémunérateurs que ceux du secteur informel. Cela moderniserait l’Afrique tout en offrant la possibilité à certains pays de s’extraire de la spirale du piège chinois de la dette africaine Les nouveaux échanges entre des Etats africains et leurs partenaires fréquemment Français, européens mais aussi américains ou parfois asiatiques dont le Japon, favoriseraient la croissance de chacun d’entre-eux. Une intégration industrielle concertée préserverait au mieux l’environnement.
De nombreux pays à travers le monde doivent maintenant comprendre que la Chine ne sera pas leur relais de croissance
Dans la plupart des pays développés, la consommation intérieure et les plans de relance mis en œuvre à l’occasion de la pandémie Covid-19, ne permettront pas d’augmenter durablement une croissance qui s’est réduite au rythme de la désindustrialisation et des délocalisations. Certes quelques entreprises occidentales de produits à haute valeur ajoutée (voitures allemandes ou luxe français) tirent leur épingle du jeu mais la Chine fabrique la plupart de ses propres biens de consommation et ne constituera pas le relais de croissance que les occidentaux attendent en vain depuis le transfert de leurs technologies. De plus, compte tenu de leurs coûts salariaux peu concurrentiels dans la mondialisation, les pays occidentaux ne verront pas de réindustrialisation massive et les emplois partis en Chine ne reviendront que rarement chez eux. Mais ainsi que nous l’avons déjà écrit dans Le Figaro, « Réduire notre dépendance à la Chine, c'est possible ! ».
Perspectives économiques d’un continent qui pourrait compter 2.5 milliards d’habitants en 2050
Des pays en panne de croissance souvent occidentaux doivent opter pour des solutions qui leur permettront de sortir de l’ornière. A la porte de l’Europe, un continent peuplé d’1.3 milliard d’habitants aujourd’hui et de 2.5 milliards en 2050. Les perspectives économiques sont énormes et pourraient générer de l’activité dans les pays dont les entreprises ressortissantes participeraient à l’industrialisation de l’Afrique. Des mécanismes de mutualisation et de péréquation de coûts du travail souvent élevés en occident et plus faibles en Afrique, recréeraient des équilibres et privilégieraient ainsi la pérennité ou la création d’emploi sur les deux continents.
Alignement des planètes pour développer l’Afrique, contenir la Chine et assurer de la croissance
La responsabilité de la Chine à propos de la propagation de la pandémie du Covid-19 qui a causé plus de 3 millions de morts et dévasté l’économie mondiale, a intensifié la méfiance de la communauté internationale à l’égard de celle-ci. Même si faute d’autres financements, quelques pays la sollicitent toujours, la quasi-totalité du monde est consciente de la nécessité de juguler la montée en puissance d’une Chine arrogante qui affiche clairement ses ambitions hégémoniques et parfois guerrières. Le piège infernal chinois de la dette africaine, la captation de terres rares ou agricoles et autres richesses du continent, menacent l’indépendance de pays africains. L’UE, bien que la signature de l’accord de principe UE-Chine sur les investissements puisse interroger, clame être à présent moins dupe. Le président des États-Unis Joe Biden affirme sa volonté de freiner l’expansionnisme chinois et renforce avec l’Inde, le Japon et l’Australie, le dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quad). Et enfin, on peut espérer que la nigériane Ngozi Okonjo-Iweala, nouvelle directrice de l’OMC depuis le 1er mars 2021, soit moins laxiste que ses prédécesseurs envers la Chine qui en viole les règles.
Un projet qui répondrait à une attente de la jeunesse et pourrait remplacer progressivement l’APD
Fin 2020, dans un article publié sur La Tribune Afrique intitulé «Afrique subsaharienne: le capitalisme pourrait réussir là où ou l’aide au développement échoue depuis 60 ans », nous proposions de tourner progressivement la page de l’aide publique au développement dont le montant a dépassé 1000 Mrds de dollars mais n’a pas fait diminuer un emploi informel qui concerne encore 85 à 89 % de la population active subsaharienne. Des entreprises organisées offriraient des emplois mieux rémunérés. L’augmentation raisonnable des salaires minimum de production que nous prônons dans nos études relatives au projet International Convention for a Global Minimum Wage, contribuerait aussi à une élévation du niveau de vie des populations et accélérait le développement de l’Afrique. Cela pourrait répondre au souhait de nombreux africains qui voudraient mieux vivre de leur travail et rompre avec une assistance certes bienveillante et souvent indispensable mais qui renvoie une image négative qu’ils veulent changer. Le processus d’intégration industrielle augmenterait les ressources budgétaires des États, contribuerait à la sécurisation de territoires et réduirait les flux migratoires de l’immense continent dont la modernisation nécessiterait l’implication et l’énergie de sa jeunesse.
On peut transférer de la Chine à l’Afrique, une part de notre production industrielle
Seul un plan de régionalisation de production Europe Afrique, concret et structurant mais tenant compte aussi des nouveaux paramètres géoéconomiques et géopolitiques régionaux, pourrait réussir. Une implication financière de chacun des pays signataires qui souhaiteraient renforcer leur présence économique pour accroître leurs échanges avec l’Afrique dans le cadre du programme, s’avèrerait indispensable. Des entreprises originaires de ces États pourraient souvent bénéficier d’un accompagnement facilitant leur implantation (recrutement et formation, assistance juridique, fiscale et administrative, financements, études etc.) qui contribuerait aussi à une attractivité pour l’Afrique subsaharienne. Nous saurons bâtir les schémas industriels globaux au sein desquels elles pourront se projeter et qui les convaincront de déménager une part de leur production. Il conviendra de rechercher une complémentarité sectorielle pour constituer des écosystèmes performants et cohérents renforcés par des blockchains. Cette proximité permettra ainsi de réduire au sein de chaines de valeur mondiales (CVM), le transport de matières ou pièces.
Programme ciblé afin d’être efficient et aisément finançable
Le coût de construction des bases industrielles dont accès routiers, ferroviaires, aéroportuaires ou portuaires, fourniture énergie, réseaux télécommunications, travaux de voirie, gestion des déchets mais aussi dispositifs de sécurité, habitations, écoles, centre médicaux et commerces indispensables, seraient éligibles au financement par les grandes institutions internationales et pays donateurs dans le cadre du développement de l’Afrique. Le montant dépensé pour chaque site industriel qui sortirait de terre tous les 2 ou 3 ans, avoisinerait 3/5 Mrds euros.
Dessein qui pourrait fédérer
Hors d’un cadre protecteur comme celui préconisé, une industrialisation de l’Afrique, ferait des dégâts environnementaux irréversibles. Il conviendrait donc d’éviter la construction désordonnée d’une multitude de zones industrielles sans cohérence d’ensemble. A l’opposé de politiques ou de propositions économiques, internationales ou locales, souvent creuses et sans lendemain mais qui sclérosent depuis 60 ans le développement de l’Afrique subsaharienne, le programme Africa Atlantic Axis pourrait au contraire être mis en œuvre prochainement, si toutefois les populations des pays africains les plus concernés le souhaitent. Les institutions financières internationales ne pourraient que s’associer à ce projet de progrès pour l’Afrique. De nombreuses entreprises occidentales qui songent depuis plusieurs années à quitter la Chine, accepteraient de s’investir dans ce grand dessein.
Collaboration indispensable des deux continents
Le panafricanisme est souvent évoqué mais le temps de l’industrialisation est un temps très long. Rappelons que ce sont les transferts de technologies occidentales qui ont permis à la Chine de se développer considérablement en une vingtaine d’années. Les populations africaines qui peinent aujourd’hui à se nourrir, ne peuvent encore attendre un demi-siècle ou plus. Aussi convient-t-il d’être pragmatique. Il est assez peu probable que l’Afrique puisse prospérer en se privant de l’aide de l’Europe qui elle-même devrait s’appuyer sur l’Afrique pour générer à nouveau de la croissance.
Un modèle éthique pour une industrialisation raisonnée
Production plus locale et baisse du volume de transport de biens, application en Afrique du Salaire Minimum Mondial de production, qui permettrait à des parents d’envoyer leurs enfants à l’école, davantage d’éducation et hausse du niveau de vie qui induiraient à terme une modération de la natalité et iraient dans le sens d’une fabrication plus durable ainsi que d’une réduction des émissions mondiales de gaz à effets de serre, tels pourraient être quelques-uns des avantages du modèle.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du projet États-Unis d’Afrique subsaharienne et du Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur d'International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Industrialisation de l’Afrique subsaharienne, quelles industries ?

Industrialisation de l’Afrique subsaharienne, de quelle industrie s’agit-il, (4.0, numérique) …, comment organiser cette industrie, avec quels partenaires français et européens, quelle stratégie de développement pour cette partie du continent et pour l’export ? Quid, en effet du financement. Quel besoin en compétences et donc, aussi, en formation…
Les enjeux de l’industrialisation
Selon la Banque mondiale, les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin » alors que la population subsaharienne pourrait compter 2 milliards d’habitants en 2050 et doubler en 2100. A la lumière de ces chiffres, l’enjeu de l’industrialisation et du développement de l’Afrique subsaharienne apparaît clairement. Si la région subsaharienne ne se dote pas d’une industrie manufacturière des biens de consommation et d’une agriculture qui créeront des centaines de millions d’emplois, nous assisterons à la plus grande crise humanitaire jamais vue. Des entrepreneurs africains ou salariés et cadres de la Banque africaine de développement (BAD) ou de l’Union africaine avec lesquels j’ai échangé, m’ont fait part de leur inquiétude. Selon eux, l’Afrique subsaharienne « va dans le mur » et beaucoup s’étonnent de la politique et de la passivité des dirigeants des institutions internationales et Africaines. Mais la catastrophe humanitaire qui pourrait tuer des centaines de millions d’africains ne se limitera au continent africain. Il est certain que l’immigration vers l’UE explosera. Cela fragilisera d’abord un peu plus une UE en panne de croissance et incapable d’intégrer de tels flux puis mettra à bas ses systèmes de protection sociale.
De quelle industrie s’agit-il, (4.0, numérique)
Le principal intérêt d’une industrie manufacturière des biens de consommation est la création de nombreux emplois qui permettront ensuite de structurer des territoires, de créer de plus en plus d’entreprises et de générer 10 ou 20 fois plus d’emplois indirects et induits. Il faut que l’Afrique subsaharienne profite de l’évolution de ses premiers cycles pour se structurer et sortir de la pauvreté. Dans un article sur Marianne j’expliquai ce phénomène de cycles : « Ainsi, les pays les moins développés dont ceux d’Afrique subsaharienne, ne peuvent enjamber une progression des cycles, de même que les pays anciennement industrialisés se heurtent le plus souvent à un effet cliquet postindustriel qui empêche un parcours inverse. ». En voulant jouer les apprentis sorciers de l’économie et propulser sans transition l’Afrique vers le cycle quaternaire, nous ne ferons qu’ajouter un peu plus de désordre, de la concurrence entre entreprises africaines et davantage d’inégalités. Si l’ensemble des subventions va à destination de projets numériques, de l’énergie dite durable portée par quelques lobbies et d’une industrie 4.0 qui ne créera pas d’emploi, les populations seront encore les laissés pour compte. Certes, des dispositifs numériques peuvent optimiser la gestion d’une production agricole, la numérisation favorisera la modernisation du continent, l’industrie 4.0 sera indispensable pour certains produits etc. mais il convient de ne pas perdre de vue l’objectif qui n’est pas l’enrichissement de quelques-uns et de quelques startups au détriment du plus grand nombre mais au contraire le recul de l’extrême pauvreté et de la malnutrition de plusieurs centaines de millions d’africains. L’Afrique subsaharienne a bénéficié l’an dernier de 30 milliards d’euros d’APD. Le manque d’industrialisation n’est donc pas dû à un manque de capitaux mais à une absence de méthode efficiente.
Comment organiser cette industrie, avec quels partenaires français et européens, quelle stratégie de développement pour cette partie du continent et pour l’export, Quid, en effet du financement. Quel besoin en compétences et donc, aussi, en formation…
Pour industrialiser l’Afrique, il faut d’abord que des groupes industriels, souvent occidentaux, qui détiennent des savoirs faire et technologies mais possèdent aussi des marques et détiennent des marchés, veuillent venir. Manque d’infrastructures, logements et espaces de vie, écoles etc. pouvant accueillir des familles d’expatriés, insécurité et image dégradée des occidentaux, instabilité politique et risque pénal et médiatique pour le directeur général d’un groupe dont les ingénieurs et techniciens auraient été mis en danger, manque de formation et de personnels qualifiés etc. les obstacles sont nombreux. Ainsi peu de groupes industriels envisagent aujourd’hui de s’installer en Afrique subsaharienne. De même, dans le contexte actuel, les financiers ne se précipiteront pas non plus. Si l’on veut résumer, sans programme structuré, il n’y aura pas d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne. Aussi faut-il penser l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en agissant simultanément sur tous les fronts évoqués précédemment. Le chantier central sans lequel rien ne sera possible, consistera à user d’une promotion multicanaux massive et internationale du projet pour imposer l’idée que l’industrialisation et le développement de l’Afrique subsaharienne offriront de nombreuses opportunités et le moyen de renouer avec la croissance en berne ou faible depuis plusieurs années dans des pays développés dont la France, l’UE et les USA. Il sera également nécessaire que le fonds d’investissement se dote d’une chaine TV business qui contribuera à la notoriété du programme mais intègrera aussi d’autres médias pour constituer un groupe de communication influent et efficace qui saura donner envie à des entreprises occidentales de s’installer et présentera de nouvelles perspectives aux investisseurs publics et privés. Le challenge consiste à faire de l’Afrique subsaharienne, un nouvel eldorado. Il est certain que ce travail de restauration d’une image occidentale abimée ne pourrait que profiter à la France, l’UE et les USA qui pourraient abonder le « programme d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans ».
Francis Journot est consultant et entrepreneur. Il dirige le Programme industrialisation Afrique subsaharienne ainsi que le Plan de régionalisation de production Europe Afrique et Africa Atlantic Axis. Il fait de la recherche dans le cadre d’International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

L’idéologie verte affaiblit l’industrie manufacturière en France et empêche l'industrialisation en Afrique subsaharienne

Le slogan de la réindustrialisation ne permet pas d’enrayer le déclin de l’industrie manufacturière dont la part dans le PIB de 10.2 % en 2016 chute à moins de 8 % et va encore reculer en raison des normes, de la décarbonation et du prix de l’énergie. S’il est impossible de remédier à cela, alors tentons au moins d’influer sur les flux de délocalisation de productions afin de mieux maitriser notre économie.
Une incompréhension du temps long de l’industrie et des processus industriels
Mardi 16 mai 2023, Bruno Le Maire faisait part des ambitions gouvernementales dans le cadre du plan « Industrie verte » : « Nous avons pour objectif de remonter la part de l'industrie dans le PIB de 10 à 15 % » et s’interrogeait : « De quoi avons-nous besoin pour construire une usine, avec des technologies dedans et des gens pour la faire tourner ». « D’abord du foncier, ensuite des capitaux et enfin de la formation. ». Quiconque a participé à un processus de production industrielle ou connait le long cheminement de l’industrialisation française, n’adhèrera pas à un discours plutôt démagogique qui préfère occulter les innombrables obstacles à la relocalisation de l’industrie manufacturière en France.
Parmi les autres mesures du projet de loi « industrie verte » en 13 articles qui sera proposé au parlement cet été, citons un crédit d’impôt « industrie verte » destiné à attirer des capitaux étrangers et pouvant atteindre 45 % des investissements engagés dans la production de batteries, d’éoliennes et panneaux solaires, inscrits dans le Clean Tech Act de Bruxelles. Pourtant, le bilan environnemental et la nocivité des batteries électriques, panneaux solaires ou des éoliennes qui massacrent l’avifaune et condamnent pour toujours des sols fertiles ou des écosystèmes marins, en versant des milliers de tonnes de bétons, sont connus. Leurs promoteurs ignorent comment les recycler et par ailleurs ferment les yeux sur les conditions de travail d’enfants chargés de recueillir pour quelques euros et au péril de leur vie, de grandes quantités de ressources minières. Aussi n’est-il pas certain que l’industrie et l’énergie dites vertes et imposées par l’UE soient moins sales et plus vertueuses que les énergies fossiles.
L’industrie manufacturière des biens de consommation était auparavant composée d’une multitude d’entreprises qui formaient ensemble des écosystèmes industriels complets disséminés sur l’ensemble du territoire français mais s’étaient constitués en plus d’un siècle. On peut toujours relocaliser quelques productions dont l’assemblage de pièces importées serait robotisé en France mais on ne peut pas parler de réindustrialisation. Quelques relocalisations ne compenseront pas le départ d’usines soumises à des normes françaises sans équivalant dans le reste du monde ainsi qu’à un coût de l’énergie en hausse pendant que d’autres pays industrialisés ouvrent chaque an des centaines de centrales à charbons et gaz.
L’affaiblissement du PIB industriel aggrave les déficits publics
En 2017, la part de l’industrie dans le PIB affichait 12.6 % dont 10.2 % de part manufacturière. Bruno Le Maire annonce un montant actuel de 10 % de PIB industriel. Si l’on souhaite cerner l’état et la nature de notre industrie pour mieux appréhender la difficulté de réindustrialiser, il nous faut, à partir de ce chiffre, soustraire 20 % constitués en moyenne par l’industrie extractive mais aussi 20 % correspondant au secteur agroalimentaire moins structurant et qui exige généralement moins de technologies, de recherches et dépôts de brevets que la construction d’automobiles ou de centrales nucléaires. Aussi peut-on évaluer aujourd’hui le PIB industriel manufacturier hors agroalimentaire autour de 6 %.
L’hécatombe se poursuit avec les 130 rachats d’entreprises stratégiques par des étrangers en 2022 et la fermeture à terme de plusieurs centaines de leurs sous-traitants situés dans l’hexagone mais aussi bientôt la mise à mort de l’industrie automobile thermique française qui était le dernier des grands secteurs de l’industrie manufacturière des biens de consommation après l’agroalimentaire. Il est à craindre que la décarbonation à marche forcée de l’industrie de produits manufacturés fasse encore perdre 1 à 2 points de PIB industriel d’ici la fin du mandat d’Emmanuel Macron et ne creuse davantage les déficits publics.
3 000 milliards d’euros d’endettement, une baisse du nombre de cotisants aux régimes sociaux au rythme de la désindustrialisation, la faillite des services publics impuissants face à des urgences sanitaires, l’insécurité et l’immigration. Pauvreté et nombre croissant d’allocataires du RSA et de bénéficiaires des aides alimentaires, toujours plus de sans-abris etc.
Quelles solutions pour sortir de cette impasse économique ?
Il est évidemment impossible de reconstruire la France industrielle des années 70 ni même, à ce stade de désindustrialisation et à la fin d’un cycle, de réindustrialiser significativement notre pays. J’expliquais ce mécanisme des cycles dans le magazine Marianne : « les économies suivent généralement le même cheminement agricole, industriel puis des services. Ainsi, les pays les moins développés dont ceux d’Afrique subsaharienne, ne peuvent enjamber une progression des cycles, de même que les pays anciennement industrialisés se heurtent à un effet cliquet post-industriel qui empêche un parcours inverse. ». Il n’y aura sans doute pas de réindustrialisation au sens propre. Aussi convient-il d’élaborer maintenant un modèle qui permette à des entreprises françaises de bénéficier de nouvelles marges de manœuvre en termes de pondération de coûts de production mais aussi de nouveaux marchés.
Par ailleurs, sur le continent voisin, la mise en œuvre d’un programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans, s’avère indispensable et urgente. Car 9 personnes vivant dans l'extrême pauvreté sur 10 vivront en Afrique subsaharienne en 2030 et sa population passera d'1 milliard d'habitants à 2 en 2050 puis 4 en 2100.
Alors si l’on considère d’une part, que les produits français sont rarement compétitifs dans le contexte de mondialisation mais qu’on ne peut installer des mesures protectionnistes interdites par les traités de libre-échange de l’UE et que d’autre part, l’Afrique subsaharienne doit s’industrialiser pour éviter un chaos humanitaire sans précèdent mais pourrait cependant offrir des coûts concurrentiels dans des industries manufacturière à forte main d’œuvre, il pourrait dès lors s’avérer pertinent de nouer de nouveaux partenariats industriels.
De nombreuses entreprises françaises qui disposent de savoir-faire et technologies mais souhaitent réduire leur dépendance envers la Chine, accepteraient de transférer une part de leurs chaines de valeur mondiales vers l’Afrique subsaharienne pour élargir leurs marchés. Nous pourrions nous appuyer sur l’atout de la francophonie et sur une forte diaspora riche d’une jeunesse souvent ambitieuse dont des membres diplômés et volontaires nous ont fait part de leur désir de s’investir dans un vrai projet de développement de l’Afrique subsaharienne. Cela permettrait de restaurer une relation mise à mal par de nouveaux acteurs économiques ou prédateurs. Les échanges profiteraient à nos économies respectives.
Francis Journot est consultant et entrepreneur. Il dirige le Programme industrialisation Afrique subsaharienne ainsi que le Plan de régionalisation de production Europe Afrique et Africa Atlantic Axis. Il fait de la recherche dans le cadre d’International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

L’Afrique subsaharienne va-t-elle se laisser confisquer son industrialisation au nom du climat ?
L’Afrique subsaharienne pourrait construire une importante industrie manufacturière de biens de consommation. Cela permettrait ainsi de répondre à une demande intérieure croissante et d’exporter une valeur ajoutée qui lui procurerait les moyens de financer ses infrastructures. Mais les Objectifs de développement durable (ODD) semblent aller à l’encontre de l’essor de l’Afrique subsaharienne.
De nombreuses conditions sont réunies pour construire une industrie manufacturière
Parmi celles-ci, citons des salaires concurrentiels même s’il faut, ainsi que le préconise notre projet International Convention for a Global Minimum Wage, en finir avec des conditions indignes. Par ailleurs, des pays d’Europe connaissent, hors agroalimentaire, une fin de cycle industriel dans de nombreux secteurs mais ne veulent pas augmenter leur dépendance à la Chine. Cela peut offrir de nombreuses opportunités à l’Afrique subsaharienne. J’expliquais le phénomène des cycles dans le magazine Marianne : « Les économies suivent généralement le même cheminement agricole, industriel puis des services. Ainsi, les pays les moins développés dont ceux d’Afrique subsaharienne, ne peuvent enjamber une progression des cycles, de même que les pays anciennement industrialisés se heurtent le plus souvent à un effet cliquet post-industriel qui empêche un parcours inverse. » Ajoutons à cela, le dynamisme de sa démographie et une jeunesse volontaire de plus en plus diplômée voulant s’investir. Les besoins d’équipement des ménages seront croissants et la construction d’une industrie manufacturière de biens de consommation est indispensable. Elle procurerait d’innombrables perspectives en termes d’emplois et de prospérité.
Mais les objectifs de développement durable (ODD) empêchent l’industrialisation de l’Afrique
Dans un article publié dans le journal Le Figaro en 2021, j’écrivais déjà : « L'approche des Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l'ONU pour 2030 au premier rang desquels figurent l'extrême pauvreté et la faim, est holistique. Mais les 17 objectifs voulus indivisibles et transversaux, s'opposent souvent entre eux. Ainsi le financement de projets uniquement lorsqu'ils répondent aux critères verts, durables ou numériques, va empêcher l'émergence d'une industrie manufacturière des biens de consommation et abandonner de nombreuses populations à leur sort. ». Clairement, la politique dite durable va à l’encontre de l’inclusif, de la diminution de l’extrême pauvreté et de la malnutrition.
Energies fossiles : deux poids, deux mesures
Alors que la Chine, l’Inde, les USA et l’UE continuent d’ouvrir des centaines de centrales à charbon et à gaz, il peut sembler peu équitable ou abusif d’empêcher l’Afrique subsaharienne dont le CO2 représente moins de 2% des émissions mondiales, d’utiliser quelques-unes de ses ressources indispensables au développement de son économie. Il faut certes avant tout préserver au mieux l’environnement dont la faune et la flore mais nul ne souhaite transformer l’Afrique subsaharienne en gigantesque usine du monde. Aussi faut-il trouver une juste mesure afin que celle-ci puisse produire au moins une part de ses biens de consommation et exporter de la valeur ajoutée pour obtenir une croissance suffisante, financer son progrès et répondre aux besoins de ses populations.
Après l’échec des politiques passées, il faut un cadre clair et pragmatique, structuré et structurant
La politique postcoloniale d’Aide publique au développement (APD) dont le montant avoisine 1500 Mrds de dollars en 60 ans, a échoué. De même, on cherche en vain la réussite du PAL (Plan d’Action de Lagos) mis en œuvre en 1980 par l’OUA ou une avancée concrète de l’Agenda pour 2063 écrit par l’UA lors de l’Accord de Paris sur le climat en 2015 (COP 21) et s’appuyant surtout sur la politique plus idéologique qu’économique des ODD. Si l’on en croit IndustriALL Global Union qui regroupe 50 millions de travailleurs, « D'innombrables stratégies d'industrialisation de l'Afrique ont été adoptées, depuis l'Agenda 2063 de l'Union africaine, et ce, du niveau continental jusqu'aux politiques industrielles nationales, mais le décollage ne se produit pas ».
En 2018, la Banque Mondiale dévoilait la probabilité d’une région subsaharienne qui concentrera 90 % de l'extrême pauvreté mondiale en 2030. Aussi est-il urgent d’appliquer un programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans. Afin d’économiser plusieurs années et des centaines de milliards d’euros d’investissement en recherche et développement (R&D), structuration industrielle etc., nous devons aller nous-mêmes démarcher et convaincre, schémas de process de production à la main et projections financières à l’appui, les grandes entreprises qui produisent aujourd’hui en Chine, d’inclure l’Afrique subsaharienne dans leurs étapes de chaînes de valeur mondiales (CVM). Notre vision à 360° permettra d'engager simultanément l’ensemble des actions dont recherche d'investisseurs et constitution de fonds financiers, organisation d'infrastructures et de complexes industriels, formation, mais surtout une communication qui génèrera une dynamique mondiale et fédèrera autour de ce grand dessein pour l’Afrique.
Francis Journot est consultant et entrepreneur. Il dirige le Programme industrialisation Afrique subsaharienne ainsi que le Plan de régionalisation de production Europe Afrique et Africa Atlantic Axis. Il fait de la recherche dans le cadre d’International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Il faut remplacer l’Aide publique au développement (APD) de l’Afrique subsaharienne par un programme clair doté d’un fonds

Les contribuables français ne souhaitent sans doute pas qu’une part de leurs impôts continue d’être dilapidée dans une politique d’Aide publique au développement (APD) qui échoue depuis 60 ans en Afrique subsaharienne. Aussi faut-il en finir avec cette gabegie d’argent public pour encourager un programme africain cohérent et doté d’un fonds d’investissement privé viable.
Une dangereuse absence de volonté de développement de l’Afrique subsaharienne
L’inefficience de l’Aide publique au développement est dénoncée depuis 6 décennies et l’OCDE a pointé du doigt son saupoudrage et sa dispersion. Déjà, l’agronome René Dumont dans les années 60, les économistes Jean-François Gabas en 1988, Jeffrey Sachs en 1990, William Easterly en 2001 ou Dambisa Moyo dont le bestseller « L’aide fatale : Les ravages d’une aide inutile et de nouvelles solutions pour l'Afrique » était couronné par le New York Times en 2009, dénonçaient la méthode de l’APD.
Plus de 20 milliards d’Aide publique au développement en 2025
Ainsi que les récents évènements africains le démontrent, le respect ne s’achète pas. La distribution de dizaines de milliards d’euros n’a pas permis d’éviter la défiance envers la politique africaine de l’Elysée. L’aide publique au développement distribuée par l’Agence Française pour le Développement (AFD), le plus souvent sans retour, coute en 2023, 16 milliards d’euros au contribuable français dont une part importante consacrée à l’Afrique. Avec l’objectif de 0.7 % du PIB en 2025, la contribution de la France grimpera à plus de 20 milliards d’euros. L’établissement public qui employait déjà près de 4 000 personnes, grossit constamment et a récemment absorbé Expertise France et ses 1 600 collaborateurs.
Une politique inopérante qui pourrait coûter plus de 1 500 Mrds à la France
Les prévisions démographiques et indices de pauvreté de l’Afrique subsaharienne sont alarmants. Certes, le budget mondial de l’Aide au développement dépasse 204 milliards d’euros en 2023 avec une part importante versée à l’Afrique subsaharienne et l’UE veut consacrer à la région, la moitié des 300 Mrds d’euros destinés au Global Gateway. Mais la méthodologie qui ne varie guère, ne permettra pas d’éviter le chaos humanitaire sans précédent annoncé. En ce cas, les aides de la communauté internationale pour faire face à la crise, devraient alors être multipliées par 2 ou 3. Le coût pour la France qui comprendrait une multitude de dépenses liées aux effets connexes, directs ou indirects dont ceux de l’immigration, pourrait se situer au-delà de 1 500 Mrds d’euros en 20 ans.
Un programme économique doté d’un fonds privé efficient pour ne plus investir à perte
Le fonds d’investissement dédié au « programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » servirait, à moyen et long terme, une rémunération des capitaux qui certes, ne rivaliserait pas avec celle des produits financiers les plus performants mais séduirait néanmoins des pays, investisseurs institutionnels et privés soucieux d’afficher des valeurs de RSE et d’inclusivité tout en préservant leurs investissements dans un fonds à la gestion sérieuse et prudente. Ainsi que mon dernier article dans la Tribune Afrique l’explique, « Pour amorcer la réussite de l'Afrique subsaharienne, il faut un programme d’industrialisation de 1 000 milliards d'euros en 20 ans ». Le montant qui peut sembler considérable doit être à la hauteur du défi en termes d’emplois mais aussi en matière de fourniture de biens de consommation nécessaires à une population subsaharienne dont le nombre devrait atteindre 2 milliards d’habitants en 2050 et 4 en 2100.

Macron en Afrique subsaharienne : pour quoi faire ?
Emmanuel Macron veut refonder des liens avec des pays d’Afrique subsaharienne mais n'apporte guère de solutions capables de répondre aux préoccupations économiques de la jeunesse africaine.
La Chine s’est développée en 20 ans parce que les occidentaux ont apporté leurs industries. Ainsi que nous le prônons dans notre programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans, nous devons aller nous-mêmes démarcher et convaincre, schémas de process de production à la main et projections financières à l’appui, les grandes entreprises qui produisent aujourd’hui en Chine, d’inclure l’Afrique subsaharienne dans leurs étapes de chaînes de valeur mondiales (CVM). Puis faciliter leur implantation en organisant des écosystèmes locaux tout en préservant scrupuleusement l’environnement etc. La méthode qui produira rapidement des effets, sera dix fois moins onéreuse que celle de l'AFD pour infiniment plus de résultats probants. Pour financer notre structure qui devra donc s’entourer de plusieurs centaines d’ingénieurs impliqués dans la construction en moins de 15/20 ans du nouveau paradigme, il suffira de rediriger vers celle-ci, des budgets actuellement peu efficaces en termes de développement et d’industrialisation de l’Afrique. Une réappropriation de productions chinoises, des mécanismes de péréquation ou de mutualisation des coûts, des collaborations et économies d’échelle, repartis sur les 2 continents et au sein de nouveaux modèles d’intégration verticale, permettront à des entreprises d’augmenter leur compétitivité. A terme, plusieurs centaines de milliards d’euros de nouveaux échanges pourraient rééquilibrer des balances commerciales déficitaires dont celles de la France et de pays d’Afrique mais aussi d’Europe. Francis JOURNOT

Il faut lutter pour l'industrialisation de l'Afrique mais le décollage ne se produit pas IndustriALL Union
Malgré les stratégies de l'Agenda 2063 de l'Union Africaine (UA), le développement ne se produit guère : "D’innombrables stratégies d’industrialisation de l’Afrique ont été adoptées, depuis l’Agenda 2063 de l’Union africaine, et ce, du niveau continental jusqu’aux politiques industrielles nationales, mais le décollage ne se produit pas " IndustriALL Global Union représente 50 millions de travailleurs dans 140 pays.

Interview de Francis JOURNOT à propos des Partenariats public privés (PPP) par Thaïs Brouck pour JEUNE AFRIQUE
Je suis journaliste à Jeune Afrique. Dans le cadre d'un dossier sur le financement des infrastructures en Afrique notamment via les PPP, j'aimerais faire appel à votre expertise sur le sujet dans le cadre d'une interview. (juillet 2023)
Jeune Afrique : Vous ne semblez pas être très favorable au recours au PPP en Afrique. Pour quelle raison ?
Francis Journot : Il est évident que des micros PPP dont l’enjeu financier est faible mais qui améliorent sensiblement les conditions de vie de populations pauvres, sont très utiles. De même, lorsque le signataire privé d’un PPP, n’est pas le bras armé d’un Etat animé par des velléités de prédation de terres ou richesses minières, n’effectue pas de versements occultes pour emporter le marché, n’est pas l’instrument de lobbys voulant vendre à tout prix leurs éoliennes ou panneaux solaires et dont l’ultime ambition consiste à vouloir en tapisser le désert même si cela risque à terme d’augmenter la température terrestre et enfin, a conditions qu’un optimisme excessif ou des jeux d’influence politique, n’aient pas perverti les études financières de faisabilité, alors un partenariat public privé peut s’avérer profitable pour chacune des parties.
Jeune Afrique : N'est-ce pas un moyen d'attirer les capitaux et de financer les infrastructures si nécessaires au continent ?
Francis Journot : C’est surtout un moyen promu par des institutions internationales et agences de développement dont on peut craindre que la vision soit plus idéologique qu’économique. Financer la construction d’infrastructures énergétiques, est certes très louable. Mais si au terme de l’installation de ces services, les entreprises industrielles potentiellement utilisatrices et hautement structurantes en termes d’activité et d’emploi, sont inexistantes, les consommateurs, entreprises ou particuliers, susceptibles de payer des abonnements seront souvent insuffisants. Aussi, sans nouvelles ressources fiscales, les Etats ne pourront le plus souvent, guère honorer les nouvelles créances. Le postulat selon lequel il suffit d’installer des infrastructures pour qu’un miracle économique s’ensuive, s’est souvent révélé erroné.
Jeune Afrique : Dans le contexte actuel de raréfaction du crédit, les PPP ne constituent-ils pas un avantage ?
Francis Journot : Si l’on considère qu’un défaut de paiement dans le cadre d’un important PPP puisse conduire un Etat à brader ses richesses ou se retrouver placé en cessation de paiement avant de devoir accepter les dures conditions d’un plan d'apurement des dettes proposé par le FMI, alors non le PPP n’est pas forcement pas la solution. C’est pourquoi précisément, je travaille depuis plusieurs années sur un « programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » qui tient compte davantage des paramètres économiques et interdépendances. Il faut avancer simultanément sur tous les fronts et s’appuyer sur de mécanismes économiques éprouvés. Seule une méthodologie crédible attirera les investisseurs sérieux.

Après l’échec du Plan d'action de Lagos (PAL) de 1980, l’Agenda 2063 de l’Union africaine (UA) créé en 2015, échoue aussi
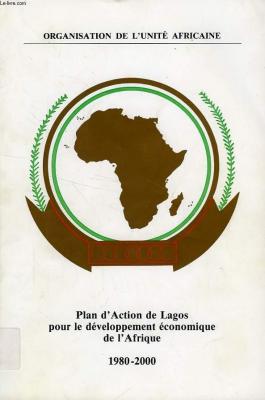 Le Plan d’action de Lagos (PAL) a été signé en avril 1980 par les chefs d'États africains de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). De multiples causes ont certes contribué à son échec, mais il convient surtout de s'interroger à propos d'un projet d'industrialisation qui, bien que l'Afrique subsaharienne ne disposait que de peu de bases industrielles ni d'echosystemes sur lesquels fonder un développement endogène, visait cependant une indépendance économique régionale pourtant impossible à bâtir en quelques années. Car n'oublions pas que la Chine à pu développer son industrie en 20 ans parce que les occidentaux ont apporté leurs technologies et savoir-faire industriels.
Le Plan d’action de Lagos (PAL) a été signé en avril 1980 par les chefs d'États africains de l'Organisation de l'unité africaine (OUA). De multiples causes ont certes contribué à son échec, mais il convient surtout de s'interroger à propos d'un projet d'industrialisation qui, bien que l'Afrique subsaharienne ne disposait que de peu de bases industrielles ni d'echosystemes sur lesquels fonder un développement endogène, visait cependant une indépendance économique régionale pourtant impossible à bâtir en quelques années. Car n'oublions pas que la Chine à pu développer son industrie en 20 ans parce que les occidentaux ont apporté leurs technologies et savoir-faire industriels.
Mais les rédacteurs de l'Agenda 2063 de l’Union africaine, version modernisée du plan d'action de Lagos, semblent avoir reproduit les mêmes erreurs 35 ans plus tard. L'enlisement dès les premières années du projet de l'UA était très prévisible d’autant que le dogme du climat et du durable va résolument à l’encontre du développement industriel.
A défaut d'autre projet officiel, les institutions internationales affirment encore soutenir l’Agenda 2063 de l’UA tout en sachant que son échec, en termes de développement et de création d'emploi, est déjà avéré. Prôner le développement du durable et TIC est utile mais ne suffit pas pour sortir de l'économie informelle et fournir chaque an des emplois aux 20 millions de subsahariens qui arrivent sur le marché du travail.
L'approche des Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l'ONU pour 2030 au premier rang desquels figurent l'extrême pauvreté et la faim, est holistique.
Mais les 17 objectifs voulus indivisibles et transversaux, s'opposent souvent entre eux. Ainsi le financement de projets uniquement lorsqu'ils répondent aux critères verts, durables ou numériques, va empêcher l'émergence d'une industrie manufacturière des biens de consommation et abandonner de nombreuses populations à leur sort. Francis Journot
 Tribune de *Francis Journot: «Il faut transférer de la Chine à l’Afrique, une part de la production industrielle »
Tribune de *Francis Journot: «Il faut transférer de la Chine à l’Afrique, une part de la production industrielle »
Ce changement de paradigme mondial permettrait de moderniser l’Afrique et offrirait à certains pays la possibilité de s’extraire de la spirale du piège chinois de la dette africaine pour ainsi préserver leur souveraineté. L’installation d’infrastructures et d’outils industriels d’entreprises souvent occidentales ainsi que la création d’un important tissu d’entreprises locales, génèreraient sur le sol africain, des dizaines de millions d’emplois plus rémunérateurs que ceux du secteur informel. Cette mutation qui s‘inscrirait néanmoins dans le respect de l’environnement, favoriserait de nouveaux échanges entre des Etats africains et leurs partenaires fréquemment français, européens, américains et parfois asiatiques. Elle augmenterait la croissance de chacun d’entre eux.
Quand l’idéologie empêche le développement de l’Afrique et maintient la pauvreté
Lors de sommets internationaux, au moment où l’extrême pauvreté et la famine font plus de ravages que jamais, des occidentaux et des africains bien nourris expliquent fréquemment à une population qui compte 250 millions d’habitants souffrant de malnutrition dans une Afrique quasiment dépourvue d’industrie qui émet peu de co2, que les priorités doivent être cependant la transformation numérique et une transition verte aux contours incertains. Pensée technocratique, cynisme, dogmatisme ou méconnaissance de l’économie africaine, chacun jugera. Mais la priorisation de propositions insuffisantes ou illusoires qui ne produiront pas d’effets significatifs rapides en matière économique, est de nature à retarder le développement du continent et à aggraver la pauvreté.
Un modèle qui pourrait répondre aux aspirations de la jeunesse africaine
Fin 2020, dans un article publié sur La Tribune Afrique intitulé «Afrique subsaharienne: le capitalisme pourrait réussir là où ou l’aide au développement échoue depuis 60 ans », nous nous interrogions à propos de l’efficacité d’une aide publique qui a dépassé 1000 Mrds de dollars mais n’a pas réussi à faire diminuer un emploi informel qui concerne encore 85 à 89 % de la population active subsaharienne. Des entreprises industrielles offriraient des emplois mieux rémunérés. L’augmentation raisonnable des salaires de production que nous prônons dans nos études relatives au projet «International Convention for a Global Minimum Wage», contribuerait aussi à une élévation du niveau de vie des populations et accélérait le développement de l’Afrique. Cela pourrait répondre au souhait de nombreux africains qui voudraient mieux vivre de leur travail et rompre avec une assistance certes bienveillante et souvent indispensable mais qui renvoie une image négative qu’ils veulent changer.
Plan structuré de régionalisation industrielle en Afrique subsaharienne
Ainsi que nous l’avons déjà écrit dans Le Figaro, « Réduire notre dépendance à la Chine, c'est possible! ». Mais seul un «plan de régionalisation de production Europe Afrique», réaliste et structurant mais tenant compte aussi des nouveaux paramètres géopolitiques et géoéconomiques, pourrait réussir. Une implication financière même modérée de chacun des pays qui souhaiteraient renforcer leur présence économique pour accroître leurs échanges avec l’Afrique dans le cadre du programme, s’avèrerait indispensable. Les entreprises originaires de ces États signataires étrangers pourraient bénéficier d’un accompagnement facilitant leur implantation (recrutement et formation, assistance juridique, fiscale et administrative, financements, études etc.) qui contribuerait à une attractivité pour l’Afrique subsaharienne. Nous saurons bâtir les schémas industriels globaux au sein desquels elles pourront se projeter et qui les convaincront de déménager une part de leur production. Il conviendra de rechercher une complémentarité sectorielle pour constituer des écosystèmes performants et cohérents. Cette proximité permettra ainsi de réduire au sein de chaines de valeur mondiales (CVM), le transport de matières ou pièces.
Un programme concret et aisément finançable
Le coût de construction des bases industrielles dont accès routiers, ferroviaires, aéroportuaires ou portuaires, fourniture énergie, réseaux télécommunications, travaux de voirie, gestion des déchets mais aussi dispositifs de sécurité, habitations, écoles, centre médicaux et commerces indispensables, seraient éligibles au financement par les grandes institutions internationales et pays donateurs dans le cadre du développement de l’Afrique. Le montant dépensé pour chaque site industriel qui sortirait de terre tous les 2 ou 3 ans, avoisinerait 3/5 Mrds euros. A l’opposé de politiques ou de propositions économiques, internationales ou locales, souvent creuses et sans lendemain mais qui sclérosent depuis 60 ans le développement de l’Afrique subsaharienne, le programme «Africa Atlantic Axis» pourrait au contraire être mis en œuvre à moyen terme si toutefois, les populations des pays africains les plus concernés le souhaitent. Les institutions financières internationales ne pourraient que s’associer à ce projet de progrès pour l’Afrique. En effet, ce processus d’intégration industrielle augmenterait les ressources budgétaires des États. Il permettrait une sécurisation de territoires, élèverait le pouvoir d’achat de populations et offrirait les énormes perspectives de développement d’un continent dont la construction économique nécessiterait l’énergie de toute sa jeunesse.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot est le fondateur du « Programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne en moins de 20 ans » ou Africa Atlantic Axis (AAA). Il est aussi l’initiateur du projet « International Convention for a Global Minimum Wage »
![]()
Réduire notre dépendance à la Chine, c'est possible!
Tribune de Francis Journot - Peut-être pourrions-nous, afin de résoudre notre problématique de croissance au cours des années à venir mais aussi en même temps contribuer au recul de la pauvreté dans un continent proche qui connaît une démographie exponentielle, réfléchir à un modèle élargissant notre coopération avec celui-ci.
La Chine pervertit plus qu’elle n’enrichit le continent africain
Aujourd'hui, la Chine compte mettre la main sur cet énorme réservoir de matières premières. Mais elle pervertit plus qu’elle n’enrichit ce continent en le submergeant de produits low cost provenant d’Asie et précarise davantage ainsi des artisans ou des petites entreprises qui fabriquaient des produits locaux. Les usines créées appartiennent à des sociétés dépendantes de Pékin dont les contremaîtres chinois dirigent durement des ouvriers comptant parmi les plus mal payés au monde. Ces bas niveaux de rémunération permettent ainsi à la Chine d’inonder les pays occidentaux de produits bas de gamme sans que les peuples africains y trouvent leur compte en matière d’avancées sociales. Mais cette colonisation rampante de plus en plus mal vécue, suscite de l’amertume.
Davantage d’autonomie industrielle
Il est indispensable que l’Afrique se dote des moyens d’assurer la subsistance de sa population tout en prenant garde de préserver sa faune et sa flore. De nombreux ingénieurs souhaitant un essor de l’Afrique et du Maghreb accueilleraient avec enthousiasme ce projet transcontinental de création de co-entreprises au sein de clusters sectoriels. Ces nouveaux outils de production qui s’intègreraient d’abord dans des chaines d’approvisionnement européennes, favoriseraient le développement économique des pays et auraient vocation à leur faciliter l’accès à davantage d’autonomie industrielle. Le coût de l’installation des usines serait assuré par les enseignes ou marques destinataires des productions. Les entreprises, organisées en collectifs, pourraient ainsi bénéficier d’une mutualisation des coûts mais aussi d’une modularisation des productions dans certains secteurs. Ces activités procureraient de nouvelles opportunités locales à de jeunes générations aujourd’hui tentées par l’immigration vers l’Europe. Des fonds jugés inefficients parmi ceux alloués aujourd’hui au développement et au soutien des pays, pourraient être réorientés vers la construction des infrastructures nécessaires qui profiteraient ainsi à tous car il semble plus pertinent d’investir en amont en créant de l’emploi et en générant une augmentation du niveau de vie local plutôt qu’agir continuellement en aval. En effet, l’assistance certes bienveillante et souvent indispensable renvoie cependant une image que ce continent souhaite effacer pour changer la perception du monde et progresser. Des groupements de sociétés rentables et en croissance attireraient certainement des capitaux mondiaux qui abonderaient ensuite les nouveaux projets et accompagneraient l’expansion du modèle à travers le continent pour en faire peut être un nouvel eldorado.
Une hausse du niveau de vie en Afrique encouragerait l'éducation des enfants, l'émancipation des femmes et à terme, une réduction de la natalité
Ce partenariat prolifique pour l’Afrique le serait aussi pour l’Europe qui a besoin de nouvelles perspectives. La mise en œuvre du projet réclamerait le concours de nombreuses sociétés expertes en engineering industriel, énergie, construction, numérique, formation dans les nombreux secteurs, ressources humaines etc… Le nombre de postes à cheval sur les deux continents serait considérable. La France a conservé des liens privilégiés avec la plupart des pays et aurait une carte importante à jouer. Subséquemment, le continent africain pourrait à terme constituer pour l’Europe, un nouveau relais de croissance qui comblerait un affaissement de la demande chinoise d’autant que celui-ci compte autant d’habitants que la Chine. Leur pouvoir d’achat n’est pas comparable mais souvenons-nous qu’à l’aube de ce millénaire, le PIB chinois par tête était semblable à celui de la plupart des pays africains qu’elle a aujourd’hui entrepris de coloniser. Il est difficile d’appréhender toute la dimension d’un tel projet de régionalisation tant les implications et possibilités sont multiples en termes d’emplois et de création de richesse. Les prévisions démographiques annoncent un doublement de la population africaine d’ici trente ans mais on peut penser qu’une hausse du niveau de vie encouragerait l’éducation des enfants, l’émancipation des femmes et à terme, une réduction de la natalité. Une augmentation raisonnable et évolutive des salaires mensuels de production variant aujourd’hui le plus souvent entre 35 et 200 euros, pourrait accélérer cette mutation sociologique. Il serait donc possible de construire une alternative à la dépendance chinoise. Pourquoi se résoudre à un maintien de nos industries en Chine favorisant une hégémonie qui entravera nos libertés et nous exposera certainement tôt ou tard au risque d’une guerre mondiale alors qu’une régionalisation des échanges nous procurerait l’opportunité de consommer moins mais mieux sans pour autant, compte tenu de la concurrence internationale, faire flamber les prix et nous offrirait de surcroît, une dynamisation économique et la création de millions d’emplois au moment où le chômage fait des ravages en Europe tout en permettant au continent voisin d’accéder à davantage de progrès social.
"Un nouveau schéma économique est possible", argumente Francis Journot
Les économies suivent généralement le même cheminement agricole, industriel puis des services. Maintenant, l’économie quaternaire ou numérique se nourrit de services dont l'uberisation mais aussi d’interdépendances et d’interactions avec les stades primaires et secondaires qui ont structuré les économies de pays. Ainsi, les pays les moins développés dont ceux d’Afrique subsaharienne, ne peuvent enjamber une progression des cycles, de même que les pays anciennement industrialisés se heurtent le plus souvent à un effet cliquet post-industriel qui empêche un parcours inverse. Notre programme propose depuis 2020, un transfert de chaines de valeur mondiales (CVM) souvent installées en Chine. Cette stratégie favoriserait le développement de l’Afrique subsaharienne tout en procurant de nouvelles perspectives et de la croissance à nos entreprises industrielles et à l’économie française ou européenne.
Francis Journot : «La France doit devenir la locomotive de l'UE en matière d'industrie»
Le protectionnisme est impossible dans le cadre de l’UE et nous subissons la mondialisation. Mais nous pourrions, en usant de la puissance d’une vaste régionalisation, bâtir un paradigme efficient ainsi que précédemment exposé dans le Plan de régionalisation de production Europe Afrique. En élargissant le spectre de l’offre et de la demande selon une méthodologie stratégique, des mécanismes de péréquation pourraient permettre de restaurer de la compétitivité en France et de redynamiser ainsi certaines activités industrielles tout en en générant de nouvelles, tertiaires ou industrielles. Initiatrice et organisatrice de cet immense chantier, la France pourrait devenir la locomotive de l’UE.
![]()
Francis Journot: «Si l'Europe n'aide pas l'Afrique subsaharienne à s'industrialiser, l'immigration explosera»
La Communauté mondiale fait bonne figure en finançant des ONG et en distribuant l’aumône. Mais l’industrie et l'économie de l’Afrique subsaharienne se dégradent depuis 60 ans. Pour exemple, en République Démocratique du Congo (RDC), de 9600 entreprises industrielles héritées de la colonisation belge, le nombre est passé à 507 récemment recensées. Pourtant, la main d’œuvre abondante et les salaires inférieurs à ceux de pays occidentaux, présentent un avantage compétitif susceptible d’attirer des investissements. La construction d’une industrie manufacturière qui produirait ses propres biens de consommation créerait de l’emplo, ferait reculer l’extrême pauvreté et la faim. L’avantage concurrentiel permettra d’exporter.
La population d’Afrique subsaharienne devrait doubler d’ici 2050. Aussi est-il urgent que celle-ci développe, avec l’aide d’entreprises internationales, sa propre industrie manufacturière des biens de consommation, structurante, créatrice d’emplois mais aussi respectueuse de son environnement.Cependant, depuis que le sujet du climat s’est érigé en priorité absolue, on observe un fléchage des financements favorisant des projets verts ou numériques même lorsqu’ils ne créent pas d’emploi. Mais cette politique qui empêcherait l’industrialisation et maintiendrait l’Afrique dans la pauvreté, provoquerait de surcroît, une explosion des flux migratoires vers la France et d’autres pays de l’UE.
Le sujet de l’industrialisation de l’Afrique pour éviter un chaos est plus crucial que celui du climat
Si l’Afrique ne parvient pas à s’industrialiser et à se moderniser, nous assisterons à une multiplication des situations d’extrême pauvreté, de malnutrition et subséquemment, à un chaos sur le continent entier. Plusieurs centaines de millions d’africains parmi une population qui devrait compter 2.5 milliards d’habitants en 2050, souhaiteront alors à venir en France et en Europe pour fuir la faim et la mort. Les démocraties qui préservent les européens de la guerre et du désordre, ne pourront pas survivre à ce bouleversement. L’écroulement de la civilisation occidentale dans un futur plus ou moins lointain est souvent évoqué. Il pourrait désormais se produire en moins de 3 décennies. Que l’on pense que l’origine du changement climatique est surtout anthropique ou non, le sujet du développement économique de l’Afrique subsaharienne pour éviter un chaos, apparaît plus urgent que celui du climat.
Les institutions internationales sont conscientes de la crise sans précèdent qui se prépare
En Afrique subsaharienne, région où la démographie est la plus forte, le nombre de personnes souffrant de malnutrition était estimé à 236 millions en 2017 parmi 431 millions vivant dans l’extrême pauvreté. Selon les institutions internationales, ces chiffres pourraient doubler ou tripler au cours des années à venir. 30 millions de jeunes travailleurs arrivent chaque année sur le marché du travail africain mais seulement 10 à 15 % parmi eux trouvent un emploi. Par désœuvrement, certains rejoignent des sectes islamistes. L’Organisation Internationale du Travail (OIT) estime que les taux d’emploi informel chez les jeunes de 15 à 24 ans atteignaient en 2018 en Afrique Subsaharienne 94.9 % et jusqu’à 97.9 % (Sénégal) dans des pays francophones de l’Afrique de l’Ouest. L’ONU est consciente de la crise humanitaire qui se prépare car selon elle « Si la tendance actuelle se poursuit, en 2030, l'Afrique abritera plus de la moitié des personnes qui souffrent de manière chronique de la faim dans le monde ».
La politique de finance verte pourrait empêcher le développement industriel de l’Afrique
L’approche des Objectifs de développement durable (ODD) fixés par l’ONU pour 2030 au premier rang desquels figurent l’extrême pauvreté et la faim, est holistique. Mais les 17 objectifs voulus indivisibles et transversaux, s’opposent souvent entre eux. Le GIEC qui brandit la menace de 250 000 morts supplémentaires par an dues au changement climatique, réclame une neutralité carbone qui irait cependant à l’encontre d’une progression du travail et de l’industrie dans les pays émergents ou en développement. Cette politique va condamner des centaines de millions de gens à rester dans l’extrême pauvreté au moment où près de 900 millions sont sous alimentés dans le monde et qu’un million parmi eux meurent chaque mois de ce fléau. Alors réserver les financements à des projets uniquement parce qu’ils répondent aux critères verts ou numériques lorsque l’on sait que ceux-ci ne créeront pas ou peu d’emploi et échoueront le plus souvent faute d’infrastructures ou d’écosystèmes performants, serait peu judicieux. De plus, nul n’ignore que la misère en Afrique constitue un terreau fertile sur lequel prospère le terrorisme islamique. Aussi, cette politique de finance verte également revendiquée par l’Agence Française de Développement (AFD), pourrait avoir pour effets de maintenir l’Afrique subsaharienne dans le sous-développement et de fragiliser la France ainsi que d’autre pays.
Dégradation de l’industrie depuis la fin de la colonisation
Si l’on en juge par l’état actuel de l’industrie subsaharienne, on ne peut alors que s’interroger à propos de la méthode des institutions internationales et du manque de volonté d’industrialisation des décideurs africains ou occidentaux. La Communauté mondiale se trompe depuis 6 décennies mais fait bonne figure en finançant des ONG et en distribuant l’aumône. L’industrie et la situation économique de l’Afrique se dégradent depuis 60 ans. Pour exemple, en République Démocratique du Congo (RDC), de 9600 entreprises industrielles héritées de la colonisation belge, le nombre est passé à 507 récemment recensées. Pourtant, la main d’œuvre abondante et les salaires inférieurs à ceux de pays occidentaux, pourraient constituer un avantage compétitif qui pourrait attirer des investissements industriels. La construction d’une industrie manufacturière capable de produire ses propres biens de consommation constituerait le meilleur moyen de créer de l’emploi et d’éradiquer l’extrême pauvreté et la faim. L’avantage concurrentiel permettra d’exporter. Il faut rompre avec un discours condescendant et humanitariste tenu par ONG et institutions, selon lequel les africains ne peuvent trouver de salut économique qu’en migrant vers un occident qui serait responsable de tous leurs maux.
L’Afrique subsaharienne doit pouvoir produire des biens de consommation
Les nouvelles générations africaines ambitieuses, formées et diplômées sont prêtes à relever ce défi de l’industrie et de la modernisation, néanmoins seul un plan global d’industrialisation de l’Afrique subsaharienne le permettrait. Les biens achetés par les africains sont aujourd’hui surtout importés de Chine mais la proposition de « transférer de la Chine à l'Afrique, une part de la production industrielle », est bien accueillie par ceux-ci. Apres des cession plus ou moins consenties de savoir-faire et de technologies à des entreprises chinoises maintenant concurrentes et une méfiance grandissante, un « plan de régionalisation de production Europe Afrique » pourrait convaincre bon nombre de grandes entreprises à travers le monde, de modifier leurs chaines de valeurs mondiales (CVM). Compte tenu du coût élevé du travail dans la plupart des pays occidentaux ainsi que du poids des taxes et normes, les industries de main d’œuvre ne reviendront que très rarement. Cependant, des mécanismes de péréquation et de mutualisation des coûts, permettraient à des entreprises européennes de retrouver de la compétitivité. L’immense futur marché africain nous offrirait de nouvelles perspectives et favoriserait aussi la croissance en France et en Europe. Partages de savoir-faire et nouveaux échanges profiteraient aux Etats et populations des deux continents.
La dogmatique taxonomie verte de l’UE déjà mortifère pour l’économie européenne
Dans certaines entreprises industrielles, la facture de gaz et d’électricité a quasiment doublé en quelques années. Les taxes et normes affaiblissent des industries au bénéfice de la Chine. Des secteurs industriels sont laminés et mettront des millions de salariés européens au chômage. L’UE boude l’énergie nucléaire qui émet peu de Co2 mais promeut des produits de transition énergétique fabriqués en Chine dont batteries et voitures électriques aux empreintes écologiques dévastatrices ou éoliennes et panneaux voltaïques également en partie financés par des subventions françaises et européennes.
L’implication des femmes dans l’industrie ferait chuter le solde démographique et la pauvreté
Lorsque plusieurs dizaines de millions de femmes d’Afrique subsaharienne, dirigeront des entreprises artisanales ou plus importantes, occuperont des postes industriels et trois ou quatre fois plus d’emplois de services, indirects et induits, la natalité et le taux de pauvreté chuteront naturellement. Si l’on ajoute à cela, qu’une hausse du niveau de vie encouragera l’éducation des enfants et l’émancipation des femmes, le modèle familial évoluera. Ainsi le solde démographique africain décroitra de plusieurs centaines de millions d’habitants et déjouera les prévisions actuelles.
Sacrifier une part de l’humanité au nom du principe de précaution climatique, serait une folie
N’oublions pas, avant d’empêcher le développement de l’Afrique subsaharienne ou de détruire davantage d’équilibres économiques en Europe, que la climatologie est une science d’interactions dont par définition, la multiplicité des facteurs, les nombreuses disciplines impliquées et le manque de prévisibilité, devraient nous inciter à plus d’humilité et de prudence. On peut douter que le paradigme écologiste qui risque de mettre à mal de nombreuses économies à travers le monde et de condamner ainsi à la faim et à la mort des centaines de millions de pauvres notamment en Afrique subsaharienne, fasse l’unanimité parmi les individus les plus concernés. Les populations européennes pourraient également, lorsque les tsunamis migratoires auront eu raison des systèmes de protection sociale, de leur culture et de leur civilisation, regretter d’avoir cédé au dogmatisme. Aussi apparait-il hasardeux de prôner, au nom d’un principe de précaution climatique, une politique idéologique qui sacrifiera surement une part importante de l’humanité. Peut-être devrons-nous demain affronter le regard de nouvelles générations qui jugeront nos errements. Souhaitons que les institutions internationales prennent la mesure de leur responsabilité et des possibles conséquences de leur dangereuse politique.
Francis Journot est consultant et entrepreneur. Il dirige le Programme industrialisation Afrique subsaharienne ainsi que le Plan de régionalisation de production Europe Afrique et Africa Atlantic Axis. Il fait de la recherche dans le cadre d’International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Comment transformer l'Afrique subsaharienne en Eldorado
Monsieur Journot, comment avez-vous eu l’idée du programme pour l’industrialisation de l'Afrique subsaharienne en moins de 20 ans ?
Le programme pour l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne en moins de 20 ans n’est pas à proprement parler juste une idée mais résulte plutôt du cheminement de mes travaux économiques entrepris en 2010 à propos de la désindustrialisation de l’hexagone. J’avais fait le constat de la disparition de pans entiers de l’industrie française et de la disparition de tissus industriels vers 2005 alors que l’une de mes activités professionnelles m’avait conduit à travailler avec des façonniers textiles des régions de Roanne et Troyes dans le cadre d’une marque de vêtements « made in France » vendue surtout à New-York. Les sous-traitants qui ne pouvaient lutter contre la concurrence étaient placés en liquidation judiciaire et disparaissaient les uns après les autres. Un rapport commandé par l’Etat français révélait que la filière de la façon ne comptait plus que 6 000 employés fin 2008 et perdait jusqu’à 1 000 emplois par an.
Pour alerter sur la désindustrialisation et le risque de voir la balance commerciale française atteindre un jour des déficits record ainsi que c’est évidemment le cas maintenant, j’ai écrit plus de 150 tribunes et analyses publiées sur Marianne, Le Figaro, entreprendre etc., fédéré plusieurs dizaines de milliers d’abonnés sur mes réseaux sociaux consacrés à cette cause mais aussi travaillé à l’élaboration d’un concept d’industrialisation détaillant en cent pages, un modèle d’intégration verticale applicable dans de nombreux secteurs industriels puis un autre en 2016 reprenant les mêmes principes de mécanismes de péréquation et de mutualisation de coûts mais offrant aussi un mode de financement inédit impliquant l’Etat qui en recueillerait les fruits, dévoilé pour l’occasion dans un article de 12 pages sur le Figaro.
En quoi votre expertise économique et l’expérience française de la désindustrialisation peuvent servir l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne ?
Pour industrialiser l’Afrique subsaharienne, il faut appréhender le phénomène des cycles. Pour résumer mon propos précèdent, la France a passé son tour en termes d’industrie manufacturière des biens de consommation. On peut toujours relocaliser quelques industries robotisées mais cela ne créera que peu d’emploi. Dans mon article sur Marianne à propos des obstacles à la réindustrialisation, j’expliquais que « Les économies suivent généralement le même cheminement : agricole, industriel puis celui des services. Maintenant, l’économie quaternaire ou numérique se nourrit de services avec l'ubérisation mais aussi d’interdépendances et d’interactions avec les stades primaires et secondaires qui ont structuré les économies de pays. Ainsi, les pays les moins développés dont ceux d’Afrique subsaharienne, ne peuvent enjamber une progression des cycles, de même que les pays anciennement industrialisés se heurtent le plus souvent à un effet cliquet postindustriel qui empêche un parcours inverse. » A la fin de cette tribune, j’écrivais que la France dispose de l’atout de la Francophonie et de liens uniques avec un continent africain aux portes de l’Europe qui pourrait compter 2 milliards d’habitants en 2050. On peut convaincre des entreprises françaises, européennes ou américaines de transférer en Afrique subsaharienne, une part de leurs chaînes de valeurs mondiales (CVM) installées en Chine. Cette stratégie favoriserait le développement de cette région tout en procurant de nouvelles perspectives et de la croissance à nos entreprises industrielles et à l’économie française ou européenne.
Est-ce qu’il y a d’autres enseignements à tirer ou d’autres similitudes entre la France et l’Afrique ?
Dans un édito en mars 2023 sur Valeurs Actuelles, j’exposais « La communication ou la politique industrielle française dans l’hexagone et en Afrique sont semblables. Bien que n’empêchant guère la désindustrialisation, le gouvernement se targue de vouloir réindustrialiser la France tandis qu’en Afrique, il prône l’industrialisation tout en réservant les financements aux projets écologiques ou les moins industriels qui ne créent que peu d’emplois directs, indirects et induits. » Les Objectifs de Développement Durable (ODD) définis par l’ONU en 2015, régissent maintenant les politiques industrielles de pays développés qui acceptent d’appauvrir leurs économies et leurs populations ou celles de pays en développement et émergents comme ceux d’Afrique subsaharienne qui ne peuvent ainsi s’industrialiser et se développer pour satisfaire aux nouvelles exigences dites durables et climatiques.
Les débats sur l’immigration africaine font florès actuellement en France et en Europe. Comment votre projet pourrait contribuer à une diminution de la démographie et de l’immigration ?
Pour mieux illustrer le long parcours du projet, je vais vous citer ma première réflexion en la matière, publiée sur Le Figaro en juin 2020 : « Les prévisions démographiques annoncent un doublement de la population africaine d’ici trente ans mais on peut penser qu’une hausse du niveau de vie encouragerait l’éducation des enfants, l’émancipation des femmes et à terme, une réduction de la natalité. » Il est de même probable que le nombre de candidats à l’immigration légale ou illégale diminuera quand l’industrialisation transformera l’Afrique subsaharienne en nouvel Eldorado.
Dans plusieurs tribunes, vous dénoncez l’échec de la politique mondiale d’Aide publique au développement (APD) et de l’Agence Française de Développement (AFD)
En France, le budget global de l’AFD dont la moitié est généralement consacrée à l’Afrique, atteint 15 milliards d’euros en 2023. L’Afrique a bénéficié de 1500 milliards de dollars d’Aide publique au développement (APD) en un peu plus de 60 ans mais le développement de l’Afrique subsaharienne ne s’est jamais concrétisé. Aussi est -il temps de changer une politique post-coloniale mal perçue par des Africains qui préfèrerait que l’on développe des partenariats commerciaux d’envergures internationales et une vraie industrie manufacturière de biens de consommation.
Le PAL (Plan d’Action de Lagos) de 1980 et l’Agenda pour 2063 initié en 2015, ne semblent pas avoir produit de résultats probants. Pourquoi pensez-vous que votre projet pourrait réussir ?
Le programme pour l'industrialisation de l'Afrique subsaharienne en moins de 20 ans est un projet cadre, réaliste et concret, de nature à répondre aux inquiétudes africaines. L’article « Pour éviter un chaos humanitaire, l’Afrique subsaharienne doit s’industrialiser en moins de 20 ans », publié le mois dernier dans la Tribune Afrique, soulignait cette urgence. Alors certes un tel plan de développement est attendu depuis plusieurs décennies par des centaines de millions d’Africains dont les travaux journaliers dans l’économie informelle ne permettent pas de nourrir leurs familles. Lors de sa publication, le projet a été republié sur plusieurs dizaines de media africains populaires. Mais il y a aussi une jeunesse africaine cultivée et diplômée parfois proche de chefs d’Etats ou travaillant dans des institutions internationales et africaines, consciente des réalités économiques régionales. Parmi elle, cadres, ingénieurs et économistes m’ont souvent fait part d’une volonté de s’investir dans cet ambitieux dessein.
Alors quel est le principal point d’achoppement ?
Le programme fera certainement une quasi-unanimité parmi les Africains mais le principal obstacle à sa réalisation, demeure une forme de terrorisme intellectuel qui impose une pensée idéologique climatique surtout occidentale et réserve les financements et subventions aux projets dits durables ou numériques qui ne créent pourtant pas suffisamment d’emploi. Cela empêche donc l’émergence d’une industrie manufacturière africaine des biens de consommation. Selon la Banque Mondiale " pour 2030, les prévisions indiquent que 9 personnes vivant dans l'extrême pauvreté sur 10 vivront en Afrique subsaharienne ". Sa population passera d'1 milliard d'habitants à 2 en 2050 puis 4 en 2100. Le risque de catastrophe humanitaire jamais vue se rapproche et de plus en plus nombreux sont les chefs d’Etats et responsables d’institutions internationales et africaines qui examinent mon projet avec intérêt.
Francis Journot est consultant et entrepreneur. Il dirige le programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Plan de régionalisation de production Europe Afrique et Africa Atlantic Axis. Il fait de la recherche dans le cadre d’International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale
 Tribune de *Francis Journot: "La Chine est responsable de la pandémie Covid-19 et devrait annuler la dette de l’Afrique"
Tribune de *Francis Journot: "La Chine est responsable de la pandémie Covid-19 et devrait annuler la dette de l’Afrique"
La responsabilité, au moins morale, de la Chine dans la propagation de la pandémie du Covid-19 ne fait aucun doute ainsi que je le démontrais en avril 2020 dans ma tribune sur Le Figaro : «Nous devrons exiger de la Chine une réparation du préjudice subi». Le régime chinois a caché la vérité et permis la propagation d’un coronavirus qui aurait pu être éradiqué avant qu’il ne sorte de la ville de Wuhan et de la Chine. Selon la journaliste Joséphine Ma du journal de Hong Kong South China Morning Post qui a pu accéder à des documents gouvernementaux confidentiels: «Le premier cas confirmé de Covid-19 en Chine remonte au 17 novembre». Puis 9 patients étaient identifiés fin novembre 2019 et 27 à la mi-décembre 2019. Mais la dictature chinoise a préféré museler la presse et la parole médicale. Dans l’article «La mort d’un médecin spécialiste du coronavirus provoque un tollé en Chine» publié le 7 février 2020 dans le New York Times, la journaliste Li Yuan décrivait la protestation en Chine après la mort du Docteur Wenliang, arrêté par le pouvoir chinois pour avoir lancé l’alerte fin décembre. Par ailleurs, CNN a dévoilé le 1 er décembre 2020 un document confidentiel de 117 pages du Centre provincial de contrôle et de prévention des maladies du Hubei qui accable un peu plus Pékin.
Le gouvernement de Pékin était certainement conscient du risque de pandémie mondiale
Il est peu probable que Xi Jinping ait oublié l’épidémie de SRAS-CoV qui a tué 800 personnes en 2002/2003. Son mode de transmission interhumain, l’origine animale et le type de complication pulmonaire étaient proches. Bien que n’ignorant guère le caractère hautement contagieux du coronavirus et le risque de pandémie mondiale, Pékin a maintenu les préparatifs de la fête du Nouvel an chinois qui devait avoir lieu le 25 janvier avant d’être finalement annulée. Ces activités ont brassé une forte population et une carte interactive des déplacements dans la région de l’épicentre situé à Wuhan, publiée par le New York Times «How the Virus Got Out», nous indiquait que 7 millions de voyageurs ont quitté la ville avant le confinement ordonné le 23 janvier 2020. On ignore combien parmi eux ont ensuite propagé le virus chinois principalement en train à travers la Chine et en avion aux 4 coins du monde. Mais maintenant, le nombre officiel à l’échelle mondiale de décès directement causés par le Covid-19, atteint 2 millions auxquels il convient de rajouter les millions de malades qui succombent à des pathologies qui ne peuvent être soignées en raison de la saturation des hôpitaux. Cependant le gouvernement chinois préfère se réfugier dans le déni et n’accepte que plus d’un an après l’apparition du virus, d’accueillir une mission d’enquête de l’OMS.
Quand le pompier pyromane distribue l’aumône
La distribution en Afrique de masques, produits médicaux ou sacs mortuaires et l’aumône, ici et là, de quelques millions d’euros, qui glorifient à grand renfort médiatique une prétendue générosité chinois, ne sont pas à la hauteur des drames et de la dégradation de l’économie africaine. Selon le rapport « Africa’s Pulse», la situation va s’aggraver « La pandémie risque de faire basculer 40 millions d’Africains dans l’extrême pauvreté, effaçant au moins cinq années de progrès dans la lutte contre la pauvreté. ». L’avis du président de la Banque Africaine de Développement (BAD) Akinwumi Adesina peut aussi inquiéter «l’Afrique a perdu plus d’une décennie des gains réalisés en matière de croissance économique ».
Une aide importante des institutions financières internationales pourrait s’avérer indispensable mais l’endettement important de certains pays d’Afrique auprès de la Chine et leur dépendance à Pékin,pourraient parfois compromettre ce recours. Aussi apparait-il indispensable que la Chine assume sa faute et efface au moins la dette qu’elle détient auprès de l’Afrique et qui constitue, si l’on en croit des experts, 40 % de l’endettement total africain soit environ 150 Mrds de dollars même si ce geste ne permettrait de compenser que très partiellement les dommages subis par le continent africain.

La France accroît encore son aide publique au développement
Le projet de loi de finances 2023 augmente les crédits alloués à l'aide publique au développement (APD). Les feux sont au vert puisque l'Agence francaise de développement (AFD) a doublé son activité entre 2016 (7 milliards d'euros) et 2019 (14 milliards). L'aide totale devrait dépasser cett année les 15 milliards d'euros.
![]()
Environnement : un salaire minimum mondial pourrait réussir là où les COP ont échoué
Francis Journot fait le constat de l'échec des COP, qui n'ont pas su endiguer les effets dévastateurs de la mondialisation des échanges. Selon lui, l'instauration d'un salaire minimum mondial réduirait les dégâts environnementaux de la culture du «jetable».
![]()
Après 40 ans d’échec, les conférences climat doivent changer de stratégie !
Le Figaro/Tribune par Francis Journot. La première COP climat a été organisée par l’ONU à Genève en 1979. Cette même année a aussi vu l’aboutissement du cycle de Tokyo dans le cadre du GATT (Accord général sur les tarifs douaniers institué en 1947). Cette étape déterminante du premier traité de libre-échange de l’histoire a induit une accélération sans précédent de la production à bas coût et du consumérisme mais aussi de ses effets pervers sur l’environnement. Certes, nous ne parviendrons pas à réparer ces dégâts mais après l’échec des COP au cours des 40 dernières années, nous devons néanmoins tenter à nouveau de concilier libre-échange, diminution de la pauvreté et sauvegarde de l’environnement.

L’aide publique au développement n’aide pas l’Afrique
Pour le chroniqueur Laurent Bigot, l’aide internationale fait d’abord vivre des dizaines de milliers de fonctionnaires étrangers et nationaux et une myriade de consultants.
L’efficacité de l’aide publique au développement a fait l’objet de nombreux ouvrages et études sans que jamais la question de la fin de l’aide ne soit posée. Les objectifs sont toujours quantitatifs, les fameux 0,7 % du PIB (produit intérieur brut). Mais quels sont les résultats ? Cet objectif en lui-même révèle le regard que pose la communauté internationale sur l’Afrique, un regard de commisération.
L'aide publique au développement, aide-t-elle vraiment l’Afrique? En 2009, l’économiste zambienne Dambisa Moyo répondait par un non catégorique dans son livre L’Aide fatale : les ravages de l’aide inutile et de nouvelles solutions pour l’Afrique. A la lumière de mon expérience de diplomate, je dois avouer que je ne suis guère plus optimiste. Selon Dambisa Moyo, l’Afrique aurait bénéficié de plus de mille milliards de dollars d’aide depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Le débat n’est pas de discuter les chiffres car l’ordre de grandeur est de toute façon impressionnant quel que soit le montant réel.
L’Afrique ne mérite-t-elle pas un objectif plus ambitieux, à savoir la fin de l’aide ? N’est-ce pas la vocation de l’aide publique au développement que de s’arrêter, signe qu’elle aura atteint ses objectifs ? Il est temps qu’une grande conférence internationale fixe le terme de l’aide, adressant au monde un message clair : l’Afrique peut soutenir son propre développement sans être assistée. Pour cela, il faudra changer les mentalités et ce ne sera pas une mince affaire.
Irresponsabilité généralisée
L’aide publique au développement est d’abord un business qui fait vivre des dizaines de milliers de fonctionnaires internationaux et nationaux mais aussi une myriade de consultants. Ils ont tous en commun un objectif : ne pas scier la branche sur laquelle ils sont assis et sur laquelle ils vivent grassement. J’ai toujours été fasciné par l’irresponsabilité que génère l’argent de l’aide publique au développement. C’est l’argent de personne. Tout le monde se comporte comme si c’était de l’argent créé ex nihilo.
Les bailleurs sortent pourtant ces sommes de la poche de leurs contribuables mais n’ont aucune exigence sur l’utilisation. Les bénéficiaires n’ont guère plus de considération pour ces sommes (parfois folles) qui tombent dans leur escarcelle sans grand effort (on se demande d’ailleurs s’il n’y a pas une prime au mauvais élève…).
Le Mali est à cet égard le meilleur (ou le pire ?) des exemples. Plus les autorités faillissent, plus l’argent coule à flot. Cette irresponsabilité généralisée est bien illustrée par l’Union européenne puisque le seul critère qui compte, c’est le taux de décaissement de l’aide. L’efficacité ? Peu importe. Je n’évoquerai pas les frais de fonctionnement de tous ces programmes (salaires, logements et protection des expatriés, flotte de véhicules 4x4…) ni la course effrénée aux per diem, ces indemnités journalières que versent les bailleurs aux fonctionnaires locaux pour participer aux missions, ateliers, séminaires et autres joyeusetés. Il y a même des ministres qui réclament leur per diem pour inaugurer tel ou tel équipement financé par l’aide internationale.
L’aide publique au développement vide les administrations locales de leurs meilleurs éléments qui sont recrutés par les agences des Nations unies et autres bailleurs pour gérer localement leurs programmes offrant des salaires plusieurs fois supérieurs à ceux servis dans la fonction publique du pays en question. Je ne m’étendrai pas non plus sur la course à la création d’ONG pour capter cette manne internationale.
Programmer la fin de l’aide
L’effet le plus pervers de l’aide publique au développement concerne la classe politique des pays bénéficiaires. L’aide est en effet une assurance tous risques pour leur incurie. Pourquoi s’efforcer d’établir des politiques publiques et assainir les finances publiques quand la communauté internationale vole toujours au secours des mauvais élèves ? Les dirigeants de nombre de ces pays ne sont plus comptables devant personne, ni devant les bailleurs qui ne leur demandent aucun compte, ni devant leur propre peuple à qui ils font croire que c’est la faute des entreprises étrangères, des grandes puissances et de la communauté internationale.
Je crois pourtant que certains dirigeants africains feraient bien d’ouvrir les yeux et de cesser de prendre leurs concitoyens pour des imbéciles. La jeunesse africaine aspire à être fière du continent auquel elle appartient. Elle aspire à un discours de responsabilité. Les nouvelles générations en Afrique ne doutent pas de leur valeur et elles ont bien raison. J’entends encore Fadel Barro, coordinateur du mouvement sénégalais Y’en a marre, me dire : « Commençons par faire avec ce que nous avons plutôt que de commencer par tendre la main. »
Le président malien Amadou Toumani Touré aimait aussi rappeler que la main qui reçoit est toujours en dessous de celle qui donne. La principale ressource en Afrique n’est pas dans le sous-sol, elle est sur son sol, ce sont ses hommes et ses femmes qui méritent bien mieux que le discours ambiant sur le « toujours plus d’aide » et qui méritent surtout bien plus de considération et d’attention de la part de leurs propres dirigeants. Organisons cette conférence mondiale pour programmer la fin de l’aide publique au développement car je suis convaincu d’une chose, c’est que l’Afrique n’a pas besoin de charité. Elle mérite bien mieux.
![]()
Esclavage, immigration mortelle : il faut un salaire minimum
Selon un rapport de l’UNICEF, 322 millions d’enfants (23 % de la population mondiale âgée de 5 à 17 ans) sont engagés dans une activité économique.Parmi eux, 215 millions travaillent dans des conditions inacceptables et plus de 110 millions d’entre eux, sont soumis aux pires conditions de travail.Aussi, si l’on admet que lorsque les parents sont payés décemment les enfants sont moins souvent contraints de travailler et peuvent ainsi aller à l’école, l’existence d’un salaire décent se révèle cruciale.De même, nous assistons impuissants à la noyade de milliers d’enfants et adultes migrants dont bon nombre fuient des pays où les salaires des ouvriers fabricant des produits pourtant destinés aux grands marches de la consommation, permettent à peine de survivre. Par Francis Journot
![]()
Comment réduire les inégalités ?
Afin de réduire les inégalités, le collectif «Patriotic Millionaires » propose une taxation des plus riches qui toutefois ne semble pas faire l'unanimité. Un projet de salaire minimum mondial raisonnable et intégrant les réalités économiques, pourrait-il convaincre davantage ?
Dans une lettre intitulée Millionnaires against pitchforks signée à Davos par 121 personnalités, le collectif « Patriotic Millionaires »exhorte ses amis millionnaires et milliardaires du monde entier, à exiger des impôts plus élevés et plus équitables afin de réduire des « inégalités extrêmes et déstabilisatrices ». L’initiative est généreuse mais il est peu certain que celle-ci permette seule de faire diminuer significativement la pauvreté et les effets négatifs de la production low-cost sur l’environnement. Par ailleurs, les appels à la responsabilisation, fussent-ils les plus sincères, sont rarement écoutés. Aussi devrions-nous tenter une autre approche pour atteindre ce but car la philanthropie recommandée est évidemment louable mais les travailleurs pauvres souhaitent pour leur part surtout un peu plus d’équité dans la rémunération de leur labeur. Le projet International Convention for a Global Minimum Wage, né en 2013 et publié alors dans Marianne, pourrait apporter des solutions. Raisonnable et évolutif, il prône le pragmatisme et préconise de réintroduire des équilibres en amont des mécanismes économiques. Celui-ci pourrait constituer aujourd’hui, l’unique voie pour, à la fois, réduire les inégalités dans le monde et les ravages de la surconsommation sur l’environnement. Ce salaire minimum mondial qui comporterait plusieurs niveaux pour la prise en compte des disparités économiques, pourrait être mis en œuvre dans la plupart des pays en moins de 7 ou 8 ans.
Premières tentatives
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le salaire minimum mondial s’est érigé en priorité et fut l’un des premiers chantiers de l’OIT créée en 1919 sous l’égide du Traité de Versailles. Des chercheurs ont très certainement rapidement identifié les pistes évidentes de prime abord, d’un salaire minimum mondial basé sur une proportion du salaire ou du revenu médian de chaque pays (50 ou 60 % souvent cités) et du minimum vital (Living Wage) plus ou moins proche. Mais on peut penser que les économistes de l’OIT ont pris conscience de certains risques avant la convention de 1928. En effet, la prise en compte d’un salaire médian, élevé ou faible, dans le calcul d’un salaire minimum local, ne garantit pas qu’un Etat puisse être ensuite en capacité de faire face dans certains cas, à une augmentation de rémunération de ses fonctionnaires ou que le taux d’inflation que pourrait provoquer une généralisation du salaire minimum soit contenu et n’aggrave guère des situations de pauvreté. Le danger de générer des troubles et la faillite de certains Etats, a certainement tempéré les velléités de progrès social et incité à la prudence. Aussi la Convention concernant l'institution de méthodes de fixation des salaires minima, laissait champ libre aux États signataires : “Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que les modalités de leur application“. 99 pays ont ratifié une convention qui n’a pas empêché les inégalités de croître. Le salaire minimum mondial n’a jamais vu le jour et sommeille depuis.
Echec du salaire minimum européen
L’idée d’un salaire minimum européen n’a pas été spécifiquement théorisée pour l’Union européenne par quelque émérite chercheur ou par un groupe d’élus, mais s’est simplement inspirée des travaux del’OIT. Ce projet politique a fait son apparition au cours des années 90 afin de valoriser l’Europe sociale chère à ses pères fondateurs mais se heurte depuis aux disparités structurelles des 27 pays de l’Union européenne. On peut néanmoins comprendre que les gouvernements des pays européens à plus bas coûts, à l’instar de leurs concurrents plus lointains, hésitent à augmenter les salaires et à s’exposer ainsi à une diminution de leur avantage compétitif. Aussi, est-il indispensable, dans le contexte de mondialisation, d’inclure cette problématique dans un processus plus large de salaire minimum mondial. Afin de convaincre les pays concernés, il conviendrait de proposer un projet clair, réaliste et économiquement structurant. Si l’on considère que la question du financement du salaire minimum mondial demeure pour les Etats l’un des principaux points d’achoppement, il faut nous résoudre à intervenir uniquement sur les salaires susceptibles de bénéficier de ressources le permettant soit d’abord ceux des travailleurs produisant des articles destinés à l’exportation. Pour exemple, une augmentation différenciée, progressive et programmée sur plusieurs années de salaires mensuels actuellement de 25 € en Ethiopie, 90 € au Bangladesh, 170 € au Vietnam ou 300 € en Bulgarie, n’impacterait le prix de vêtements vendus le plus souvent aux consommateurs européens ou américains, que de quelques dizaines de cents voire de quelques euros sur des pièces plus chères. Un calendrier s’appuyant sur des analyses complètes, préparerait les conditions qui permettraient ensuite la signature d’accords internationaux. L’UE et des institutions internationales pourraient partager leurs données ou collaborer plus largement à partir d’une méthodologie commune. Des partenariats avec des départements de recherche d’universités prestigieuses pourraient également permettre d’enrichir ces contenus. Le positionnement du curseur sur des objectifs de salaires minimums qui pourraient apparaitre peu ambitieux mais que peu de pays pourraient par conséquent refuser, ne serait certes pas de nature à changer instantanément les conditions de vie des 300 millions de travailleurs pauvres qui vivent avec moins de 1.7 euro par jour (source OIT) ou de ceux qui reçoivent à peine plus. En revanche, cette augmentation de rémunération qui toutefois, ne concernerait d’abord qu’une part des secteurs d’activité et des populations, sécuriserait cette mutation et permettrait surtout de mettre enfin sur les rails, un projet de salaire minimum mondial qui devrait compter 5 à 7 niveaux de compatibilité.
Un projet non idéologique
Inégalités et « living wage » font partie des luttes ou sont des thèmes de prédilection d’ONG qui reçoivent chaque année une manne financière de plusieurs dizaines de milliards d’euros. Mais les actions locales ne peuvent que très partiellement résoudre ces problématiques car l’économie mondialisée nous impose d’abord de réfléchir à une autre échelle. Les sujets du salaire minimum mondial et des inégalités sont hélas le plus souvent exploités à des fins politiques, idéologiques ou pécuniaires. Ils constituent pour des médias anglo-saxons ou français des contenus tendant à témoigner de leur humanité voire de leur engagement. Mais la publication contre-productive de propositions idéologiques et peu réalistes dont parfois le manichéisme n’a rien à envier au communisme, fournit des arguments aux détracteurs de cette cause ainsi décrédibilisée et immobilisée. Ces leaders d’opinions dont on peut regretter la légèreté en ce domaine, desservent finalement ceux qu’ils prétendent défendre. Apres 7 ans ou 10 si l’on compte les travaux connexes précédents, le projet International Convention for a Global Minimum Wager, remarqué dès 2013 par des universitaires américains, bénéficie maintenant d’un réseau mondial de près de 7 000 experts pour la plupart vraisemblablement favorables au projet ou au moins à une réflexion sur les propositions émises. Ils sont majoritairement titulaires d’un doctorat d’économie ou de finance et plusieurs centaines d’entre eux souhaitent participer aux études. On trouve parmi ceux-ci, bon nombre de chercheurs et professeurs qui enseignent dans des universités américaines de l’Ivy League (Harvard, Yale, Columbia, Cornell…) ou à Stanford, Berkeley, au MIT et dans d’autres écoles prestigieuses à travers le monde mais aussi près de deux mille économistes travaillant dans des institutions internationales telles que l’ONU, l’OMC, la Banque Mondiale, le FMI, le Forum Economique Mondial ou l’OIT ainsi que des dirigeants et financiers de grandes entreprises, banques ou fonds d’investissement qui savent comme nous tous que l’accroissement des inégalités peut être dangereux.
Une offre de salaire minimum difficilement refusable
Alors quel dirigeant de pays à bas coûts, intra ou extra européen, pourrait s’opposer publiquement à une convention offrant l’opportunité à ses concitoyens travaillant pour l’exportation vers les grands marchés de la consommation principalement occidentaux, de bénéficier graduellement de meilleures rémunérations et conditions de vie qui mécaniquement, s’étendraient au fil des années à l’ensemble des travailleurs et profiteraient ensuite à la population entière sans pour autant affecter sensiblement la compétitivité si les augmentations sont alors coordonnées à l’échelle mondiale. Compte tenu du caractère sectoriel, celles-ci ne feraient pas bondir l’inflation. Le pacte ne contraindrait pas non plus les gouvernements à augmenter leur dépense publique puisque le projet ne repose pas sur une utopique et soudaine majoration générale des salaires. Les ressources de l’environnement et l’habitat naturel seraient moins sollicités. Une génération tentée par l’immigration découvrirait de nouvelles opportunités et choisirait parfois de participer à l’expansion locale. La surnatalité aggrave l’insécurité alimentaire qui touche aujourd’hui près d’un milliard de personnes dans le monde. Aussi, les mesures favoriseraient souvent l'éducation des enfants, l'émancipation de femmes et à terme, une réduction de la natalité et de la pauvreté. Ainsi queles signataires de la lettre Millionnaires against pitchforks préviennent : « il faut agir avant qu’il ne soit trop tard ». Francis Journot

COP climat 26 : l’Afrique subsaharienne est-elle le dindon de la farce ?
La Chine veut gagner du temps pour parvenir plus vite à une hégémonie sur le monde
Les pays les plus pollueurs promettent, afin de gagner du temps, la neutralité carbone à l’horizon 2060 ou 2070. Le président chinois Xi Jinping à boudé la COP 26 et refuse les contraintes écologiques que les COPs veulent imposer. Son pays continue de multiplier les centrales à charbon qui constituent pourtant la source d’énergie la plus polluante et émettrice de CO2. La Chine accélère le rythme de captation des terres agricoles et minières dont terres rares d’une Afrique subsaharienne de plus en plus dépendante et endettée. Pékin veut mettre à profit ce gain de temps pour s’assurer une hégémonie économique et militaire sur le monde.
Exigence écologique à géométrie variable
Plus inflexibles à l’égard d’autres pays ou du continent africain, les institutions internationales qui conditionnent l’octroi de financements à une utilisation dite « verte », dictent ainsi le mode de développement de l’Afrique et l’expose à l’avidité de la Chine. Mais on peut craindre que cette politique qui empêchera la création d’une vraie industrie manufacturière des biens de consommation et qui maintiendra pour longtemps l’Afrique subsaharienne dans la pauvreté, soit demain, compte tenu du doublement de la population d’ici 2050, aussi responsable de la plus grande catastrophe humanitaire.
Conception de l’économie africaine loin des réalités
Transition écologique ou numérique qui pourtant n’est qu’un moyen mais pas une fin en soi, économie, relance, finance et croissance vertes, développement durable, tels sont quelques-uns des termes redondants ou directives imposant l’idéologie écologiste à l’économie africaine. Mais quelle transition écologique quand la totalité du CO2 émis par une cinquantaine de pays africains n‘aurait pas excédé 1 ou 2 % des émissions mondiales depuis le 18ème siècle ? Faudra-t-il fermer des entreprises insuffisamment vertueuses aux yeux de militants écologistes ou demander à des gens qui meurent de faim et qui manquent de tout, de consommer encore moins ? Et quelle transition numérique quand il faudrait d’abord penser des dispositifs de financement viables pour électrifier davantage l’Afrique ?
La transition écologique devrait générer, selon ses promoteurs, 4 ou 6 millions d’emplois « verts » en Afrique mais quelles solutions pour le demi-milliard aujourd’hui et demain, le milliard et demi de gens qui vivront dans l’extrême pauvreté et pour lesquels les emplois industriels seront toujours plus rares ? A qui profitera réellement la manne financière annuelle de plusieurs dizaines de milliards de dollars alloués à cette transition écologique africaine dont la plupart des outils sont fabriqués en Chine ?
Le risque d’assister en Afrique à un chaos et catastrophe humanitaire sans précèdent au nom du principe de précaution climatique, est réel et certain. Mais qui parmi ceux qui prônent aujourd’hui cette politique aventureuse, acceptera alors d’en assumer la responsabilité ? Par Francis JOURNOT
Programme d’industrialisation de 1 000 milliards d’euros sur 20 ans
L'industrialisation de l’Afrique subsaharienne qui aurait permis d’éradiquer l’extrême pauvreté et la malnutrition, échoue depuis plus de 60 ans. Aussi faut-il changer de paradigme. Une forte mobilisation des entrepreneurs subsahariens en faveur du 1er grand projet africain volontaire et pragmatique, structuré et structurant, faciliterait une modernisation rapide de l’Afrique subsaharienne.
Un projet crédible maintenant observé par l’ensemble des acteurs économiques et politiques
Après plusieurs années de recherche économique et financière ainsi qu’une vingtaine d’articles publiés dans la presse (Le Figaro, Marianne, la Tribune Afrique, Financial Afrik etc.) puis republiés par de nombreux sites d’information français, africains ou internationaux, notre programme pour l’industrialisation de l’Afrique Subsaharienne en moine de 20 ans s’impose maintenant, en matière de développement de l’Afrique subsaharienne, en tant qu’unique voie crédible face à la politique d’’Aide publique au développement (APD) qui a échoué ou à l’Agenda 2063 de l’UA au point mort depuis 2013.
Par ailleurs, le programme est maintenant connu de l’ensemble des acteurs économiques et politiques. Chaque année plus de 5 000 économistes travaillant dans les institutions internationales (UE, FMI, ONU, OIT, Banque Mondiale, UA, BAD etc.), universitaires enseignant dans des universités réputées (Oxford, Yale, Berkeley, Stanford, Harvard etc.), cadres de grandes entreprises, associés de grands cabinets de conseil, gouvernements de nombreux pays ainsi que gestionnaires de fonds d’investissement, suivent avec attention l’avancée nos travaux économiques et s’en inspirent parfois.
Un modèle économique qui a fait ses preuves
Dans le cadre d’un article publié dans la Tribune Afrique en 2020 : "Afrique subsaharienne : le capitalisme pourrait réussir là où l’aide publique au développement (APD) échoue depuis 60 ans", nous citions des propos de l’économiste Dambissa Moyo : « Nous avons maintenant plus de 300 ans de preuves de ce qui fonctionne pour augmenter la croissance, réduire la pauvreté et la souffrance. Par exemple, nous savons que les pays qui financent le développement et créent des emplois grâce au commerce et à l'encouragement des investissements étrangers prospèrent. » Africain et Occidental, le programme que nous élaborons depuis 3 ans, s’appuie sur un modèle économique efficient et éprouvé qui a déjà permis à de nombreuses populations à travers le monde, de sortir de la misère.
Comment le programme d’industrialisation de 1 000 Mrds d’euros en 20 ans, s’articulera
300 Mrds d’euros pour financer la création de 100 zones d’activités industrielles et commerciales modernes de différentes tailles, évolutives et sécurisées, reparties dans une quarantaine de pays dont les occupants, entreprises étrangères ou locales s’acquitteront ensuite des loyers et services auprès du fonds de gestion. Afin de créer des lieux de vie, autonomes et moins énergivores, des activités agricoles dans des périmètres de seulement quelques dizaines de kilomètres, complèteront ces écosystèmes.
400 Mrds seront consacrés à des prêts aux entreprises locales et étrangères ainsi qu’a des participations dans des projets à haut potentiel. Il nous faudra néanmoins, adosser le fonds à des investissements extérieurs et mécanismes de compensation pour satisfaire à des impératifs de rentabilité et de stabilité.
300 Mrds d’euros pour ériger 100 villes nouvelles écologiques, à distances raisonnables des 100 zones d’activités industrielles et commerciales. Elles accueilleront à terme, 150/200 millions d’habitants dont familles de travailleurs qui bénéficieront d’infrastructures d’énergies, transport, éducation, santé etc.
Un fonds dont la gestion transparente et sérieuse séduira investisseurs institutionnels et privés
Les gros contributeurs à l’Aide publique au développement (APD) mondiale dont l’UE (70 Mrds d’euros) et les USA (60 Mrds d’euros) en 2023 et près de 2 000 Mrds d’euros en 60 ans en Afrique, versent souvent sans retour de forts capitaux et renoncent fréquemment au remboursement des emprunts. Aussi considèreront-ils avec intérêt, un mode de participation qui non seulement ne coûtera rien à leurs contribuables mais servira en plus à terme, une rémunération des 50 Mrds d’euros investis chaque an.
Bien que ne cherchant guère à rivaliser avec les résultats des produits financiers les plus performants, le fonds séduira néanmoins des pays, investisseurs institutionnels et privés soucieux d’afficher des valeurs morales de RSE et d’inclusivité tout en préservant leurs investissements dans un fonds à la gestion sérieuse et prudente. Ce capitalisme intelligent séduira entrepreneurs africains et investisseurs.
Les entrepreneurs de 35 ou 40 ans qui attendent la réalisation de l’agenda 2063, auront 75/80 ans !
L’Agenda Africain pour 2063 de l’Union Africaine (UA) n’a jamais décollé depuis 10 ans à l’instar du Plan de Lagos de 1980 de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) qui s’était aussi enlisé. Même en l’hypothèse très improbable où le plan de l’UA produirait des résultats à l’approche de 2063, combien de centaines de millions d’africains, d’ici cet horizon, subiront l’extrême pauvreté ou succomberont à la faim ? Les jeunes entrepreneurs qui ont aujourd’hui 35 ou 40 ans, auront vieilli de 40 années et seront alors âgés de 75 ou 80 ans ! Les objectifs de l’UA sont lointains alors que le temps presse. Selon la Banque mondiale, les politiques actuelles créeront « tout au plus, 100 millions de nouveaux emplois au cours des 20 prochaines années au lieu des 450 millions dont l’Afrique aura besoin ». Un développement panafricain replié sur son continent tel que parfois prôné par l’UA, ne permettrait de tabler que sur 20 ou 30 millions d’emplois en 2 décennies, le plus souvent informels.
Les forces vives africaines sont libres de croire l’UA et de patienter jusqu’en 2063 ou peuvent au contraire, opter pour un réel progrès avec un plan réaliste de financements et de transferts de savoir-faire ou technologies, qui favorisera rapidement la modernisation de l’Afrique subsaharienne.
Il est crucial que les entrepreneurs africains, partenaires indispensables, soutiennent le programme
Ainsi que démontré dans nos précédentes analyses, il est certain qu’en l’absence d’alternative sérieuse, notre programme d’industrialisation constitue l’unique et dernière chance susceptible d’éviter ou au moins de réduire l’impact du chaos humanitaire qui menace le continent. L’Afrique subsaharienne doit le faire sien et se mobiliser. Nos propositions sont bienveillamment accueillies par un nombre croissant de subsahariens et membres de la diaspora mais il est indispensable que les entrepreneurs africains manifestent leur volonté de voir le programme d’industrialisation mis en œuvre. Cela sera de nature à convaincre davantage de pays, d’investisseurs institutionnels et privés ainsi que de grandes entreprises internationales, de s’associer à cet ambitieux et noble défi pour l’Afrique subsaharienne.
Consultant et entrepreneur, Francis Journot dirige le programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ainsi que le plan de régionalisation Europe-Afrique et Africa Atlantic Axis. Il est aussi l’initiateur du projet International Convention for a Global Minimum Wage
![]()
Dumpings, environnement, esclavage : Un salaire minimum mondial offrirait des solutions
Le Figaro/Tribune - Francis Journot dénonce l'esclavage de plusieurs dizaines de millions de femmes et d'hommes rémunérés quelques dizaines ou un peu plus d'une centaine d'euros par mois. Il défend un salaire minimum mondial, qui initierait une transition vers un changement de paradigme.
Dérégulation des échanges et déséquilibres économiques, surproduction et destruction de l’environnement, conditions de travail proches de l’esclavage et immigration, chômage et précarisation dans les pays développés : La mondialisation heureuse et la cohésion européenne sont restées à l’état de slogan. Le 17 novembre 2017, lors du sommet social européen de Göteborg, le président français Emmanuel Macron a exhumé le thème du salaire minimum européen sans toutefois intégrer les paramètres inhérents à une économie mondialisée. Pourtant, l’instauration d’un salaire minimum européen pourrait passer par celle, conjointe, d’un salaire minimum mondial. Le salaire spécifique aux exportations est une option qui devrait être maintenant envisagée.
Comment créer un salaire minimum européen ?
Le projet de salaire minimum européen unique ou selon le revenu médian de chaque pays n’a jamais abouti lorsque l’UE ne comptait que 15 membres et 25 ans après Maastricht, on peut douter d’une éventuelle adhésion des 28 pays. Un salaire que les états pourraient difficilement assumer dans leurs administrations ou que les entreprises produisant pour la population locale ne pourraient guère payer à leurs salariés, n’a bien évidemment aucune chance de voir le jour, même en deux étapes, zone euro puis UE, ainsi que le préconise le président de la commission européenne Jean Claude Juncker. De plus, une augmentation unilatérale des salaires européens désindustrialiserait et appauvrirait un peu plus une Union européenne qui déplore un déficit extérieur de 170 milliards de dollars avec la Chine, comparable à celui des USA qui dépassait 478 milliards de dollars en 2016 avec ce même pays. Au sein des pays de l’UE, seule l’Allemagne tire son épingle du jeu. Celle-ci remporte le jackpot avec un excèdent mondial record de 293 milliards de dollars dont 257 avec la Chine. La première économie de l’UE profite à la fois d’un yen et d'un yuan sous-évalués qui lui permet d’importer des pièces à bas prix mais aussi d’une main d’œuvre de sous-traitants des pays voisins dont les salaires comptent parmi les plus modestes d’Europe.
Les pays européens aux plus bas salaires de l’UE ne renonceront pas à leur avantage compétitif à moins que l’augmentation n’affecte guère leurs économies respectives. Mais pour cela, il serait alors indispensable que l’ensemble des autres pays à bas coûts augmente également les salaires en concurrence soit ceux des ouvriers et employés produisant des biens et services ensuite exportés vers les grands marchés de consommateurs.
Convention internationale pour un salaire minimum spécifique à l’exportation
Il conviendrait donc de soumettre l’exportation vers les deux grands marchés de consommateurs, à l’engagement des chefs d’états, au cours d’une convention internationale pour un salaire minimum, de légiférer ensuite dans leurs pays respectifs, en faveur d’un salaire minimum mondial rémunérant les ouvriers et employés qui produisent des biens et services destinés aux USA et à l’UE. Son montant qui pourrait se situer entre 250 et 350 € les premières années, serait déterminé au terme d’un vote de la convention. Certes une part des salaires manufacturiers chinois se situe déjà dans cette fourchette mais les ouvriers travaillant chez les sous-traitants de plus en plus nombreux en Asie, en Afrique ou en Europe (hors pays de l’UE) en profiteraient. Ambitieux pour les uns, trop modeste pour d’autres, ce pas constituerait néanmoins un indéniable progrès social pour plusieurs dizaines de millions de femmes et d’hommes rémunérés quelques dizaines ou un peu plus d’une centaine d’euros par mois pour travailler parfois dans des conditions proches de l’esclavage.
De même la création au sein de l’UE d’un salaire minimum européen qui pourrait avoisiner 600 €, accélérerait la réalisation de l’Europe sociale souhaitée par Bruxelles mais qui jusque-là a échoué. La hausse salariale satisferait les ouvriers des 10 pays de l’UE dont le salaire minimum est proche ou inférieur à 400 € sans pour autant menacer les économies des états. En effet, il est peu probable que les industries de main d’œuvre maintenant délocalisées dans des pays à plus bas coûts reviennent instantanément dans des pays qui ont perdu leurs savoir-faire et leurs capacités productives.
Pour exemple, la fabrication d’articles textiles bas ou moyen de gamme ne coûterait le plus souvent que quelques centimes ou dizaines de centimes d’euro en plus. En revanche l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés de l’industrie et des services exportés s’étendrait mécaniquement à l’ensemble des populations des pays concernés et pourrait générer des marchés à plus forte valeur ajoutée parfois plus locaux et respectueux de l’environnement.
Apres l'échec de toutes les conférences sur le climat, il faut changer de stratégie
Lorsqu'une ouvrière rémunérée mensuellement 30 ou 100 €, assemble plusieurs centaines ou milliers de vêtements chaque mois, on considère souvent que le coût de fabrication est insignifiant mais il n'en va pas de même pour l'impact sur l'environnement car le textile est la deuxième cause de pollution derrière l'industrie pétrolière. En instituant un salaire minimum, le vêtement abandonnera progressivement son statut de produit jetable. Un salaire de 200/300 € ne ferait pas grimper obligatoirement grimper les prix dans les grandes enseignes.
Ceux-ci sont généralement fixés en fonction du pouvoir d'achat des pays consommateurs et de leur concurrence. Seraient principalement impactés, le rythme hebdomadaire des collections «fast fashion», les budgets publicitaires, la surfaces des magasins pharaoniques installés sur les avenues les plus prestigieuses et les marges bénéficiaires. Auparavant chaque article avait un coût de fabrication qui valorisait le produit. Désormais, H&M brule chaque année, selon des journalistes danois, 12 tonnes de vêtements.
Le libre-échange, qui favorise une production plus quantitative que qualitative et déplace des centaines de millions de tonnes de marchandises d'un bout à l'autre de la terre, devra être repensé.
Le modèle de libre-échange débridé qui favorise une production plus quantitative que qualitative et déplace des centaines de millions de tonnes de marchandises d'un bout à l'autre de la terre, devra être repensé. Selon Le Gardian, les 15 plus gros porte-conteneurs polluent autant que la totalité du parc automobile mondial. Aujourd'hui, près de 100 000 cargos sillonnent les mers.
La conférence sur le climat qui a eu lieu à Paris en 2015 a sensibilisé le monde aux enjeux climatiques mais à l'instar des précédentes réunions, ne permettra pas de réduire la surproduction notamment chinoise. Le premier pollueur mondial avait déjà fait échouer la conférence de Copenhague en 2009 et ne cache pas son ambition de dominer l'économie mondiale avant de songer à réduire ses émissions dont le pic ne sera atteint qu'en 2030 mais jugeait la contribution climatique des pays développés fixée à 100 milliards de dollars par an à partir de 2020, très insuffisante.
Un marché de dupes ne fait jamais longtemps illusion et l'échec semble une fois de plus, inévitable. Certes, le salaire minimum mondial ne résoudrait pas toutes les problématiques. Néanmoins, il initierait une transition vers un indispensable changement de paradigme. Consommer moins mais mieux pourrait en constituer l'un des objectifs.
Francis Journot est consultant et entrepreneur. Il dirige le Programme industrialisation Afrique subsaharienne ou Plan de régionalisation de production Europe Afrique et Africa Atlantic Axis. Il fait de la recherche dans le cadre d’International Convention for a Global Minimum Wage et tient le site Collectivité Nationale

Immigration clandestine : le silence de l'Union africaine
Par Vincent Niebede le 24/07/2023
Les pays d'où viennent ces migrants restent silencieux face à cette situation, abandonnant leurs concitoyens dans le Sahara.

Un bateau se renverse en Mer Méditerranée, avec des dizaines de migrants à son bordImage : MINDS Global Spotlight/Italian Navy/picture alliance
Ils sont des milliers de migrants à tenter la traversée de la Méditerranée vers l'Europe. Conséquence : des milliers de morts. Et les pays d'où viennent ces migrants africains ne réagissent pas. Un silence qui ne laisse pas indifférent des organisations de la société et qui en dit long sur la culpabilité des Etats en question, selon Mahamadou Kouma, président du Conseil de la convention de la société civile en Côte d'Ivoire.
"C’est un silence coupable. Il faut avoir le courage de le dire, de le dénoncer. Mais je le dis, s’ils ne le font pas, c'est parce qu’eux-mêmes, ils ont la conscience perturbée, par rapport à la question. Ils n'ont pas le courage de dénoncer parce qu'on peut leur retourner la question", estime Mahamadou Kouma.
"Nulle part, on ne traite les Africains, comme étant chez eux partout. Pourtant on parle de l'intégration. Ce qui se passe en Tunisie est regrettable. Nous le dénonçons. Et nous interpellons, non seulement les autorités tunisiennes, mais la Cedeao, l’Union africaine. Et les Nations unies."
L'indifférence des leaders africains
Ces dernières semaines, des centaines de migrants illégaux ont été expulsés de la Tunisie puis abandonnés dans le désert. L’indifférence des pays d'origine et des organisations sous-régionales est un signe d'échec des politiques publiques, selon Alioune Tine, président du Centre Afrikajom, un think tank, chargé de formation et de défense des droits humains à Dakar, au Sénégal.
"Les leaders africains ne savent que faire de cette jeunesse. Jamais on n’a vu la dignité de l'homme africain bafouée de cette manière dans d’autres pays africains. C’est incroyable. Incroyable ce qu’on voit dans le désert, ce qu’on voit aussi dans les mers parce qu’il n’y a pas que le désert. Aucun Africain ne doit rester indifférent par rapport à cette situation. L’indifférence surtout des leaders africains qui auraient dû prendre en charge cette situation", martèle Alioune Tine.
"Ces jeunes qu’on voit avec les jihadistes, c’est les mêmes, c’est la même génération. La question de la jeunesse doit être la priorité des priorités des leaders africains. Le plus urgent aujourd’hui, c’est franchement de faire face aux atteintes, à la vie, à la dignité, à l’intégrité physique et cette indifférence est inhumaine."
Contactée par la DW, Cessouma Minata Samate, commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de l'Union africaine, a déclaré que "l'UA se penche sur cette question avec son équipe sur place en Tunisie", mais n'a donné aucun autre détail.

L’aide publique au developpement en Afrique subsaharienne a-t-elle échoué ?
Jean-Michel Bos | Gianna-Carina Grün
L’aggravation de la pauvreté sur le continent remet en question les objectifs de l’aide au développement tandis que la Chine vient bousculer les règles.
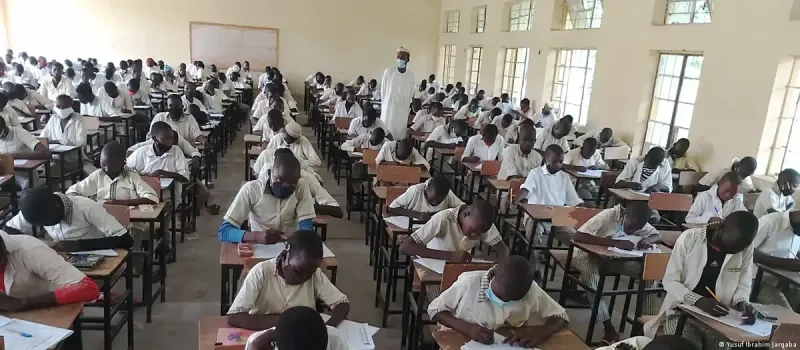
Reprise des classes au NigeriaImage : Yusuf Ibrahim Jargaba
Au cours des 18 dernières années de données disponibles, la totalité de l'aide publique au développement accordée dans le monde a atteint la somme assez phénoménale de 1.729 milliards de dollars. Près de la moitié de ce montant a été accordée à l'Afrique et sur le continent, 87% des budgets sont délivrés en Afrique subsaharienne. Voilà pour la vue d'ensemble de l'aide publique au développement en Afrique. Si on souhaite zoomer un peu plus, alors il apparait très vite qu'à l'exception de la République démocratique du Congo, ce sont les pays anglophones ou d'Afrique de l'Est qui attirent le plus de projets : l'Ethiopie, le Nigeria, la Tanzanie, le Kenya ou le Mozambique.

L'Afrique a donc perçu au cours des 18 dernières années 805 milliards de dollars d'aide publique au développement. Pour donner une valeur de comparaison, le Plan Marshall, qui a permis à l'Europe de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale, a représenté, de 1948 à 1952, un prêt américain de 173 milliards de dollars actuels. En dépit de ces efforts, le nombre de personnes vivant dans la pauvreté (avec moins de 1,90 dollars par jour) a augmenté sur le continent africain. 75% des personnes pauvres dans le monde vivent en Afrique, en 1970 cette part était de 10% et les prévisions de la Banque mondiale tablent sur 90% en 2030.
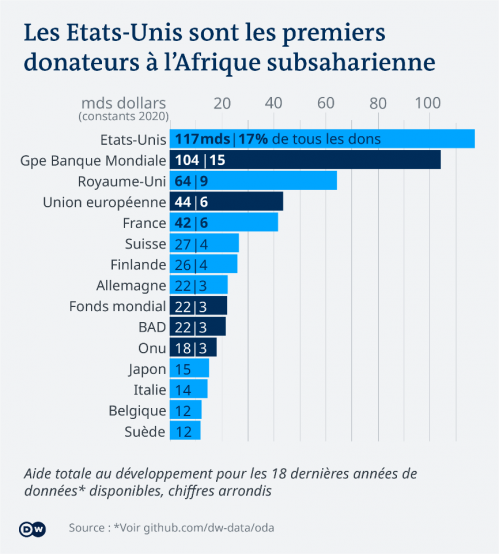
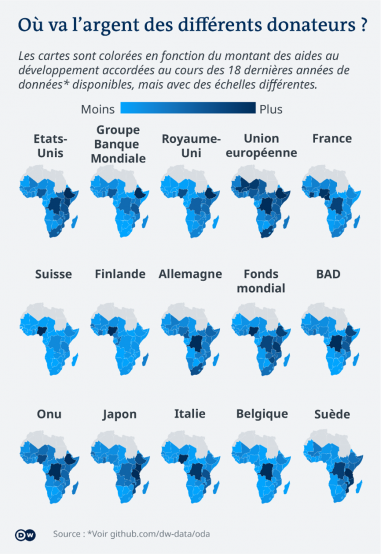
1.500 milliards depuis 1960
Il existe plusieurs types de critiques contre l'aide publique au développement. La première est que celle-ci assure un versement d'argent facile qui n'encourage pas la prise d'initiatives et l'autonomie des Etats. Une autre critique porte sur la mauvaise utilisation des fonds qui sont détournés par la corruption, ou encore investis dans des projets aussi gigantesques qu'inutiles : les fameux "éléphants blancs" qui symbolisent l'échec de certaines politiques industrielles. Selon les chiffres de la Banque mondiale , près de 1.500 milliards de dollars d'aide publique au développement ont été donnés à l'Afrique subsaharienne depuis 1960. L'Allemagne est un des premiers donateurs au monde avec un budget annuel global de 22 milliards d'euros consacré à l'aide au développement. Berlin veut promouvoir aussi l'initiative privée en Afrique en soutenant les investissements des entreprises allemandes grâce à son initiative Compact with Africa, lancée en 2017. Mais ce projet se heurte à une faiblesse structurelle : les entreprises allemandes investissent peu en Afrique et lorsqu'elles le font, elles concentrent leurs budgets sur le Maghreb et l'Afrique du Sud. Les putschs militaires au Mali et en Guinée, ou la prise de pouvoir par les militaires au Tchad après la mort de l'ancien président Idriss Déby, ne peuvent qu'aggraver le manque de confiance des investisseurs dans cette partie du monde.
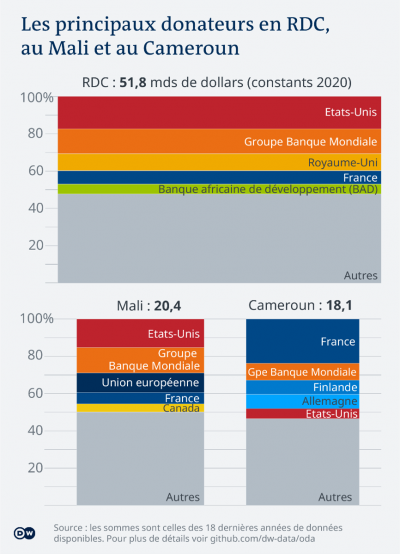
Poursuivons plus en détails en choisissant trois pays importants au sein de l'Afrique francophone : la République démocratique du Congo (RDC), le Mali et le Cameroun. Avec plus de 50 milliards de dollars d'aide au cours des 18 dernières années, la RDC est le pays qui attire le plus de crédits. Sans surprise, les Etats-Unis sont en tête des pays donateurs en RDC et au Mali tandis que la France occupe la première place au Cameroun. L'Allemagne n'apparait dans le Top 5 qu'au Cameroun, une de ses anciennes possessions coloniales sur le continent. L'infographie suivante montre qu'une grande partie de l'aide au développement est versée dans ces trois pays aux gouvernements qui ensuite la répartissent, parfois sous forme d'appels d'offres, avec un manque de transparence dont pâtissent les entreprises locales.
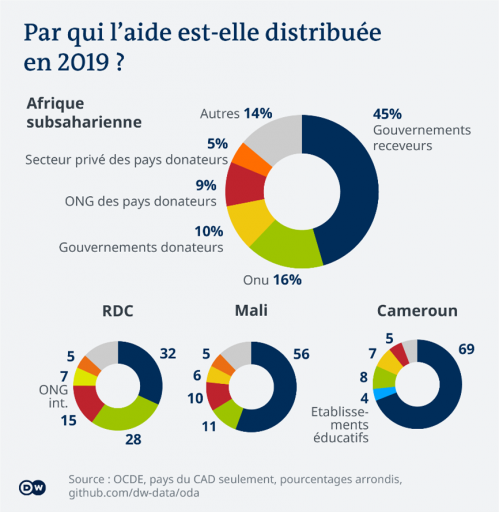
La Chine a ses propres règles
Enfin, il y a la Chine qui vient bousculer les règles établies par les Occidentaux. Nos infographies portent sur l'ensemble de l'aide publique au développement dans le monde : elles prennent en compte les Etats membres du Comité d'aide au développement de l'OCDE, qui comprend 29 pays ainsi que l'Union européenne, les pays qui ne sont pas membres de ce comité (Turquie, Russie, Arabie saoudite...) et les organisations internationales (Onu, Banque mondiale, Banque africaine de développement...) Il a fallu toutefois ajouter la Chine pour laquelle les chiffres sont plus difficiles à trouver. Car la Chine arrive avec beaucoup d'argent et elle suit ses propres règles. L'apport de la Chine n'est en effet pas éligible aux critères de l'OCDE en termes d'aide publique au développement : "avoir pour but essentiel de favoriser le développement économique et l'amélioration du niveau de vie des pays en développement (…) et être assortie de conditions favorables.” Pour simplifier, l'aide doit plus se présenter sous forme d'un don, d'une subvention non remboursable que sous la forme d'un crédit commercial. Or, la Chine fonctionne avec des crédits aux taux d'intérêts élevés qui sont donc classés dans la catégorie des "autres apports du secteur public”. Les taux d'intérêts chinois seraient deux fois supérieurs à ceux pratiqués par des pays membres de l'OCDE comme l'Allemagne ou la France.
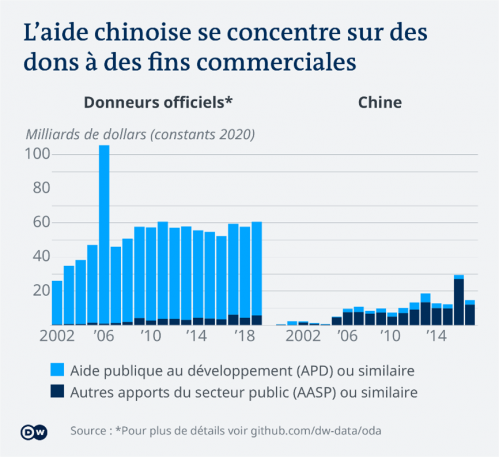
La dette cachée de l'Afrique
Selon une étude publiée par l'institut de recherche de l'Université William & Mary aux Etats-Unis, la Chine, avec le lancement du projet Nouvelle route de la soie en 2013, aurait investi 85 milliards de dollars par an en moyenne en dehors de ses frontières. C'est deux fois plus que l'ensemble de l'aide publique au développement reçue par l'Afrique durant cette période. Mais les auteurs de cette étude rappellent que cette expansion repose sur la dette des pays receveurs, à commencer par les pays africains. "70% des prêts chinois à l'étranger”, poursuit le rapport, "sont dirigés vers des compagnies publiques, des banques publiques (…) et des institutions privées dans les pays receveurs. Ces dettes, pour la plus grande partie, n'apparaissent donc pas dans les comptes des Etats.” En novembre dernier, Dakar a accueilli la huitième édition du Forum sur la coopération sino-africaine A cette occasion, le ministre sénégalais de l'Economie, Amadou Hott, a demandé à la Chine une relation moins centrée sur la dette et profitant plus aux économies africaines. L'économiste sénégalais Mor Gassama a estimé que la pratique chinoise n'est "pas habituelle" en matière de coopération. "Un pays peut toujours prêter à un autre mais tout cela doit rester dans la transparence totale. Mais les Chinois sont moins regardants que les Européens et les Américains sur la transparence et la lutte contre la corruption.” Lors de ce forum, les autorités chinoises ont affirmé que la Chine aurait prêté 153 milliards de dollars aux Etats africains et à des entreprises africaines entre 2000 et 2019. Huit milliards par an seulement ? Un chiffre probablement sous-estimé.
La France connaît la désindustrialisation et une fin de cycle mais l'industrialisation de l’Afrique subsaharienne lui procurerait de la croissance
La réindustrialisation de la France est peu probable mais figurait cependant dans tous les programmes présidentiels en 2022. Des personnalités politiques convoquent notre nostalgie de l’industrie des 30 années glorieuses mais nous avons atteint le point de non-retour dans de nombreux secteurs industriels. D’autre part, la hausse constante du prix de l’énergie qui impacte déjà de nombreuses entreprises industrielles, remet en question des projets de robotisation de production.
Après les cycles primaire et secondaire, le tertiaire s’est imposé. Les économies avancées ont généralement suivi le même cheminement agricole, industriel puis des services. L’économie quaternaire ou numérique doit s’appuyer sur des niveaux forts de développement économique. Elle se nourrit, à l’instar des services, d’interdépendances et d’interactions avec les 2 premiers secteurs.
Les pays les moins développés ne peuvent donc enjamber une progression des cycles, de même que les pays anciennement industrialisés connaissent un effet cliquet qui leur interdit de parcourir le chemin inverse. En l’absence d’exemples de pays ayant réussi à se réindustrialiser significativement après avoir dépassé un certain degré de désindustrialisation (hors guerres), on peut considérer que la réindustrialisation ou la relocalisation d’emplois dans des pays occidentaux aux coûts salariaux élevés et aussi exposés à d’autres formes de dumping, relève à présent du vœu pieu ou de la démagogie.
Parmi les obstacles qui s’opposent à une réindustrialisation de la France, figurent un environnement fiscal, normatif, administratif et syndical peu engageant, la difficulté de trouver des candidats formés mais aussi un coût salarial et de formation élevé. Autrefois, la perspective de travaux moins rudes que ceux de la ferme pour des générations qui quittaient l’agriculture, l’entourage social et l’habitude au sein de familles d’ouvriers qui se succédaient dans des entreprises réputées pour transmettre des savoir-faire avec le goût de l’excellence, souvent premiers employeurs régionaux qui offraient la sécurité de l’emploi et chez lesquels les salariés étaient fiers de travailler, ont favorisé l’abondance de main-d’œuvre et le succès de ce modèle industriel.
Le déficit de la balance commerciale a atteint en 2022, le record historique de 163.6 Mrds d’euros. Le processus qui nous entraine vers la fin du cycle industriel, s’est intensifié surtout à partir des années 80. La financiarisation a fait voler en éclats un modèle patrimonial et paternaliste incarné par les derniers capitaines d’industrie. Il ne convient pas d’idéaliser à outrance ce modèle qui comportait des défauts, mais cette culture fédérait et la population bénéficiait du développement industriel. Pour mieux faire passer la pilule des fermetures d’usines et des délocalisations, François Mitterrand faisait le choix d’une société de l’assistanat. Le gouvernement instaurait le RMI en 1988. Il avait auparavant soutenu l’initiative des Restaurants du Cœur de Coluche, afin que ceux-ci contiennent, aux côtés d’autres associations de plus en plus débordées, des situations d’extrême pauvreté. La politique de l’assistanat a réduit le risque de révolte ouvrière mais a favorisé l’acceptation d’une mondialisation qui fabriquerait en France, de plus en plus de chômeurs et d’allocataires de minimas sociaux.
Dans la France de 2023, de multiples possibilités s’offrent aux jeunes qui entrent dans la vie professionnelle. Beaucoup redoutent des tâches répétitives avec un risque souvent élevé de maladies professionnelles et un manque de considération du travail industriel. Certains choisissent même de baser leur parcours de vie sur un assistanat maintenant institutionalisé. Depuis plusieurs décennies, les enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants d’ainés qui avaient quitté la ferme pour l’usine, préfèrent souvent, lorsqu’ils sont licenciés, travailler dans des métiers du secteur des services. Cela illustre l’évolution du travail ainsi que le phénomène des cycles.
La fin d'un cycle industriel français ne signifie évidemment pas une absence totale d’industrie ou qu’il faille se resigner à la désindustrialisation de la France mais on doit néanmoins faire le constat du recul en termes d’emplois. En effet, notre pays comptait 6 millions d’emplois industriels pour une population active de 22 millions de personnes en 1974. Actuellement, l’effectif de l’industrie manufacturière de transformation des biens, hors secteur agroalimentaire, n’excède pas 1 million pour 28 millions d’actifs. Citons d’abord les secteurs qui nécessitent des emplois métallurgiques : « L’industrie automobile (dont construction auto, équipementiers automobiles) génère à elle seule 205 000 emplois » (CCFA 2018) mais la transition vers l’électrique pourrait détruire 50/100 00 emplois, Aéronautique et spatial, Naval, Ferroviaire, Armement 270 000, Nucléaire 100 000 emplois selon SFEN. Puis Chimie, pharmacie et cosmétiques 150 000, Textile et maroquinerie 75 000 dont luxe, Meuble 30 000 etc.
Quand un pays désindustrialisé qui a perdu la plupart de ses savoir-faire et de ses écosystèmes, relocalise quelques activités robotisées dépendantes de chaines de valeur mondiales, avec peu d’emplois à la clé, il est alors exagéré d’évoquer une réindustrialisation. Ce néologisme a fait son apparition aux Etats Unis et un débat fut engagé au Congrès américain au cours des années 80. Plus récemment, le président Donald Trump a souhaité relocaliser une part de l’industrie mais la volonté politique n’a pas suffi et le déficit commercial américain enregistre en 2021 un record de 859.1 Mrds de dollars.
Des machines et des productions se baladent à travers le monde au gré des subventions, des couts salariaux ou de l’attractivité fiscale mais peut-on parler de réindustrialisation quand une activité marque seulement une halte pendant quelques années en France ?
La relocalisation d’industries désormais robotisées est toujours souhaitable mais le contribuable a-t-il vocation à subventionner des entreprises parfois chinoises qui s’installent ainsi au cœur de l’Europe pour mieux capter les parts de marché de leurs concurrents français et européens. Cette vision mondialiste s’oppose au modèle de l’industrie française forte qui enrichissait la France et profitait à tous. Les plus grands fleurons ont certes souvent bénéficié de larges subventions de l’Etat français mais participaient en revanche à la création d’écosystèmes disséminés sur la toute la France, à la structuration et à l’enrichissement des territoires, gêneraient des millions d’emplois et des cotisations qui finançaient les services publics etc.
La croissance française est atone depuis le début des années 2000. Une sortie de l’UE et de l’euro nous aurait alors permis de protéger davantage notre industrie manufacturière. 2 décennies plus tard, nous ne parvenons que très rarement à trouver des biens courants de consommation « made in France » (hors agroalimentaire). Cela était très prévisible et c’est pourquoi nous avons inlassablement interpellé les trois derniers présidents qui au contraire, ont multiplié durant leurs quinquennats, les accords de libre-échange ou les freins à l’activité industrielle.
De nombreuses personnalités politiques prétendent souvent vouloir et pouvoir réindustrialiser mais oublient que ce sont les dirigeants d’entreprises qui décident de leur propre politique industrielle. Quelques subventions pourraient ne guère suffire. Compte tenu d’une multiplication des taxes et normes, d’un euro surévalué, des 35 heures, d’un coût du travail incompatible avec un faible pouvoir d’achat de consommateurs mais aussi du manque d’intérêt pour l’emploi industriel dans une France qui s’éloigne, même si on le déplore, de son cycle industriel, peu d’entreprises françaises projettent de relocaliser leur production dans l’hexagone.
Nouveau schéma de croissance
Aucun des programmes présentés lors des dernières élections présidentielles, ne pourrait permettre dans le cadre de l’UE, de renouer avec un niveau de croissance qui assurerait la pérennité du modèle social français, diminuerait l’endettement et arrêterait notre déclin. Aussi nous faut-il aller de l’avant et penser une stratégie capable de doper notre croissance. L’industrialisation de pays d’une Afrique qui affiche une prévision de 2.5 milliards d’habitants en 2050, nous procurerait des opportunités.
De nombreuses entreprises ont pris conscience d’une trop grande dépendance à la Chine et accepteront de transférer une part des étapes de chaines de valeur mondiales vers d’autres pays peu développés ou que l’on peut parfois classer en cycle agricole mais qui veulent s’industrialiser ainsi que le propose le Plan de régionalisation de production Europe Afrique ou programme Africa Atlantic Axis. Les populations sont en demande de modernisation et d’emplois mieux rémunérés que ceux du secteur informel. Complementaire, le concept International Convention for a Global Minimum Wage qui concernerait d'abord les emplouis de production, constituerait un accelerateur de développement. Sa progressivité modérerait cependant le risque d'inflation.
Déjà bienveillamment accueilli par plusieurs dizaines de médias africains, ce concept sera plébiscité par une jeunesse africaine ambitieuse. En réaffectant une part même mineure du budget annuel français d’aide au développement (AFD et Proparco) dont par ailleurs, la plus grande part est actuellement inefficiente en termes de développement, les études d’ingénierie et la mise en œuvre n’occasionneraient donc aucune nouvelle dépense pour le contribuable français. Des effets du projet permettraient de réaliser d’importantes économies dans d’autres postes de dépenses.
L’ONU et d’autres institutions internationales dont la politique malthusienne tente de freiner la fécondité en limitant le développement, se trompent depuis 60 ans. Surtout idéologique et prônée par le GIEC, émanation de l’ONU, la politique du New Green Deal qui favorise les investissements en faveur de fonds ou acteurs du numérique et des énergies renouvelables, apparait peu pertinente car déconnectée d’un projet industriel d’ensemble et d’un développement coordonné. En allant à l’encontre de l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne, cette vision condamne le continent africain, au sous-développement.
Le modèle post-colonial d'aide publique pour le développement (APD) de l’Afrique est anachronique et inadapté dans un contexte de mondialisation
De même, Rémy Rioux qui a été nommé Directeur général de l'Agence Francaise de Développement (AFD) par François Hollande et récemment désigné par Emmanuel Macron pour un 3ème mandat, revendique une politique "100 % compatible avec l'Accord de Paris" dont il était le coordinateur financier en 2015 (COP 21). Le montant du budget annuel ou des engagements avoisinent 16/17 Mrds d'euros dont un peu plus de la moitié est consacrée à l'Afrique. Mais les énormes capitaux mobilsés semblent arroser le sable. Pour exemple, le dispositif baptisé "choose Africa" (3 milliards d'euros pour 26 000 starts-up, TPE et PME africaines) apparait démagogique et désordonné. Les mesures incohérentes à l'egard de la Chine comme le co-financement d’infrastructures chinoises des « routes de la soie » en Afrique et le versement d’aides à la Chine peuvent aussi laisser perplexes.
Alors, après 60 ans d’inefficacité industrielle, cette émanation de l’Etat français n’est guère crédible quand elle publie en juin 2022, le livre « L'industrialisation en Afrique subsaharienne, saisir les les opportunités des chaines de valeur mondiales" La formule d'apparence volontaire qui semble inspirée de notre coeur de projet, ne peut convaincre quand au contraire, le discours idéologique de l'AFD participe depuis si longtemps d'un immobilisme en Afrique subsaharienne. On peut penser que le Général de Gaulle a créé et fait évoluer l'AFD pour favoriser un développement industriel et économique de l'Afrique et non pour instituer un secours perpétuel humiliant pour les africains et finalement trés couteux pour la France. Mais le dirigeant tente de justifier la politique de l'AFD en estimant que celle-ci est soumise à la nouvelle loi de programmation de l’aide internationale d’août 2021 qui elle même doit se conformer au programme de développement durable de 2015 défini par l’ONU.
L’AFD s’est clairement détournée de sa vocation première de développement. Mais ces choix idéologiques, politiques ou financiers qui excluent, au nom du climat, la plupart des industries manufacturières de biens de consommation, ne sont pas sans consequences. Ils condamnent le continent africain, au sous-développement et ses populations, à l’extrême pauvreté, la faim et souvent la mort. Pourtant, l’ONU est consciente des probables effets de son inaction. Elle connait les risques de plus grande catastrophe humanitaire jamais connue en Afrique subsaharienne et d’immigration qui déstabilisera l’Europe. La France et l’UE doivent modifier leur politique et cesser de confier entièrement la gestion des capitaux du développement de l’Afrique subsaharienne à des ONG ou organisations publiques dont la perception de l’économie et de l’entreprise, peut apparaitre théorique et dogmatique.
Seule une hausse du niveau de vie qui encouragera l'éducation des enfants et l'émancipation des femmes, permettra, au fil des années et des générations, une réduction de la natalité. Cela constitue très certainement la clé de la réussite de l’Afrique. Face à l’échec et à l’aggravation de la misère voire de possibles situations de famine dans 45 pays d’Afrique à la suite de la guerre en Ukraine, les organisations internationales devraient enfin changer de politique. Elles pourraient adhérer au financement de structures et infrastructures inscrites dans un cadre organisé du projet. Le coût dispensé au rythme du développement, demeurerait modeste au regard des actions passées qui, bien qu’inefficaces, ont couté prés de 1 500 Mrds d’euros.
Partenariats, mécanismes de mutualisation et de péréquation des coûts ainsi qu’économies d’échelle privilégieront de la compétitivité en Afrique et en France. Lorsque plusieurs pays d’Afrique deviendront des eldorados, le nombre de candidats à l’exil vers l’UE diminuera considérablement et de nombreux drames humains seront épargnés. L’essor offrira à la France, d’innombrables perspectives industrielles et des emplois dans l’ensemble des secteurs d’activité. Cela favorisera la croissance française indispensable au maintien de notre modèle social.
Francis JOURNOT est consultant et entrepreneur. Il dirige le programme pour l’industrialisation de l’Afrique subsaharienne ou Plan de régionalisation de production Europe Afrique. Il fait de la recherche dans le cadre d’Africa Atlantic Axis et d’International Convention for a Global Minimum Wage
.
Copie et reproduction interdites - Copyright © 2025 Francis Journot - All rights reserved